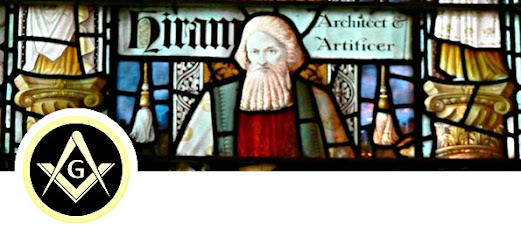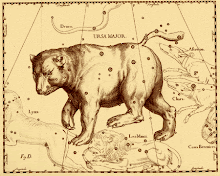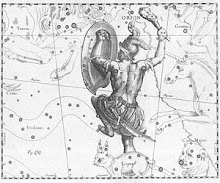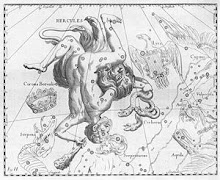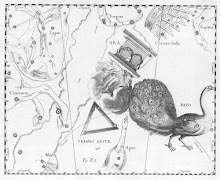LES DEMEURES PHILOSOPHALES
ET LE SYMBOLISME HERMÉTIQUE
DANS SES RAPPORTS AVEC L’ART SACRÉ
ET L’ÉSOTÉRISME DU GRAND-ŒUVRE
Planches originales de Julien Champagne
TABLE DES MATIÈRES DU TOME SECOND
LE MERVEILLEUX GRIMOIRE DU CHÂTEAU DE DAMPIERRE
I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII
LES GARDES DU CORPS DE FRANÇOIS II
I – II – III – IV – V – VI – VII
LE CADRAN SOLAIRE DU PALAIS HOLYROOD D’ÉDIMBOURG
PARADOXE DU PROGRÈS ILLIMITÉ DES SCIENCES
LE RÈGNE DE L’HOMME
LE DÉLUGE
L’ATLANTIDE
L’EMBRASEMENT
L’ÂGE D’OR
LE MERVEILLEUX GRIMOIRE DU CHÂTEAU DE DAMPIERRE
Dans la région santone à laquelle appartient
Coulonges-sur-l’Autize, — chef-lieu de canton où s’élevait autrefois la belle
demeure de Louis d’Estissac, — le touriste prévenu peut découvrir un autre
château, que sa conservation et l’importance d’une décoration singulière rend
plus intéressant encore, celui de Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Inférieure).
Construit à la fin du XVe siècle, et sous François de Clermont, le château de
Dampierre est actuellement la propriété de M. le docteur Texier, de
Saint-Jean-d’Angély. [Recueil de la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure, t.
XIV. Saintes, 1884.] Par l’abondance et la variété des symboles qu’il propose,
comme autant d’énigmes, à la sagacité du chercheur, il mérite d’être mieux
connu, et nous sommes heureux de le signaler particulièrement à l’attention des
disciples d’Hermès.
Extérieurement, son architecture, quoique élégante et de bon
goût, reste fort simple et ne possède rien de remarquable ; il en est des
édifices comme de certains hommes : leur tenue discrète, la modestie de leur
apparence ne servent souvent qu’à voiler chez eux ce qu’ils ont de supérieur.
Entre des tours rondes, coiffées de toits coniques et
pourvues de mâchicoulis, s’étend un corps de logis Renaissance dont la façade
s’ouvre, au dehors, par dix arcades surbaissées. Cinq d’entre elles forment
colonnade au rez-de-chaussée, tandis que les cinq autres, directement
superposées aux précédentes, ajourent le premier étage. Ces ouvertures
éclairent des galeries d’accès aux salles intérieures, et l’ensemble offre
ainsi l’aspect d’une large loggia couronnant un déambulatoire de cloître. Telle
est l’humble couverture du magnifique album dont les feuillets de pierre
garnissent les voûtes de la galerie haute (pl. XXIII).
 |
| Planche XXIII |
Mais, si l’on connaît aujourd’hui quel fut le constructeur
des bâtiments nouveaux destinés à remplacer le vieux burg féodal de
Château-Gaillard, nous ignorons encore à quel mystérieux inconnu les
philosophes hermétiques sont redevables des pièces symboliques qu’ils abritent.
[« On voyait naguère, au-dessus de la porte d’entrée de la maison Richard,
rebâtie il y a une quinzaine d’années environ, une pierre d’assez respectable
dimension sur laquelle on lisait ce mot grec, gravé en gros caractères :
ΑΝΑΛΩΤΟΣ, c’est-à-dire imprenable. Elle venait, paraît-il, de l’ancien château.
Cette pierre a servi, dans la suite, à la construction d’un pilier de hangar. »
Recueil de la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure, note de M. Serton père, communiquée par M. Fragnaud,
ancien maire de Dampierre.]
Il est à peu près certain, et nous partageons sur ce point
l’opinion de Léon Palustre, que le plafond à caissons de la galerie haute, où
gît tout l’intérêt de Dampierre, fut exécuté de 1545 ou 1546 à 1550. Ce qui
l’est moins, c’est l’attribution que l’on a faite de cette œuvre à des
personnages, notoires sans doute, mais qui lui sont complètement étrangers.
Certains auteurs ont, en effet, prétendu que les motifs emblématiques émanaient
de Claude de Clermont, baron de Dampierre, gouverneur d’Ardres, colonel des
Grisons et gentilhomme de la chambre du roi. Or, dans sa Vie des Dames
illustres, de Brantôme nous dit que, pendant la guerre du roi d’Angleterre et
du roi de France, Claude de Clermont tomba dans une « embusche » dressée par
l’ennemi, et y mourut en 1545. Il ne pouvait donc être pour si peu que ce fût
dans les travaux exécutés après son décès. Sa femme, Jeanne de Vivonne, fille
d’André de Vivonne, seigneur de la Châteigneraye, d’Esnandes, d’Ardelay,
conseiller et chambellan du roi, sénéchal du Poitou, etc., et de Louise de
Daillon du Lude, était née en 1520. Elle restait veuve à vingt-cinq ans. Son
esprit, sa distinction, sa haute vertu lui acquirent une réputation telle que,
à l’instar de Brantôme, louant l’étendue de son érudition, Léon Palustre lui
fait l’honneur d’être l’instigatrice des bas-reliefs de Dampierre : « C’est là,
dit-il, que Jeanne de Vivonne s’est amusée à faire exécuter, par des sculpteurs
d’un mérite ordinaire, toute une série de compositions au sens plus ou moins
clair. » [Léon Palustre, La Renaissance
en France ; Aunis et Saintonge, p. 293.]
Enfin, une troisième attribution ne mérite pas même la peine
d’être retenue. [Abbé Noguès, Dampierre-sur-Boutonne.
Monographie historique et archéologique. Saintes, 1883, p. 53.] L’abbé
Noguès, en mettant en avant le nom de Claude-Catherine de Clermont, fille de
Claude et de Jeanne de Vivonne, émet une opinion absolument inacceptable, ainsi
que le dit Palustre : « Cette future châtelaine de Dampierre, née en 1543,
était une enfant au moment où s’achevaient les travaux. »
Ainsi, pour ne point commettre d’anachronisme, est-on obligé
d’accorder à Jeanne de Vivonne seule la paternité du décor symbolique de la
galerie haute. Et pourtant, quelque vraisemblable que puisse paraître cette
hypothèse, il nous est impossible d’y souscrire. Nous nous refusons
énergiquement à reconnaître une femme de vingt-cinq ans comme bénéficiaire
d’une science exigeant plus du double d’efforts soutenus et d’études
persévérantes. En supposant même qu’elle ait pu, dans sa prime jeunesse, et au
mépris de toute règle philosophique, recevoir l’initiation orale de quelque
artiste inconnu, il n’en demeure pas moins qu’il lui aurait fallu contrôler,
par un labeur tenace et personnel, la vérité de cet enseignement. Or, rien
n’est plus pénible, plus rebutant, que de poursuivre, pendant de longues
années, une série d’expériences, d’essais, de tentatives réclamant une
assiduité constante, l’abandon de toute affaire, de toute relation, de toute
préoccupation extérieure. La réclusion volontaire, le renoncement au monde sont
indispensables à observer si l’on veut obtenir, avec les connaissances
pratiques, les notions de cette science symbolique, plus secrète encore, qui
les recouvre et les dérobe au vulgaire. Jeanne de Vivonne se soumit-elle aux
exigences d’une maîtresse admirable, prodigue d’infinis trésors, mais
intransigeante et despotique, voulant être aimée exclusivement pour elle-même
et imposant à ses adorateurs une obéissance aveugle, une fidélité à toute
épreuve ? Nous ne trouvons rien chez elle qui puisse justifier un tel souci. Au
contraire, sa vie est uniquement mondaine. Admise à la cour, écrit de Brantôme,
« dès l’âge de huict ans, y avoit elle esté nourrie, et n’avoit rien oublié ;
et la faysoit bon ouyr parler, ainsy que j’ay veu nos roy et reynes y prendre
un singulier plaisir de l’ouyr, car elle sçavoit tout et de son temps et du
passé ; si bien qu’on prenoit langue d’elle comme d’un oracle. Aussi, le roy
Henri IIIe et dernier la fist dame d’honneur de la reyne, sa femme. » Vivant à
la cour, elle voit successivement cinq monarques se succéder sur le trône :
François Ier, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Sa vertu est
reconnue et réputée au point d’être respectée par l’irrévérencieux Tallemant
des Réaux ; quant à son savoir, il est exclusivement historique. Faits,
anecdotes, chroniques, biographies en constituent l’unique bagage. C’était, en
définitive, une femme douée d’excellente mémoire, ayant beaucoup écouté,
beaucoup retenu, au point que de Brantôme, son neveu et historiographe, parlant
de Mme de Dampierre, dit qu’elle « estoit un vray registre de la court ».
L’image est parlante ; Jeanne de Vivonne fut un registre, agréable, instructif
à consulter, nous n’en doutons pas, mais elle ne fut point autre chose. Entrée
si jeune dans l’intimité des souverains de France, avait-elle seulement plus ou
moins résidé, par la suite, au château de Dampierre ? Telle était la question
que nous nous posions en feuilletant le beau recueil de Jules Robuchon,
lorsqu’une notice de M. Georges Musset, ancien élève de l’École des chartes et
membre de la Société des Antiquaires de l’Ouest, vint à propos la solutionner
et appuyer notre conviction. « Mais, écrit G. Musset, voilà que des documents
inédits viennent compliquer la question et semblent créer des impossibilités.
Un aveu de Dampierre est rendu au roi, à cause de son châtel de Niort, le 9
août 1547, à l’avènement de Henri II. Les avouants sont Jacques de Clermont,
usufruitier de la terre, et François de Clermont, son fils émancipé, pour la
nue propriété. Le devoir consiste en un arc d’if et un bousson sans coche. De
cet acte, il semble résulter : 1° que ce n’est pas Jeanne de Vivonne qui jouit
de Dampierre, ni sa fille Catherine qui le possède ; 2° que Claude de Clermont
avait un jeune frère, François, mineur émancipé en 1547. Il n’y a pas lieu, en
effet, de supposer que Claude et François seraient un même personnage, puisque
Claude est mort pendant la campagne de Boulogne, finie, nous le savons, par le
traité entre François Ier et Henri VIII, le 7 juin 1546. Mais alors que devint
François, qui n’est pas indiqué par Anselme ? Que se passa-t-il, relativement à
cette terre, de 1547 à 1558 ? Comment, d’une aussi belle association
d’incapacités au point de vue de la possession, usufruitiers ou mineurs, put
sortir une habitation aussi luxueuse ? Ce sont là des mystères que nous ne
pouvons éclaircir. C’est déjà beaucoup, croyons-nous, que d’entrevoir les
difficultés. » [Paysages et Monuments du Poitou, photograpahiés par Jules
Robuchon. T. IX : Dampierre-sur-Boutonne, par Georges Musset. Paris, 1893, p.
9.]
Ainsi se trouve confirmée l’opinion que le philosophe à qui
nous devons tous les embellissements du château, — peintures et sculptures, —
nous est inconnu et le restera peut-être à jamais.
II (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Dans une salle spacieuse du premier étage, on remarque tout
particulièrement une grande et fort belle cheminée, dorée et recouverte de
peintures. Malheureusement, la surface principale du manteau a perdu, sous un
affreux badigeon rougeâtre, les sujets qui la décoraient. Seules, quelques
lettres isolées restent visibles dans sa partie inférieure. Par contre, les
deux côtés ont conservé leur décoration et font vivement regretter la perte de
la composition majeure. Sur chacun de ces côtés le motif est semblable. On y
voit apparaître, dans le haut, un avant-bras dont la main tient une épée levée
et une balance. Vers le milieu de l’épée s’enroule la partie centrale d’un
phylactère flottant, revêtu de l’inscription :
DAT JVSTVS FRENA SVPERBIS.
[Le juste met un frein aux orgueilleux.]
Deux chaînes d’or, reliées au sommet de la balance, viennent
s’adapter plus bas, l’une au collier d’un molosse, l’autre au carcan d’un
dragon dont la langue sort par la gueule ouverte. Tous deux dressent la tête et
dirigent leurs regards vers la main. Les deux plateaux de la balance portent des
rouleaux de pièces d’or. L’un de ces rouleaux est marqué de la lettre L
surmontée d’une couronne ; sur un autre, c’est une main tenant une petite
balance avec, au-dessous d’elle, l’image d’un dragon d’aspect menaçant.
Au-dessus de ces grands motifs, c’est-à-dire à l’extrémité
supérieure des faces latérales, sont peints deux médaillons. Le premier montre
une croix de Malte flanquée, aux angles, de fleurs de lys ; le second porte
l’effigie d’une gracieuse figurine.
Dans son ensemble, cette composition se présente comme un
paradigme de la science hermétique. Dogue et dragon y tiennent la place des
deux principes matériels, assemblés et retenus par l’or des sages, selon la
proportion requise et l’équilibre naturel, ainsi que nous l’enseigne l’image de
la balance. La main est celle de l’artisan ; ferme pour manœuvrer l’épée, —
hiéroglyphe du feu qui pénètre, mortifie, change les propriétés des choses, —
prudente dans la répartition des matières d’après les règles des poids et des
mesures philosophiques. Quant aux rouleaux de pièces d’or, ils indiquent
clairement la nature du résultat final et l’un des objectifs de l’Œuvre. La
marque formée d’un L couronné a toujours été le signe conventionnel chargé,
dans la notation graphique, de désigner l’or de projection, c’est-à-dire
alchimiquement fabriqué.
Tout aussi expressifs sont les petits médaillons, dont l’un
représente la Nature, laquelle doit sans cesse servir de guide et de mentor à
l’artiste, tandis que l’autre proclame la qualité de Rose-Croix qu’avait acquise
le savant auteur de ces symboles variés. La fleur de lys héraldique correspond,
en effet, à la rose hermétique. Jointe à la croix, elle sert, comme la rose,
d’enseigne et de blason au chevalier pratiquant ayant, par la grâce divine,
réalisé la pierre philosophale. Mais, si cet emblème nous apporte la preuve du
savoir que possédait l’Adepte inconnu de Dampierre, il sert aussi à nous
convaincre de la vanité, de l’inutilité des tentatives que nous pourrions faire
dans la recherche de sa véritable personnalité. On sait pourquoi les Rose-Croix
se qualifiaient eux-mêmes d’invisibles ; il est donc probable que, de son
vivant, le nôtre a dû s’entourer des précautions indispensables et prendre
toutes les mesures propres à dissimuler son identité. Il a voulu que l’homme
s’effaçât devant la science et que son œuvre lapidaire ne contînt d’autre
signature que le titre élevé, mais anonyme, du rosicrucianisme et de l’Adeptat.
Au plafond de la même salle où se dresse la grande cheminée
que nos signalons, se trouvait jadis une poutre ornée de cette curieuse
inscription latine :
Factorum claritas
fortis animus secundus famæ sine villa fine cursus modicæ opes bene partæ
innocenter amplificatæ semper habita numera Dei sunt extra invidiæ injurias
positæ æternum ornamento et exemplo apud suos futura.
« D’illustres actions, un cœur magnanime, une renommée
glorieuse et qui ne finit pas dans la honte ; une modeste fortune bien acquise,
honorablement accrue et toujours regardée comme un présent de Dieu, voilà ce
que ne peuvent atteindre l’injustice et l’envie, et qui doit être
éternellement, pour la famille, une gloire et un exemple. »
Au sujet de ce texte, disparu depuis longtemps déjà, M. le
docteur Texier a bien voulu nous communiquer quelques précisions : «
L’inscription dont vous me parlez, nous écrit-il, existait sur une poutre d’une
salle du premier étage, qui, tombant de vétusté, a dû être changée il y a
soixante ou quatre-vingt ans. L’inscription fut exactement relevée, mais le
fragment de poutre, où elle se trouvait peinte en lettres dorées, a été perdu.
Mon beau-père, à qui appartenait le château, se rappelle très bien l’avoir vue.
» [On a retrouvé plus tard la planche portant l’inscription que nous
reproduisons, au milieu d’autres planches formant, dans un parc à brebis, une
cloison de séparation.]
Paraphrase de Salomon dans l’Ecclésiaste, où il est dit (ch.
III, v. 13) que « chacun doit manger et boire, et jouir du produit de tout son
travail, car c’est un don de Dieu », cette pièce détermine de façon positive et
suffit à expliquer quelle était l’occupation mystérieuse à laquelle se livrait,
sous le manteau, l’énigmatique châtelain de Dampierre. L’inscription révèle, en
tout cas, chez son auteur, une sagesse peu commune. Aucun labeur, quel qu’il
soit, ne peut procurer une aisance mieux acquise ; l’ouvrier reçoit de la
nature même le salaire intégral auquel il a droit, et celui-ci lui est compté
au prorata de son habileté, de ses efforts, de sa persévérance. Et comme la
science pratique a toujours été reconnue comme un véritable don de Dieu par
tous les possesseurs du Magistère, le fait que cette profession de foi
considère la fortune acquise comme un présent de Dieu suffit à en déceler
l’origine alchimique. Son accroissement régulier et honorable ne saurait, dans
ces conditions, surprendre personne.
Deux autres inscriptions émanant de la même demeure méritent
d’être rapportées ici. La première, peinte sur le manteau d’une cheminée,
comporte un sizain que domine un sujet composé de la lettre H, tenant deux D
entrelacés et ornés de figures humaines, vues de profil, l’une de vieillard,
l’autre de jeune homme. Cette petite pièce, allègrement écrite, exalte
l’existence heureuse, empreinte de calme et de sérénité, de bienveillante
hospitalité, que menait notre philosophe en son séduisant logis :
DOVLCE . EST . LA . VIE . A . LA . BIEN . SVYVRE .
EMMY . SOYET . PRINTANS . SOYET . HYVERS .
SOVBS . BLANCHE . NEIGE . OV . RAMEAVX . VERTS .
QVAND . VRAYS . AMIS . NOVS . LA . FONT . VIVRE .
AINS . LEVR . PLACE . A . TOVS . EST . ICI .
COMME . AVX . VIEVLS . AVX . JEVNES . AVSSI .
La seconde, qui garnit une cheminée plus grande, revêtue
d’ornements de couleur rouge, gris et or, est une simple maxime d’un beau
caractère moral, mais que l’humanité superficielle et présomptueuse de notre époque
répugne à pratiquer :
SE . COGNESTRE . ESTRE . ET . NON . PARESTRE .
Notre Adepte à raison ; la connaissance de soi-même permet
d’acquérir la science, but et raison d’être de la vie, base de toute valeur
réelle ; et cette puissance, élevant l’homme laborieux qui la peut acquérir,
l’incite à demeurer dans une modeste et noble simplicité, éminente vertu des
esprits supérieurs. C’était un axiome que les maîtres répétaient à leurs
disciples, et par lequel ils leur indiquaient l’unique moyen de parvenir au
suprême savoir : « Si vous voulez cognoistre la sagesse, leur disaient-ils,
cognoissez-vous bien et vous la cognoistrez. »
III (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
La galerie haute, dont le plafond est si curieusement orné,
occupe toute la longueur du bâtiment élevé entre les tours. Elle prend jour,
nous l’avons dit, par cinq baies que séparent des colonnes trapues, munies, à
l’intérieur, de supports engagés recevant les retombées d’arcs. Deux fenêtres à
meneaux droits et linteaux rectilignes s’ouvrent aux extrémités de cette
galerie. Des nervures transversales empruntent la forme surbaissée des baies et
sont coupées par deux nervures longitudinales, parallèles, déterminant ainsi
l’encadrement des caissons qui font l’objet de notre étude (pl. XXIV).
 |
| Planche XXIV |
Ceux-ci furent, bien avant nous, décrits par Louis Audiat.
[Louis Audiat, Épigraphie Santone et
Aunisienne. Paris, J.-B. Dumoulin, et Niort, L. Clouzot, 1870.] Mais
l’auteur, ignorant tout de la science à laquelle ils se réfèrent, et la raison
essentielle qui relie entre elles tant d’images bizarres, a doté son livre du
caractère d’incohérence que les figures elles-mêmes affectent pour le profane.
À lire l’Épigraphie Santone, il
semblerait que le caprice, la fantaisie et l’extravagance eussent présidé à
leur exécution. Aussi, le moins que l’on puisse dire de cet ouvrage, c’est
qu’il apparaît peu sérieux, dépourvu de fond, baroque, sans autre intérêt
qu’une excessive singularité. Certaines erreurs inexplicables ajoutent encore à
l’impression défavorable qu’on en reçoit. C’est ainsi, par exemple, que
l’auteur prend une pierre cubique, taillée et posée sur l’eau (série I, caisson
5), pour « un navire agité sur les flots » ; ailleurs (série IV, caisson 7),
une femme courbée, plantant des noyaux auprès d’un arbre, devient chez lui « un
voyageur qui chemine péniblement à travers un désert ». Au premier caisson de
la cinquième série, — que nos lectrices lui pardonnent cette involontaire
comparaison, — il voit une femme au lieu du diable en personne, velu, ailé,
cornu, parfaitement net et visible… De telles méprises dénotent une étourderie
inexcusable chez un épigraphiste conscient de sa responsabilité et de
l’exactitude que réclame sa profession.
D’après M. le docteur Texier, à l’obligeance de qui nous
devons ce renseignement, les figures de Dampierre n’auraient jamais été
publiées en totalité. Toutefois, il en existe une reproduction dessinée d’après
l’original et conservée au musée de Saintes. C’est à ce dessin que, pour
certains motifs imprécis, nous avons eu recours, afin de rendre notre
description aussi complète que possible.
Presque toutes les compositions emblématiques présentent, en
dehors d’un sujet sculpté en bas-relief, une inscription gravée sur un
phylactère. Mais, tandis que l’image se rapporte directement au côté pratique
de la science, l’épigraphe offre surtout un sens moral ou philosophique ; elle
s’adresse à l’ouvrier plutôt qu’à l’ouvrage, et, tantôt employant l’apophtegme,
tantôt la parabole, définit une qualité, une vertu que l’artiste doit posséder,
un point de doctrine qu’il ne saurait méconnaître. Or, par la raison même
qu’elles sont pourvues de phylactères, ces figures révèlent leur portée
secrète, leur affectation à quelque science cachée. En effet, le grec
φυλακτήριον, formé de φυλάσσω, garder, préserver, et de τηρέω, conserver,
indique la fonction de cet ornement, chargé de conserver, de préserver le sens
occulte et mystérieux dissimulé derrière l’expression naturelle des
compositions qu’il accompagne. C’est le signe, le sceau de cette Sagesse qui se
tient en garde contre les méchants, ainsi que le dit Platon : Σοφία η περὶ τοὺς
πονηροὺς φυλακτική. Porteur ou non d’épigraphe, il suffit de trouver le
phylactère sur n’importe quel sujet pour être assuré que l’image contient un
sens caché, une signification secrète proposée au chercheur et marquée par sa
simple présence. Et la vérité de ce sens, la réalité de cette signification se
retrouvent toujours dans la science hermétique, qualifiée chez les maîtres
anciens d’éternelle sagesse. On ne saurait donc être surpris de rencontrer
banderoles et parchemins, abondamment représentés parmi les attributs des
scènes religieuses ou des compositions profanes de nos grandes cathédrales,
ainsi que dans le cadre moins sévère de l’architecture civile.
Disposés en trois rangs, perpendiculairement à l’axe, les
caissons de la galerie haute sont au nombre de 93. Sur ce nombre, 61 se
rapportent à la science, 24 offrent des monogrammes destinés à les séparer par
séries, 4 ne présentent que des ornements géométriques, d’exécution
postérieure, et les 4 derniers montrent leur table vide et lisse. Les caissons
symboliques, sur lesquels se concentre l’intérêt du plafond de Dampierre,
constituent un ensemble de figures réparties en sept séries. Chaque série est
isolée de la suivante par trois caissons, disposés en ligne transversale,
décorés alternativement du monogramme de Henri II et des croissants entrelacés
de Diane de Poitiers ou de Catherine de Médicis, chiffres que l’on remarque sur
quantité d’édifices de la même époque. Or, nous avons fait cette constatation,
assez surprenante, que la plupart des hôtels ou châteaux porteurs du double D
lié à la lettre H et du triple croissant, ont une décoration de caractère
alchimique incontestable. Mais pourquoi ces mêmes logis sont-ils qualifiés du
titre de « châteaux de Diane de Poitiers » par les auteurs de monographies, et
sur la seule existence du chiffre en question ?
Cependant, ni la demeure de Louis d’Estissac, à
Coulonges-sur-l’Autize, ni celle des Clermont, placées toutes deux sous l’égide
de la trop fameuse favorite, ne lui ont jamais appartenu. D’autre part, quelle
raison pourrait-on donner du monogramme et des croissants qui fût de nature à
justifier leur présence au milieu d’emblèmes hermétiques ? À quelle pensée, à
quelle tradition les initiés de la noblesse auraient-ils obéi en plaçant sous
la protection fictive d’un monarque et de sa concubine, — objets de la
réprobation générale, — leur œuvre hiéroglyphique peinte ou sculptée ? « Henri
II, écrit l’abbé de Montgaillard, était un prince sot, brutal et d’une profonde
insouciance pour le bien de ses peuples ; ce mauvais roi fut constamment dominé
par sa femme et par sa vieille maîtresse ; il leur abandonna les rênes de
l’État et ne recula devant aucune des cruautés exercées contre les protestans.
On peut dire de lui qu’il continua le règne de François Ier, en fait de
despotisme politique et d’intolérance religieuse. » [Abbé de Montgaillard. Histoire de France, t. I, p. 186. Paris,
Moutardier, 1827.] Il est donc impossible d’admettre que des philosophes
instruits, gens d’étude et de haute moralité, aient eu la pensée d’offrir
l’hommage de leurs travaux au couple royal que la débauche devait rendre
honteusement célèbre.
Différente est la vérité, car le croissant n’appartient ni à
Diane de Poitiers, ni à Catherine de Médicis. C’est un symbole de la plus haute
antiquité, connu des Égyptiens et des Grecs, utilisé par les Arabes et par les
Sarrasins bien avant son introduction dans notre moyen âge occidental. C’est
l’attribut d’Isis, d’Artémis ou de Diane, de Séléné, Phœbé ou la Lune,
l’emblème spagyrique de l’argent et le sceau de la couleur blanche. Sa
signification est triple : alchimique, magique, cabalistique, et cette triple
hiérarchie de sens, synthétisée dans l’image des croissants entrelacés,
embrasse l’étendue de l’ancienne et traditionnelle connaissance. On s’étonnera
moins, dès lors, de voir figurer la triade symbolique à côté de signes obscurs,
puisqu’elle leur sert de support et permet d’orienter l’investigateur vers la
science à laquelle ceux-ci appartiennent.
Quant au monogramme, il est facilement explicable et montre,
une fois de plus, comment les philosophes ont utilisé des emblèmes de
signification connue, en les dotant d’un sens spécial généralement ignoré.
C’est le plus sûr moyen qu’ils aient eu de masquer au profane une science
exposée figurativement à tous les regards : procédé renouvelé des Égyptiens
dont l’enseignement, traduit en hiéroglyphes à l’extérieur des temples,
demeurait lettre morte pour qui n’en avait pas la clef. Le monogramme
historique est formé de deux D, entrelacés et réunis par la lettre H, initiale
de Henri II. Telle est, du moins, l’expression ordinaire du chiffre qui voile,
sous son image, une tout autre chose.
On sait que l’alchimie est fondée sur les métamorphoses
physiques opérées par l’esprit, dénomination donnée au dynamisme universel
émané de la divinité, lequel entretient la vie et le mouvement, en provoque
l’arrêt ou la mort, évolue la substance et s’affirme comme le seul animateur de
tout ce qui est. Or, dans la notation alchimique, le signe de l’esprit ne
diffère pas de la lettre H des Latins et de l’êta des Grecs. Nous donnerons
plus loin, en étudiant l’un des caissons où ce caractère est figuré couronné
(série VII, 2), quelques-unes de ses applications symboliques. Pour l’instant,
il suffit de savoir que l’esprit, agent universel, constitue, dans la
réalisation de l’Œuvre, la principale inconnue dont la détermination assure le
plein succès. Mais celle-ci, dépassant les bornes de l’entendement humain, ne
peut-être acquise que par révélation divine. « Dieu, répètent les maîtres,
donne la sagesse à qui il lui plaît et la transmet par l’Esprit-Saint, lumière
du monde ; c’est pourquoi la science est dite un Don de Dieu, autrefois réservé
à ses ministres, d’où le nom d’Art sacerdotal qu’elle portait à l’origine. »
Ajoutons qu’au moyen âge le Don de Dieu s’appliquait au Secretum secretorum, ce
qui revient précisément au secret par excellence, celui de l’esprit universel.
Ainsi, le Donum Dei, connaissance révélée de la science du
Grand-Œuvre, clef des matérialisations de l’esprit et de la lumière (Ἥλιος),
apparaît incontestablement sous le monogramme du double D (Donum Dei) uni au
signe de l’esprit (H), initiale grecque du soleil, père de la lumière, Ἥλιος.
On ne saurait mieux indiquer le caractère alchimique des figures de Dampierre,
dont nous allons maintenant entreprendre l’étude.
IV (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Première série (pl. XXV).
 |
| Planche XXV |
Caisson 1. — Deux arbres de même dimension et de grosseur
semblable figurent côte à côte sur le même terrain ; l’un est vert et
vigoureux, l’autre inerte et desséché. [Au pied de cet arbre couvert de
feuillage, la terre est creusée en forme de cuvette, afin que soit mieux
retenue l’eau versée pour son arrosage. De même, le métal, mort par la
réduction, recouvrera-t-il l’existence, en des imbibitions fréquentes.] La
banderole qui paraît les réunir porte ces mots :
. SOR . NON . OMNIBVS . ÆQVE .
Le sort n’est pas égal
pour tous… Cette vérité, limitée à la période d’existence humaine, nous
semble d’autant plus relative que la destinée, triste ou souriante, tranquille
ou bouleversée, nous achemine tous, sans distinction ni privilège, vers la
mort. Mais si nous la transposons dans le domaine hermétique, elle prend alors
un sens positif nettement accusé et qui a dû lui assurer la préférence auprès
de notre Adepte.
Suivant la doctrine alchimique, les métaux usuels, arrachés
de leur gîte pour répondre aux besoins de l’industrie, contraints de se plier
aux exigences de l’homme, apparaissent ainsi comme les victimes d’un mauvais
sort flagrant. Alors qu’à l’état de minerai ils vivaient au fond de la roche,
évoluant lentement vers la perfection de l’or natif, ils sont condamnés à
mourir aussitôt après leur extraction et périssent sous l’action néfaste du feu
réducteur. La fonte, en les séparant des éléments nutritifs, associés aux
minéralisateurs chargés d’entretenir leur activité, les tue en fixant la forme
temporaire et transitoire qu’ils avaient acquise. Telle est la signification
des deux arbres symboliques, dont l’un exprime la vitalité minérale et l’autre
l’inertie métallique.
De cette simple image, l’investigateur intelligent et
suffisamment instruit des principes de l’art pourra tirer une conséquence utile
et profitable. S’il se souvient que les vieux maîtres recommandent de commencer
l’ouvrage au point même où la nature achève le sien ; s’il sait tuer le vif
afin de ressusciter le mort, il découvrira certainement quel métal il lui faut
prendre et quel minéral il doit élire afin de commencer son premier labeur.
Puis, réfléchissant aux opérations de la nature, il apprendra d’elle la manière
d’unir le corps revivifié à un autre corps vivant, — car la vie désire la vie,
— et, s’il nous a compris, il verra de ses yeux et touchera de ses mains le
témoignage matériel d’une grande vérité…
Ce sont là des paroles trop succinctes, sans doute, et nous
le regrettons ; mais notre soumission aux règles de la discipline
traditionnelle ne nous permet pas de les préciser ni de les développer
davantage.
— Une tour de forteresse, élevée sur glacis, couronnée de
créneaux et de mâchicoulis, pourvue de meurtrières et coiffée d’un dôme, est
percée d’une étroite fenêtre grillée et d’une porte solidement verrouillée. Cet
édifice, d’aspect puissant et rébarbatif, reçoit des nuées une averse que
l’inscription désigne comme étant une pluie d’or :
. AVRO . CLAVSA . PATENT .
L’or ouvre les portes
fermées… Chacun le sait. Mais ce proverbe, dont l’application se retrouve à
la base du privilège, du favoritisme et de tous les passe-droits, ne saurait
avoir, dans l’esprit du philosophe, le sens figuré que nous lui connaissons. Ce
n’est pas de l’or corrupteur qu’il est question ici, mais bien de l’épisode
mytho-hermétique que contient la fable de Jupiter et Danaé. Les poètes
racontent que cette princesse, fille du roi d’Argos, Acrisius, fut enfermée
dans une tour parce qu’un oracle avait annoncé à son père qu’il serait tué par
son petit-fils. Or, les murs d’une prison, si épais soient-ils, ne sauraient
constituer un obstacle sérieux à la volonté d’un dieu. Zeus, grand amateur
d’aventure et de métamorphose, toujours préoccupé de tromper la vigilance
d’Héra et d’étendre sa progéniture, remarqua Danaé. Peu embarrassé sur le choix
des moyens, il s’introduisit auprès d’elle sous forme de pluie d’or, et, à
l’expiration du terme requis, la prisonnière mit au monde un fils qui reçut le
nom de Persée. Acrisius, fort mécontent de cette nouvelle, fit enfermer la mère
et l’enfant dans un coffre que l’on jeta à la mer. Emporté par les courants
jusqu’à l’île de Sériphe, des pêcheurs recueillirent le singulier vaisseau,
l’ouvrirent et en présentèrent le contenu au roi Polydecte, lequel reçut avec
beaucoup d’hospitalité Danaé et Persée.
Sous cette mirifique histoire se cache un important secret,
celui de la préparation du sujet hermétique, ou matière première de l’Œuvre, et
de l’obtention du soufre, primum ens
de la pierre.
Danaé représente notre minéral brut, tel qu’on l’extrait de
la mine. C’est la terre des sages qui contient en elle l’esprit actif et caché,
seul capable, dit Hermès, de réaliser « par ces choses les miracles d’une seule
chose ». Danaé vient, en effet, du dorien ∆ᾶν, terre, et de ἄη, souffle,
esprit. Les philosophes enseignent que leur matière première est une parcelle
du chaos originel, et c’est bien ce qu’affirme le nom grec d’Acrisius, roi
d’Argos et père de Danaé : Ἀκρισία signifie confusion, désordre ; Ἀργός veut
dire brut, inculte, inachevé. Zeus, pour sa part, marque le ciel, l’air et
l’eau ; à telle enseigne que les Grecs, pour exprimer l’action de pleuvoir,
disaient : Υει ὸ Ζευς, Jupiter envoie de
la pluie, ou, plus simplement, il
pleut. Ce dieu apparaît donc comme la personnification de l’eau, d’une eau
capable de pénétrer les corps, d’une eau métallique, puisqu’elle est d’or ou
tout au moins dorée. C’est exactement le cas du dissolvant hermétique, lequel,
après fermentation dans un baril de chêne, prend, à la décantation, l’aspect de
l’or liquide. L’auteur anonyme d’un manuscrit inédit du XVIIIe siècle écrit à
ce sujet : « Si vous laissés écouler cette eau, vous y verrés de vos propres
yeux l’or brillant dans son premier être, avec toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel. » [La clef du Cabinet
Hermétique, « manuscrit copié d’après l’original appartenant à M. Desaint,
médecin, rue Hiacinthe à Paris ».] L’union même de Zeus et de Danaé indique
la manière dont le dissolvant doit être appliqué ; le corps, réduit en poudre
fine, mis en digestion avec une faible quantité d’eau, est ensuite humecté,
arrosé peu à peu, au fur et à mesure de son absorption, technique que les sages
ont nommé imbibition. On obtient ainsi une pâte de plus en plus molle, qui
devient sirupeuse, huileuse, enfin fluide et limpide. Soumise alors, dans
certaines conditions, à l’action du feu, une partie de cette liqueur se coagule
en une masse qui tombe au fond et que l’on recueille avec soin. C’est là notre
précieux soufre, l’enfant nouvellement né, le petit roi et notre dauphin,
poisson symbolique autrement appelé échénéis, rémora ou pilote, Persée ou
poisson de la mer Rouge (en grec Περσεύς), etc. [Le rémora est fameux par les
contes dont il a été l’objet. Entre autres fables ridicules, Pline certifie
que, si l’on conserve ce poisson dans du sel, son appoche seule suffit pour
retirer du puits le plus profond l’or qui peut y être tombé.]
Caisson 3 (pl. XXV). — Quatre fleurs épanouies et dressées
sur leurs tiges sont en contact avec le tranchant d’un sabre nu. Ce petit motif
a pour devise :
. NVTRI . ETIAM . RESPONSA . FERVNTVR .
Développe aussi les
oracles annoncés… C’est un conseil donné à l’artiste, afin que celui-ci, en
le pratiquant, puisse être assuré de diriger convenablement la coction, ou
seconde opération du Magistère. Nutri
etiam responsa feruntur, lui confie l’esprit de notre philosophe, par
l’intermédiaire des caractères pétrifiés de son œuvre.
Ces oracles, au nombre de quatre, correspondent aux quatre
fleurs ou couleurs qui se manifestent pendant l’évolution du Rebis et révèlent
extérieurement à l’alchimiste les phases successives du travail interne. Ces
phases, diversement colorées, portent le nom de Régimes ou de Règnes. On en
compte ordinairement sept. À chaque régime les philosophes ont attribué l’une
des divinités supérieures de l’Olympe, et aussi l’une des planètes célestes
dont l’influence s’exerce parallèlement à la leur, dans le temps même de leur
domination. D’après l’idée généralement répandue, planètes et divinités
développent leur puissance simultanée selon une invariable hiérarchie. Au règne
de Mercure (Ἑρμῆς, base, fondement), premier stade de l’Œuvre, succède celui de
Saturne (Κρόνος, le vieillard, le fou) ; Jupiter gouverne ensuite (Ζεύς, union,
mariage), puis Diane, (Ἄρτεμις, entier, complet) ou la Lune, dont la robe
étincelante est tantôt tissée de cheveux blancs, tantôt faite de cristaux de
neige ; Vénus, vouée au vert (Ἀφροδίτη, beauté, grâce), hérite alors du trône,
mais Mars la chasse bientôt (Ἄρης, adapté, fixé), et ce prince belliqueux, aux
vêtements teints de sang coagulé, est lui-même renversé par Apollon (Ἀπόλλων,
le triomphateur), le Soleil du Magistère, empereur vêtu de brillante écarlate,
lequel établit définitivement sa souveraineté et sa puissance sur les ruines de
ses prédécesseurs. [Nous nous bornerons à énumérer ici les stades successifs du
second Œuvre sans en faire d’analyse spéciale. De grands Adeptes, et
particulièrement Philalèthe, dans son Introïtus,
en ont poussé très loin l’étude. Leurs descriptions reflètent une telle
conscience qu’il nous serait impossible d’en dire plus ni de le dire mieux.]
Quelques auteurs, assimilant les phases colorées de la
coction aux sept jours de la création, ont désigné le labeur entier par
l’expression Hebdomas hebdomadum, la
Semaine des semaines, ou simplement la Grande Semaine, parce que l’alchimiste
doit suivre au plus près, dans sa réalisation microcosmique, toutes les
circonstances qui accompagnèrent le Grand-Œuvre du Créateur.
Mais ces régimes divers sont plus ou moins francs et varient
beaucoup, tant pour la durée que pour l’intensité. Aussi les maîtres se
sont-ils bornés à signaler seulement quatre couleurs, essentielles et
prépondérantes, parce qu’elles offrent plus de netteté et de permanence que les
autres, savoir : le noir, le blanc, le jaune ou citrin et le rouge. Ces quatre
fleurs du jardin hermétique doivent être coupées successivement, dans l’ordre
et à la fin de leur floraison, ce qui explique la présence de l’arme sur notre
bas-relief. Partant, il faut craindre de trop se hâter, avec l’espoir vain
d’abréger le temps, parfois très long, en outre-passant le degré de feu requis
au régime du moment. Les vieux auteurs conseillent la prudence et mettent en
garde les apprentis contre toute impatience préjudiciable ; præcipitatio a diabolo, leur
disent-ils ; car, en cherchant à atteindre trop tôt le but, ils ne réussiraient
qu’à brûler les fleurs du compost et provoqueraient la perte irrémédiable de
l’ouvrage. Il est donc préférable, ainsi que l’enseigne l’Adepte de Dampierre,
de développer les oracles, qui sont les prédictions ou présages colorés de
l’opération régulière, avec patience et persévérance, aussi longtemps que la
nature peut l’exiger.
Caisson 4 (pl. XXV). — Une vieille tour démantelée, dont la
porte, arrachée de ses gonds, laisse l’entrée libre : c’est ainsi que l’imagier
a figuré la prison ouverte. À l’intérieur, on voit encore en place une entrave,
ainsi que trois pierres indiquées dans la partie supérieure. Deux autres
entraves, extraites de la geôle, se remarquent aux côtés de la ruine. Cette
composition marque l’achèvement des trois pierres ou médecines de Géber,
successivement obtenues, lesquelles sont désignées par les philosophes sous les
noms de Soufre philosophique pour la première ; Élixir ou Or potable pour la
seconde ; Pierre philosophale, Absolu ou Médecine universelle pour la dernière.
Chacune de ces pierres a dû subir la coction dans l’Athanor, prison du
Grand-Œuvre, et c’est la raison pour laquelle une dernière entrave s’y trouve
encore scellée. Les deux précédentes, ayant accompli leur temps de «
mortification et de pénitence », ont quitté leurs fers, visibles à l’extérieur.
Le petit bas-relief a pour devise la parole de l’apôtre
Pierre (Actes, ch. XII, v. 11), qui
fut miraculeusement délivré de sa prison par un ange :
Maintenant, je sais
vraiment ! … Parole de joie vive, élan d’intime satisfaction, cri
d’allégresse que pousse l’Adepte devant la certitude du prodige. Jusque-là, le
doute pouvait encore l’assaillir ; mais, en présence de la réalisation parfaite
et tangible, il ne craint plus d’errer ; il a découvert la voie, reconnu la
vérité, hérité du Donum Dei. Rien du
grand secret ne lui est désormais ignoré… Hélas ! combien, parmi la foule des
chercheurs, peuvent se flatter d’arriver au but, de voir, de leurs yeux, s’ouvrir
la prison, à jamais close pour le plus grand nombre !
La prison sert encore d’emblème au corps imparfait, sujet
initial de l’Œuvre, dans lequel l’âme aqueuse et métallique se trouve fortement
attachée et retenue. « C’est cette eau prisonnière, dit Nicolas Valois, qui
crie sans cesse : Ayde moy, je t’ayderay, c’est-à-dire eslargis moy de ma
prison, et si une fois tu m’en peux faire sortir, je te rendray maistre de la
forteresse où je suis. L’eau donc qui est dans ce corps enfermée est la mesme
nature d’eau que celle que nous lui donnons à boire, qui est appellée Mercure
Trismegiste, dont entend parler Parmenides, quand il dit : Nature s’esjouit en
Nature, Nature surmonte Nature et Nature contient Nature. Car ceste eau
enfermée se resjouyt avec son compagnon qui le vient deslivrer de ses fers, se
mesle avec iceluy et enfin, convertissant ladite prison en eux, rejetant ce qui
leur est contraire, qui est la preparation, sont convertis en eau mercurielle
et permanente… C’est donc à bon droict que nostre Eau divine est appelée la
Clef, Lumière, Diane qui esclaire dans l’espoisseur de la nuict. Car c’est
l’entrée de tout l’Œuvre et celle qui illumine tout homme. » [Nicolas Valois. Les Cinq Livres. Livre I : De la Clef du
Secret des Secrets. Ms. cité.]
Caisson 5 (pl. XXV). – Pour l’avoir constaté
expérimentalement, les philosophes certifient que leur pierre n’est autre chose
qu’une coagulation complète de l’eau mercurielle. C’est ce fait que traduit
notre bas-relief, où l’on voit la pierre cubique des anciens francs-maçons
flottant sur les ondes marines. Quoi qu’une telle opération paraisse
impossible, elle ne laisse pas toutefois que d’être naturelle, parce que notre
mercure porte en soi le principe sulfureux solubilisé, auquel il est redevable
de sa coagulation ultérieure. Il est regrettable toutefois que l’extrême
lenteur d’action de cet agent potentiel ne permette pas à l’observateur
d’enregistrer le moindre signe d’une réaction quelconque, durant les premiers
temps de l’ouvrage. C’est la cause d’insuccès de beaucoup d’artistes, lesquels,
vite déçus, abandonnent un travail pénible, qu’ils jugent vain, bien qu’ils
aient suivi la bonne voie et opéré sur les matériaux propres, canoniquement
préparés. C’est à ceux-là que s’adresse la parole de Jésus à Pierre marchant
sur les eaux, et que rapporte saint Matthieu (ch. XIV, 31) :
. MODICE . FIDEI . QVARE . DVBITASTI .
Pourquoi doutes-tu,
homme de peu de foi ?
En vérité, nous ne pouvons rien connaître sans le secours de
la foi, et quiconque ne la possède point ne peut rien entreprendre. Nous
n’avons jamais vu que le scepticisme et le doute eussent édifié quoi que ce
soit de stable, de noble, de durable. Il faut souvent se rappeler l’adage latin
: Mens agitat molem, car c’est la
conviction profonde de cette vérité qui conduira le sage ouvrier au terme
heureux de son labeur. C’est en elle, en cette foi robuste, qu’il puisera les
vertus indispensables à la résolution de ce grand mystère. Le terme n’est pas
exagéré : nous nous trouvons, en effet, devant un mystère réel, tant par son
développement contraire aux lois chimiques que par son mécanisme obscur,
mystère que le savant le mieux instruit et l’Adepte le plus expert ne sauraient
expliquer. Tant il est vrai que la nature, en sa simplicité, semble se
complaire à nous proposer des énigmes devant lesquelles notre logique recule,
notre raison se trouble, notre jugement s’égare.
Or, cette pierre cubique, que l’industrieuse nature engendre
de l’eau seule, — matière universelle du péripatétisme, — et dont l’art doit
tailler les six faces selon les règles de la géométrie occulte, apparaît en
voie de formation dans un curieux bas-relief du XVIIe siècle décorant la
fontaine du Vertbois, à Paris (pl. XXVI).
 |
| Planche XXVI |
Comme les deux sujets ont entre eux une étroite
correspondance, nous étudierons ici l’emblème parisien, plus étendu, espérant
ainsi jeter quelque clarté dans l’expression symbolique trop concise de l’image
santone.
Construite en 1633 par les Bénédictins de
Saint-Martin-des-Champs, cette fontaine fut primitivement élevée à l’intérieur
du prieuré et adossée au mur d’enceinte. En 1712, les religieux l’offrirent,
pour l’usage public, à la ville de Paris, avec l’emplacement nécessaire à sa
réédification, sous cette condition « que le regard serait établi dans une des
anciennes tours de leur couvent, et qu’il y serait fait une porte extérieure ».
[Fontaines de Paris, dessinées par Moisy.
Notices par Amaury Duval. Paris, 1812.] La fontaine fut donc placée contre
la tour dite du Vertbois, située rue Saint-Martin, et prit le nom de fontaine
Saint-Martin, qu’elle conserva durant plus d’un siècle.
Le petit édifice, restauré aux frais de l’État en 1832,
comporte « une niche rectangulaire peu profonde, encadrée de deux pilastres
doriques, à bossages vermiculés, qui supportent une corniche architravée. Sur
la corniche repose une espèce d’armetin que couronne un cartouche avec des
ailes. Une conque marine surmonte ce cartouche. La partie supérieure de la
niche est occupée par un cadre au centre duquel est sculpté un vaisseau ». [Inventaire général des Richesses d’Art de la
France. Paris. Monuments civils. Paris, Plon, 1879, t. I.] Ce bas-relief,
en pierre, mesure 0m80 de haut sur 1m05 de large ; son auteur est inconnu.
Ainsi, toutes les descriptions relatives à la fontaine du
Vertbois, copiées vraisemblablement les unes sur les autres, se bornent à
signaler, sans plus le définir, un vaisseau comme motif principal. Le dessin de
Moisy, chargé d’illustrer la notice d’Amaury Duval, ne nous en apprend pas
davantage. Son navire, de pure fantaisie, représenté de profil, ne porte aucune
trace de sa singulière cargaison, et l’on chercherait en vain, parmi les
enroulements des volutes marines, le beau et grand dauphin qui l’accompagne.
D’ailleurs, nombre de gens, peu soucieux du détail, voient dans ce sujet la nef
héraldique de Paris, sans se douter qu’il propose aux curieux l’énigme d’une
vérité tout autre et d’ordre moins vulgaire.
Certes, on pourrait mettre en doute la justesse de notre
observation et, là où nous reconnaissons une pierre énorme, arrimée au bâtiment
avec lequel elle fait corps, ne remarquer qu’un ballot ordinaire de quelconque
marchandise. Mais l’on serait, dans ce cas, fort embarrassé pour donner la
raison de la voile levée, incomplètement carguée sur la vergue du grand mât,
particularité qui met en lumière l’unique et volumineux colis, ainsi dévoilé à
dessein. L’intention du créateur de l’œuvre est donc manifeste ; il s’agit d’un
chargement occulte, normalement dérobé aux regards indiscrets, et non d’un
ballot voyageant sur le pont.
D’avantage, le vaisseau, vu de l’arrière, paraît s’éloigner
du spectateur et montre que son déplacement est assuré par la voile d’artimon,
à l’exclusion des autres. Seule, elle reçoit l’effort du vent, soufflant en
poupe ; seule, elle en transmet l’énergie au navire glissant sur les flots. Or,
les cabalistes écrivent artimon et
prononcent antémon ou antimon, vocable derrière lequel ils
cachent le nom du sujet ses sages. Ἄνθεμον, en grec, signifie fleur, et l’on sait que la matière
première est dite fleur de tous les métaux ; c’est la fleur des fleurs (flos
florum) ; la racine de ce mot, ἄνθος, exprime également la jeunesse, la gloire,
la beauté, la plus noble partie des choses, tout ce qui possède de l’éclat et
brille à l’instar du feu. On ne s’étonnera point, dès lors, que Basile
Valentin, dans son Char triomphal de
l’Antimoine, ait donné à la prime substance de l’œuvre particulier qu’il y
décrit la dénomination de pierre de feu.
Tant qu’elle reste fixée à la nef hermétique, cette pierre,
ainsi que nous l’avons dit, doit être considérée comme étant en voie
d’élaboration. Il faut donc, de toute nécessité, l’aider à poursuivre sa
traversée, afin que ni les tempêtes, ni les écueils, ni les mille incidents de
la route ne retardent son arrivée au havre béni vers lequel, peu à peu, la
nature l’achemine. Faciliter son voyageur, prévoir, écarter les causes
possibles de naufrage, maintenir le vaisseau chargé du précieux fardeau dans sa
ligne directe, telle est la tâche de l’artisan.
Cette formation progressive et lente explique pourquoi la
pierre est ici figurée sous l’aspect d’un bloc dégrossi, appelé à recevoir la
taille définitive qui en fera notre pierre cubique. Les câbles qui
l’assujettissent au bâtiment indiquent assez, par leur croisement sur ses faces
visibles, l’état transitoire de son évolution. On sait que la croix, dans
l’ordre spéculatif, est la figuration de l’esprit, principe dynamique, tandis
qu’elle sert, dans le domaine pratique, de signe graphique au creuset. C’est en
lui, en ce vaisseau, que s’opère la concentration de l’eau mercurielle, par le
rapprochement de ses molécules constitutives, sous la volonté de l’esprit
métallique et grâce au secours permanent du feu. Car l’esprit est l’unique
force capable de muer en masses compactes nouvelles les corps dissous, de même
qu’il oblige les cristaux issus de solutions mères à prendre la forme
spécifique, invariable, par laquelle nous les pouvons identifier. C’est
pourquoi les philosophes ont assimilé l’agrégation moléculaire du solide
mercuriel, sous l’action secrète de l’esprit, à celle d’un sac fortement
comprimé par des ligatures entre-croisées. La pierre paraît liée comme une secchina (du grec σηκάζω, enfermer,
clore), et cette corporification se rend sensible par la croix, image de la
Passion, c’est-à-dire lors du travail au creuset, chaque fois que la chaleur
est prudemment appliquée dans le degré requis et suivant le rythme convenable.
Ainsi convient-il de préciser le sens particulier du câble, que les Grecs
appelaient κάλως, homonyme de l’adverbe καλῶς, lequel signifie de manière
convenable et efficace.
C’est la phase la plus délicate du travail que celle où la
prime coagulation de la pierre, onctueuse et légère, paraît à la surface et
flotte sur les eaux. Il faut alors redoubler de précaution et de prudence dans
l’application du feu, si l’on ne veut la rougir avant terme et la précipiter.
Elle se manifeste au début sous l’aspect d’une pellicule mince, très vite
rompue, dont les fragments détachés des bords se rétractent, puis se soudent,
s’épaississent, prennent la forme d’un îlot plat, — l’île du Cosmopolite et la
terre mythique de Délos, — animé de mouvements giratoires et soumis à de
continuels déplacements. Cette île n’est qu’une autre figure du poisson
hermétique, né de la mer des Sages, — notre mercure qu’Hermès appelle mare patens, — le pilote de l’Œuvre,
premier état solide de la pierre embryonnaire. Les uns l’ont nommé échénéis, les autres dauphin, avec autant de raison ; car si
l’échénéis passe, dans la légende, pour arrêter et fixer les plus forts
navires, le dauphin, dont on aperçoit la tête émerger dans notre bas-relief,
possède une signification aussi positive. Son nom grec, δελφίς, désigne la
matrice, et nul n’ignore que le mercure est appelé par les philosophes le
réceptacle et la matrice de la pierre.
Mais, afin que personne ne se méprenne, répétons encore
qu’il ne saurait être ici question du mercure vulgaire, quoique sa qualité
liquide puisse donner le change et en permettre l’assimilation à l’eau secrète,
humide radical métallique. Le puissant initié que fut Rabelais fournit, en
quelques mots, les caractéristiques véritables du mercure philosophal. [Ses
ouvrages sont signés du pseudonyme Alcofribas Nasier, anagramme de François
Rabelais, suivi du titre d’abstracteur de quintessence, lequel servait, au
moyen âge, à désigner dans le langage populaire les alchimistes du temps. Le
célèbre médecin et philosophe se déclare ainsi, sans conteste, Adepte et
Rose-Croix, et place ses écrits sous l’égide de l’Art sacré. D’ailleurs, dans
le Prologue de Gargantua, Rabelais
montre assez que son œuvre appartient à la catégorie des livres fermés,
hermétiques et acroamatiques, pour la compréhension desquels de fortes
connaissances symboliques sont absolument indispensables.]
Dans sa description du temple souterrain de la Dive
bouteille (Pantagruel, liv. V, ch.
XLII), il parle d’une fontaine circulaire qui en occupe le centre et la partie
la plus profonde. Autour de cette fontaine, se dressent sept colonnes « qui
sont pierres, dit l’auteur, par les antiques Chaldéens et mages attribuées aux
sept planètes du ciel. Pour laquelle chose par plus rude Minerve entendre, sus
la première de saphir estoit au dessus du chapiteau, à la vive et centrique
ligne perpendiculaire eslevée, en plomb elutian bien precieux, l’image de
Saturne tenant sa faux, ayant aux pieds une grue d’or artificiellement
esmaillée selon la competence des couleurs naïfvement deues à l’oiseau saturnin.
Sus la seconde de hyacinthe, tournant à gauche, estoit Jupiter en estain
jovietian, sus la poitrine un aigle d’or esmaillé selon le naturel. Sus la
troisiesme, Phœbus en or obrizé, en sa main dextre un coq blanc. Sus la
quatriesme, en airain corinthien, Mars, et à ses pieds un lion.
[L’attribution de l’airain à Mars prouve que Rabelais
connaissait parfaitement la correspondance alchimique des planètes et des
métaux. En grec, χαλκός, qui désigne le cuivre ou le bronze, était employé par
les anciens poètes helléniques pour définir non le cuivre ou l’un de ses
composés, mais bien le fer. L’auteur a donc raison de l’affecter à la planète
Mars. Quant à l’airain de Corinthe, Pline assure qu’il se présentait sous trois
aspects. Il avait tantôt l’éclat de l’argent, tantôt celui de l’or et pouvait
être le résultat d’un alliage en proportions à peu près équivalentes d’or,
d’argent et de cuivre. C’est ce dernier airain que l’on croyait avoir été
produit fortuitement par la fusion de métaux précieux et de cuivre, lors de
l’incendie de Corinthe par Mummius (146 av. J.-C.).]
Sus la cinquiesme, Venus en cuivre, de matiere pareille à
celle dont Aristonides fit la statue d’Athamas,… une colombe à ses pieds. Sus
la sixiesme, Mercure en hydrargyre fixe, maleables et immobile, à ses pieds une
cigogne… » Le texte est formel et ne peut prêter à confusion. Le mercure des
sages, tous les auteurs le certifient, se présente comme un corps d’aspect
métallique, de consistance solide, conséquemment immobile par rapport au
vif-argent, de volatilité médiocre au feu, susceptible enfin de se fixer
lui-même par simple coction en vase clos. Quant à la cigogne, que Rabelais
attribue au mercure, elle prend sa signification du mot grec πελαργός, cigogne,
formé de πελός, brun livide ou noir, et ἀργός, blanc, qui sont les deux
couleurs de l’oiseau et celles du mercure philosophique ; πελαργός désigne
encore un pot fait de terre blanche et noire, emblème du vase hermétique,
c’est-à-dire du mercure, dont l’eau, vivante et blanche, perd sa lumière, son
éclat, se mortifie et devient noire, en abandonnant son âme à l’embryon de la
pierre, qui naît de sa décomposition et se nourrit de ses cendres.
Afin de rendre témoignage que la fontaine du Vertbois fut
originairement consacrée à l’eau philosophique, mère de tous les métaux et base
de l’Art sacré, les Bénédictins de Saint-Martin-des-Champs firent sculpter, sur
la corniche servant de support au bas-relief, divers attributs relatifs à cette
liqueur fondamentale. Deux avirons et un caducée entre-croisés portent le
pétase d’Hermès, figuré sous l’aspect moderne d’un armet ailé, sur lequel
veille un petit chien. Quelques cordages, sortant de la visière, déploient
leurs spires sur les avirons et la verge ailée du dieu de l’Œuvre.
Le mot grec πλάτη, par lequel on désignait l’aviron, offre
simultanément le sens de vaisseau et celui de van. [En cabale phonétique, rame,
équivalent d’aviron, désigne également l’eau philosophale. Ῥάµα, mis pour ῥάσμα,
signifie aspersion, arrosement, rac. ῥέω, couler.] Ce dernier est une sorte de
coquille d’osier attribuée au mercure, et que les cabalistes écrivent vent. C’est pourquoi la Table d’Émeraude
dit allégoriquement, en parlant de la pierre, que « le vent l’a portée dans son
ventre ». Ce van n’est autre chose que la matrice, le vaisseau porteur de la
pierre, emblème du mercure et sujet principal de notre bas-relief. Quant au
caducée, c’est chose connue qu’il appartient en propre au messager des dieux,
avec le pétase ailé et les talonnières. Nous dirons seulement que le vocable
grec Κηρύκειον, caducée, rappelle par son étymologie le coq, Κῆρυξ, consacré à
Mercure comme annonciateur de la lumière. Tous ces symboles convergent, on le
voit, vers un seul et même objet, également indiqué par le petit chien, posé
sur la voûte de l’armet, dont le sens spécial (κράνος, tête, sommet) marque la
partie importante, en l’espèce le point culminant de l’art, la clef du
Grand-Œuvre. Noël, dans son Dictionnaire
de la Fable, écrit que « le chien était consacré à Mercure comme au plus
vigilant et au plus rusé de tous les dieux ». Suivant Pline, la chair des
jeunes chiens était réputée si pure qu’on l’offrait aux dieux en sacrifice, et
qu’on la servait dans les repas préparés pour eux. L’image du chien posé sur le
casque protecteur de la tête constitue, au surplus, un véritable rébus encore
applicable au mercure. C’est une traduction figurée du cynocéphale
(κυνοκέφαλος, qui a une tête de chien), forme mystique très vénérée des
Égyptiens, qui la donnèrent à quelques divinités supérieures, et
particulièrement au dieu Thot, lequel devint par la suite l’Hermès des Grecs,
le Trismégiste des philosophes, le Mercure des Latins.
Caisson 6 (pl. XXV). — Un dé à jouer est posé sur une petite
table de jardin ; au premier plan végètent trois plantes herbacées. Pour toute
enseigne, ce bas-relief porte l’adverbe latin :
En quelque manière,
c’est-à-dire d’une façon analogue, ce qui pourrait laisser croire que la
découverte de la pierre serait due au hasard, et qu’ainsi la connaissance du
Magistère resterait tributaire d’un heureux coup de dé. Mais nous savons
pertinemment que la science, véritable présent de Dieu, lumière spirituelle
obtenue par révélation, ne saurait être sujette à de tels aléas. Ce n’est pas
qu’on ne puisse trouver fortuitement, là comme ailleurs, le tour de main
qu’exige l’opération rebelle ; cependant, si l’alchimie se bornait à l’acquisition
d’une technique spéciale, de quelque artifice de laboratoire, elle se réduirait
à fort peu de chose et n’excéderait pas la valeur d’une simple formule. Or, la
science dépasse de beaucoup la fabrication synthétique des métaux précieux, et
la pierre philosophale elle-même n’est que le premier échelon positif
permettant à l’Adepte de s’élever jusqu’aux plus sublimes connaissances. En
demeurant même dans le domaine physique, qui est celui des manifestations
matérielles et des certitudes fondamentales, nous pouvons assurer que l’Œuvre
n’est point soumis à l’imprévu. Il a ses lois, ses principes, ses conditions,
ses agents secrets et résulte de trop d’actions combinées et d’influences
diverses pour obéir à l’empirisme. Il faut le découvrir, en comprendre le
processus, bien connaître ses causes et ses accidents avant de passer à son
exécution. Et quiconque ne le peut voir « en esprit » perd son temps et son
huile à le vouloir trouver par la pratique. « Le sage a ses yeux en sa tête,
dit l’Ecclésiaste (ch. II, 14), et l’insensé marche dans les ténèbres. »
Le dé à jouer a donc une autre signification ésotérique. Sa
figure, qui est celle du cube (κύβος, dé à jouer, cube), désigne la pierre
cubique ou taillée, notre pierre philosophale et la pierre angulaire de
l’Église. Mais, pour être régulièrement dressée, cette pierre demande trois
répétitions successives d’une même série de sept opérations, ce qui porte leur
totale à vingt et une. Ce nombre correspond exactement à la somme des points
marqués sur les six faces du dé, puisque en additionnant les six premiers
nombres on obtient 21. Et les trois séries de sept se retrouveront encore en
totalisant les mêmes nombres de points à boustrophédon :
Placés à l’intersection des côtés d’un hexagone inscrit, ces
chiffres traduiront le mouvement circulaire propre à l’interprétation d’une
autre figure, emblématique du Grand-Œuvre, celle du serpent Ouroboros, aut serpens qui caudam devoravit. En
tout cas, cette particularité arithmétique, en concordance parfaite avec le
travail, consacre l’attribution du cube ou du dé à l’expression symbolique de
notre quintessence minérale. C’est la table isiaque réalisée par le trône
cubique de la grande déesse.
Il suffit donc, analogiquement, de jeter trois fois le dé sur
la table, — ce qui équivaut, dans la pratique, à redissoudre trois fois la
pierre, — pour l’obtenir avec toutes ses qualités. Ce sont ces trois phases
végétatives que l’artiste a représentées ici par trois végétaux. Enfin, les
réitérations indispensables à la perfection du labeur hermétique fournissent la
raison du livre hiéroglyphique d’Abraham le Juif, composé, nous dit Flamel, de
trois fois sept feuillets. De même, un splendide manuscrit enluminé, exécuté au
début du XVIIIe siècle, renferme vingt et une figures peintes adaptées chacune
aux vingt et une opérations de l’Œuvre. [La
Génération et Opération du Grand-Œuvre, ms. de la bibl. du Palais des Arts,
à Lyon, n°88 (Delandine, 899), in-folio.]
V (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Deuxième série (pl. XXVII).
 |
| Planche XXVII |
Caisson 1. — D’épaisses nuées interceptent la lumière du
soleil et couvrent d’ombre une fleur agreste qu’accompagne la devise :
. REVERTERE . ET . REVERTAR .
Retourne, et je
reviendrai… Cette plante herbacée, toute fabuleuse, était nommée, par les
anciens, Baraas. On la trouvait, dit-on, sur les flancs du mont Liban,
au-dessus du chemin qui conduit à Damas (c’est-à-dire, cabalistiquement, au
mercure principe féminin : Δάμαρ, femme, épouse). On ne la voyait apparaître
qu’au mois de mai, lorsque le printemps ôte de la terre son linceul de neige.
Aussitôt la nuit venue, nous dit Noël, « cette plante
commence à s’enflammer et à rendre de la clarté comme un petit flambeau ; mais
aussitôt que le jour vient, cette lumière disparaît, et l’herbe devient
invisible ; les feuilles mêmes qu’on a enveloppées dans des mouchoirs ne s’y
trouvent plus, ce qui autorise l’opinion de ceux qui disent que cette plante
est obsédée des démons, parce qu’elle a aussi, selon eux, une propriété occulte
pour rompre les charmes et les sortilèges. D’autres assurent qu’elle est propre
à transmuer les métaux en or, et c’est pour cette raison que les Arabes
l’appellent l’herbe de l’or ; mais ils n’oseraient la cueillir, ni même
l’approcher, pour avoir, disent-ils, éprouvé plusieurs fois que cette plante
fait mourir subitement celui qui l’arrache de terre sans apporter les
précautions nécessaires, et, comme ils ignorent ces précautions, ils la
laissent sans y toucher. »
De ce petit sujet se dégage ésotériquement l’artifice de la
solution du soufre par le mercure, la plante exprimant la vertu végétative de
celui-ci, et le soleil la nature ignée de celui-là. L’opération est d’autant
plus importante qu’elle conduit à l’acquisition du mercure philosophique,
substance vivante, animée, issue du soufre pur radicalement uni à l’eau
primitive et céleste. Nous avons dit précédemment que le caractère extérieur,
permettant l’identification certaine de cette eau, est une figure étoilée et
rayonnante que la coagulation faisait apparaître à sa surface. Ajoutons que la
signature astrale du mercure, ainsi qu’il est d’usage de nommer l’empreinte en
question, s’affirme avec d’autant plus de netteté et de vigueur que l’animation
progresse et s’avère plus complète.
Or, les deux voies de l’Œuvre nécessitent deux manières
différentes d’opérer l’animation du mercure initial. La première appartient à
la voie courte et comporte une seule technique par laquelle on humecte peu à
peu le fixe, — car toute matière sèche boit avidement son humide, — jusqu’à ce
que l’affusion réitérée du volatil sur le corps fasse gonfler le composé et le
rende en masse pâteuse, ou sirupeuse selon le cas. La seconde méthode consiste
à digérer la totalité du soufre dans trois ou quatre fois son poids d’eau,
décanter ensuite la solution, puis dessécher le résidu et le reprendre avec une
quantité proportionnelle de nouveau mercure. Quand la dissolution est achevée,
on sépare les fèces, s’il y en a, et les liqueurs, rassemblées, sont soumises à
une lente distillation au bain. L’humidité superflue se trouve ainsi dégagée,
laissant le mercure dans la consistance requise, sans aucune perte de ses
qualités et prêt à subir la coction hermétique.
C’est cette seconde pratique qu’exprime symboliquement notre
bas-relief.
On comprend sans peine que l’étoile, — manifestation
extérieure du soleil interne, — se représente chaque fois qu’une nouvelle
portion de mercure vient baigner le soufre indissous, et qu’aussitôt celui-ci
cesse d’être visible pour reparaître à la décantation, c’est-à-dire au départ
de la matière astrale. « Retourne, dit le fixe, et je reviendrai. » À sept
reprises successives, les nuées dérobent aux regards tantôt l’étoile, tantôt la
fleur, selon les phases de l’opération, de sorte que l’artiste ne peut jamais,
au cours du travail, apercevoir simultanément les deux éléments du composé. Et
cette vérité se voit confirmée jusqu’à la fin de l’Œuvre, puisque la coction du
mercure philosophique, — autrement appelé astre ou étoile des sages, — le
transforme en soufre fixe, fruit de notre végétal emblématique, dont la semence
se trouve ainsi multipliée en qualité, en quantité et en vertu.
Caisson 2 (pl. XXVII). — Au centre de ce caisson, un fruit,
que l’on prend généralement pour une poire, mais qui peut, avec autant de vraisemblance,
être une pomme ou une grenade, prend sa signification de la légende sous
laquelle il figure :
. DIGNA . MERCES . LABORE .
Travail dignement récompensé. Ce fruit symbolique n’est
autre que la gemme hermétique, pierre philosophale du Grand-Œuvre ou Médecine
des anciens sages appelée encore Absolu, Petit Charbon ou Escarboucle précieuse
(carbunculus), le soleil brillant de notre microcosme et l’astre de l’éternelle
sapience.
Ce fruit est double, car on le cueille à la fois sur l’Arbre
de Vie, en le réservant spécialement aux usages thérapeutiques, et sur l’Arbre
de Science, si l’on préfère l’employer à la transmutation métallique. Ces deux
facultés correspondent à deux états d’un même produit, dont le premier
caractérise la pierre rouge, translucide et diaphane, destinée à la médecine en
qualité d’or potable, et le second, la pierre jaune, que son orientation
métallique et sa fermentation par l’or naturel ont rendue opaque. Pour cette
raison, De Cyrano Bergerac donne deux couleurs au fruit du Magistère dans sa
description de l’arbre emblématique au pied duquel il repose. « C’étoit,
écrit-il, une rase campagne, tellement découverte que ma vue, de sa plus longue
portée, n’y rencontroit pas seulement un buisson ; et cependant, à mon réveil,
je me trouvai sous un arbre, en comparaison de qui les plus hauts cèdres ne
paroîtroient que de l’herbe. Son tronc étoit d’or massif, ses rameaux d’argent
et ses feuilles d’émeraudes, qui, dessus l’éclatante verdeur de leur précieuse
superficie, se représentoient comme dans un miroir les images du fruit qui
pendoit alentour. Mais jugez si le fruit devoit rien aux feuilles ! L’écarlate
enflammée d’un gros escarboucle composoit la moitié de chacun, et l’autre étoit
en suspens si elle tenoit sa matière d’une chrysolithe ou d’un morceau d’ambre
doré ; les fleurs épanouies étoient des roses de diamant fort larges, et les
boutons de grosses perles en poire. » [De Cyrano Bergerac, L’Autre Monde. Histoire comique des États et Empires du Soleil.
Paris, Bauche, 1910, p. 42]
Selon son habileté, le soin, la prudence de l’artisan, le
fruit philosophique de l’arbor scientiæ témoigne
d’une vertu plus ou moins étendue. Car il est incontestable que la pierre
philosophale, employée à la transmutation des métaux, n’est jamais douée de la
même puissance. Les projections historiques nous en fournissent une preuve
certaine. Dans l’opération faite par J.-B. Van Helmont, dans son laboratoire de
Vilvorde, près Bruxelles, en 1618, la pierre transforma en or 18.740 fois son
poids de mercure coulant. Richtausen, à l’aide du produit remis par
Labujardière, obtint un résultat équivalent à 22.334 fois l’unité. La
projection que réalisa Sethon, en 1603, chez le marchand Coch, de
Francfort-sur-le-Mein, se fit sur une proportion égale à 1.155 fois. Au rapport
de Dippel, la poudre que Lascaris donna à Dierbach transmutait environ 600 fois
son poids de vif-argent. Cependant, une autre parcelle, fournie par Lascaris,
se montra plus efficace ; dans l’opération exécutée à Vienne, en 1716, en
présence du conseiller Pantzer de Hesse, du comte Charles-Ernest de Rappach, du
comte Joseph de Würben et de Freudentahl, des frères comte et baron de
Metternich, le coefficient atteignit une puissance voisine de dix mille. Au
surplus, il n’est pas inutile de savoir que le maximum de production est
réalisé par l’emploi du mercure, et qu’une même qualité de pierre fournit des
résultats variables selon la nature des métaux servant de base à la projection.
L’auteur des Lettres du Cosmopolite affirme que si une partie d’Élixir
convertit en or parfait mille parties de mercure ordinaire, elle transformera
seulement vingt parties de plomb, trente d’étain, cinquante de cuivre et cent
d’argent. Quant à la pierre au blanc, elle ne saurait, au même degré de
multiplication, agir que sur la moitié environ de ces quantités.
Mais, si les philosophes ont peu parlé du rendement variable
de la chrysopée, par contre ils se sont montrés fort prolixes sur les
propriétés médicales de l’Élixir, ainsi que sur les effets surprenants qu’il
permet d’obtenir dans le règne végétal.
« L’Élixir blanc, dit Batsdorff, fait merveille aux maladies
de tous les animaux et particulièrement à celles des femmes,… car c’est la
vraye lune potable des anciens. » [Batsdorff, Le Filet d’Ariadne, pour entrer avec seureté dans le Labirinthe de la
Philosophie Hermetique. Paris, Laurent d’Houry, 1695, p. 136.] L’auteur anonyme
de la Clef du Grand-Œuvre, reprenant
le texte de Batsdorff, assure que « cette médecine a d’autres vertus encore
plus incroyables. Quand elle est à l’Élixir au blanc, elle a tant de sympathie
avec les dames, qu’elle peut renouveler et rendre leur corps aussi robuste et
vigoureux qu’il étoit dans leur jeunesse… Pour cet effet, on prépare d’abord un
bain avec plusieurs herbes odoriférantes, dont elles doivent bien se frotter
pour se décrasser ; ensuite, elles entrent dans un second bain sans herbes, mais
dans lequel on a dissout, dans une chopine d’esprit de vin, trois grains de
l’Élixir au blanc, qu’on a ensuite jeté dans l’eau. Elles restent un quart
d’heure dans ce bain ; après quoi, sans s’essuyer, on fait préparer un grand
feu pour faire sécher cette précieuse liqueur. Elles se sentent alors si fortes
en elles-mêmes, et leur corps est rendu si blanc qu’elles ne pourroient pas se
l’imaginer sans l’avoir expérimenté. Notre bon père Hermès demeure d’accord de
cette opération, mais il veut, outre ces bains, qu’on prenne en même temps,
pendant sept jours de suite, intérieurement de cet Élixir ; et il ajoute : si
une dame fait la même chose tous les ans, elle vivra exempte de toutes les
maladies auxquelles sont sujettes les autres dames, sans en ressentir aucune
incommodité. » [La Clef du Grand-Œuvre,
ou Lettres du Sancelrien Tourangeau. Paris, Cailleau, 1777, p. 54.]
Huginus a Barma certifie que « la pierre fermentée avec de
l’or peut être employée dans la médecine de cette manière : on en prendra un
scrupule ou vingt-quatre grains, que l’on résoudra selon l’art dans deux onces
d’esprit de vin, et on en donnera depuis deux ou trois jusqu’à quatre gouttes,
suivant l’exigence de la maladie, dans un peu de vin ou quelque autre véhicule
convenable ». [Huginus a Barma, Le Règne
de Saturne changé en Siècle d’Or. Paris, Pierre Derieu, 1780, p. 190.] Au
rapport des vieux auteurs, toutes les affections seraient radicalement guéries
en un jour pour celles qui datent d’un mois ; en douze jours si elles sont
vieilles d’un an ; en un mois si leur origine remonte au-delà d’une année.
Mais en cela, comme en beaucoup d’autres choses, il faut
savoir se prémunir contre les excès de l’imagination ; trop enthousiaste,
l’auteur de La Clef du Grand-Œuvre voit des merveilles jusque dans dissolution
spiritueuse de la pierre : « il en doit sortir, prétend cet écrivain, des
étincelles ardentes dorées, et paroître dans le vase une infinité de couleurs
». C’est aller un peu loin dans la description de phénomènes qu’aucun
philosophe ne signale. D’ailleurs, il ne reconnaît pas de bornes aux vertus de
l’Élixir : « la lèpre, la goutte, la paralysie, la pierre, le mal caduc,
l’hydropisie… ne sauroient résister à la vertu de cette médecine. » Et comme la
guérison de ces maux réputés incurables ne lui semble pas suffisante, il
s’empresse d’y ajouter des propriétés plus admirables encore. « Cette médecine
fait entendre les sourds, voir les aveugles, parler les muets, marcher les
boiteux ; elle peut renouveler l’homme en entier, en lui faisant changer la
peau, tomber les vieilles dents, les ongles et les cheveux blancs, à la place
desquels elle en fait croître de nouveaux, selon la couleur que l’on désire. »
Nous versons ainsi dans l’humour et la bouffonnerie.
À en croire la majorité des sages, la pierre peut donner
d’excellents résultats dans le règne végétal, en particulier pour les arbres
fruitiers. Au printemps, si l’on arrose le sol près de leurs racines avec une
solution d’Élixir largement étendue d’eau de pluie, on les rend plus résistants
à toutes les causes de dépérissement et de stérilité. Ils produisent davantage
et portent des fruits sains et savoureux. Batsdorff va même jusqu’à dire qu’il
serait possible, en utilisant ce procédé, de cultiver des végétaux exotiques
sous notre latitude. « Les plantes délicates, écrit-il, qui ont de la peine à
venir dans les climats d’un tempérament contraire à celui qui leur est naturel,
en étant arrosées, deviennent aussi vigoureuses que si elles étoient dans leur
terroir et solage propre et ordonné de la nature. »
Parmi les autres propriétés merveilleuses attribuées à la
pierre philosophale, de très vieux auteurs citent maints exemples de
transformation du cristal en rubis et du quartz en diamant, à l’aide d’une
sorte de trempe progressive. Ils envisagent même la possibilité de rendre le
verre ductile et malléable, ce que, malgré l’affirmation de Cyliani, nous nous
garderons bien de certifier, car la manière d’agir propre à l’Élixir, —
contraction et durcissement, — semble contraire à l’obtention d’un semblable
effet. [« Je ne décrirai point ici des opérations très-curieuses que j’ai
faites, à mon grand étonnement, dans les règnes végétal et animal, ainsi que le
moyen de faire le verre malléable, des perles et des pierres précieuses plus
belles que la celles de la nature… ne voulant point être parjure et paraître
ici passer les bornes de l’esprit humain. » Cyliani, Hermès dévoilé.]
Quoiqu’il en soit, Christophe Merret cite cette opinion et
en parle ainsi dans la Préface de son traité : « Pour ce qui est de la
malléabilité du verre, dit-il, sur laquelle les alchymistes fondent la
possibilité de leur Élixir, elle paroît appuyée, mais peu solidement, sur le
passage suivant de Pline, liv. XXXVI, ch. XXVI : « On assure que du temps de
Tibère, on trouva un moyen de rendre le verre flexible, et que tout l’atelier
de l’ouvrier qui en étoit l’inventeur fut détruit, de peur que cette découverte
n’ôtât le prix à l’or, à l’argent et au cuivre. Mais ce bruit, quoique assez
répandu, n’en est pas plus certain. »
« D’autres auteurs ont raconté le même fait, après Pline,
mais avec quelques circonstances différentes. Dion Cassius, liv. LVII, dit : «
Dans le temps que le grand Portique vint à pencher, un architecte dont on
ignore le nom (parce que la jalousie de l’empereur empêcha qu’on ne le mît dans
les registres), le redressa et en raffermit les fondemens. Tibère, après
l’avoir payé, le bannit de Rome. Cet ouvrier revint sous prétexte de demander
grâce à l’empereur, et laissa tomber en sa présence un verre qui se bossua, et
qu’il raccommoda sur-le-champ avec ses mains, espérant obtenir ainsi ce qu’il
demandoit, mais il fut condamné à la mort. » Isidore confirme la même chose ;
il ajoute seulement que l’empereur, indigné, jetta le verre sur le pavé, mais
que l’ouvrier ayant tiré un marteau et l’ayant raccomodé, Tibère lui demanda
s’il y avoit encore quelqu’un qui sçût ce secret, et que l’ouvrier ayant assuré
par serment que personne que lui ne le possédoit, l’empereur lui fit couper la
tête de peur que, s’il se divulguoit, il ne fît tomber l’or dans le mépris, et
n’ôtât aux métaux leur valeur. » [Néri, Merret et Kunckel, L’Art de la Verrerie. Paris, Durand et Pissot, 1752.]
En faisant la part de l’exagération et des apports
légendaires, il n’en reste pas moins vrai que le fruit hermétique porte en soi
la plus haute récompense que Dieu, par l’entremise de la nature, puisse
accorder ici-bas aux hommes de bonne volonté.
Caisson 3 (pl. XXVII). — L’effigie du serpent Ouroboros se
dresse sur le chapiteau d’une élégante colonne. Ce curieux bas-relief est
distingué par l’axiome :
Traduction latine de l’inscription grecque qui figurait au
fronton du célèbre temple de Delphes :
Connais-toi toi-même…
Nous avons déjà rencontré, sur quelques manuscrits anciens, une paraphrase de
cette maxime ainsi conçue : « Vous qui voulés connoistre la pierre, connoissés
vous bien et vous la connoistrés. » Telle est l’affirmation de la loi
analogique qui donne, en effet, la clef du mystère. Or, ce qui caractérise
précisément notre figure, c’est que la colonne chargée de supporter le serpent
emblématique, se trouve renversée par rapport au sens de l’inscription.
Disposition voulue, réfléchie, préméditée, donnant à l’ensemble l’apparence
d’une clef et celle du signe graphique à l’aide duquel les anciens avaient
coutume de noter leur mercure. Clef et colonne de l’Œuvre sont d’ailleurs des
épithètes appliquées au mercure, car c’est en lui que les éléments s’assemblent
dans leur proportion convenable et leur qualité naturelle ; c’est de lui que
tout provient, parce que, seul, il a le pouvoir de dissoudre, mortifier et
détruire les corps, de les dissocier, d’en séparer les portions pures, de les
joindre aux esprits et de générer ainsi de nouveaux êtres métalliques
différents de leurs parents. Les auteurs ont donc raison d’affirmer que tout ce
que cherchent les sages se peut trouver dans le seul mercure, et c’est ce qui
doit porter l’alchimiste à diriger ses efforts vers l’acquisition de ce corps
indispensable.
Mais, afin d’y parvenir, nous lui conseillons d’agir avec
méthode en étudiant, de façon simple et rationnelle, la manière dont la nature
opère, chez les êtres vivants, pour transformer les aliments absorbés,
débarrassés par la digestion des substances inutiles, en sang noir, puis en
sang rouge, générateur de tissus organiques et d’énergie vitale. Nosce te ipsum. Il reconnaîtra ainsi que
les producteurs minéraux du mercure, qui sont également les artisans de sa
nutrition, de son accroissement et de sa vie, doivent d’abord être choisis avec
discernement et travaillés avec soin. Car, bien que, théoriquement, tous
puissent servir à cette composition, certains néanmoins sont trop éloignés de la
nature métallique active pour nous être véritablement utiles, soit à cause de
leur impuretés, soit parce que leur maturation fut arrêtée ou poussée au delà
du terme requis. Les roches, les pierres, les métalloïdes appartiennent à la
première catégorie ; l’or et l’argent entrent dans la seconde. Aux métalloïdes,
l’agent que nous réclamons manque de vigueur, et sa débilité ne nous saurait
être d’aucun secours ; dans l’or et l’argent, au contraire, on l’y chercherait
en vain : la nature l’a séparé des corps parfaits lors de leur apparition sur
le plan physique.
En énonçant cette vérité, nous ne voulons pas dire qu’il
faille absolument proscrire l’or et l’argent, ni prétendre que ces métaux sont
exclus de l’Œuvre par les maîtres de la science. Mais nous prévenons
fraternellement le disciple qu’il n’entre ni or ni argent, même modifiés, dans
la composition du mercure. Et si l’on découvrait, dans les auteurs classiques,
quelque assertion contraire, on devrait croire que l’Adepte entend parler,
comme Philalèthe, Basile Valentin, Nicolas Flamel et le Trévisan, de l’or ou de
l’argent philosophiques, et non pas des métaux précieux avec lesquels ils n’ont
et ne présentent rien de commun.
Caisson 4 (pl. XXVII). — Posée sur le fond d’un boisseau
renversé, une chandelle brûle. Ce motif rustique a pour épigraphe :
. SIC . LVCEAT . LVX . VESTRA .
Que votre lumière
brille ainsi… La flamme indique pour nous l’esprit métallique, qui est la
plus pure, la plus claire partie du corps, son âme et sa lumière propres, bien
que cette partie essentielle soit la moindre, eu égard à la quantité. Nous
avons dit souvent que la qualité de l’esprit, étant aérienne et volatile,
l’oblige toujours à s’élever, et que sa nature est de briller, dès qu’il se
trouve séparé de l’opacité grossière et corporelle qui l’enrobe. Il est écrit
qu’on n’allume point une chandelle pour la mettre sous le boisseau, mais bien
sur un chandelier, afin qu’elle puisse éclairer tout ce qui l’environne.
[Matthieu, ch. V, 15 ; Marc, ch. IV, 21 ; Luc, ch. VIII, 16.]
De même, voyons-nous, dans l’Œuvre, la nécessité de rendre
manifeste ce feu interne, cette lumière ou cette âme, invisible sous la dure
écorce de la matière grave. L’opération qui servit aux vieux philosophes à
réaliser ce dessein, fut nommée par eux sublimation, bien qu’elle n’offre qu’un
rapport éloigné avec la sublimation ordinaire des spagyristes. Car l’esprit,
prompt à se dégager dès qu’on lui en fournit les moyens, ne peut, toutefois,
abandonner complètement le corps ; mais il se fait un vêtement plus proche de
sa nature, plus souple à sa volonté, des particules nettes et mondées qu’il
peut récolter autour de soi, afin de s’en servir comme véhicule nouveau. Il
gagne alors la surface externe de la substance brassée et continue de se
mouvoir sur les eaux, ainsi qu’il est dit dans la Genèse (ch. I, 2), jusqu’à ce
que la lumière paraisse. C’est alors qu’il prend, en se coagulant, une couleur
blanche éclatante, et que sa séparation de la masse en est rendue très facile,
puisque la lumière s’est, d’elle-même, placée sur le boisseau, laissant à
l’artiste le soin de la recueillir.
Apprenons encore, pour que l’étudiant ne puisse rien ignorer
de la pratique, que cette séparation, ou sublimation du corps et manifestation
de l’esprit, doit se faire progressivement et qu’il faut la réitérer autant de
fois qu’on le jugera expédient. Chacune de ces réitérations prend le nom
d’aigle, et Philalèthe nous affirme que la cinquième aigle résout la lune, mais
qu’il est nécessaire d’en employer de sept à neuf pour atteindre à la splendeur
caractéristique du soleil. Le mot grec αἴγλη, d’où les sages ont tiré leur
terme d’aigle, signifie éclat, vive clarté, lumière, flambeau. Faire voler
l’aigle, suivant l’expression hermétique, c’est faire briller la lumière en la
découvrant de son enveloppe obscure et en la portant à la surface. Mais nous
ajouterons que, contrairement à la sublimation chimique, l’esprit étant en
petite quantité par rapport au corps, notre opération fournit peu du principe
vivifiant et organisateur dont nous avons besoin. Ainsi, selon le conseil du
philosophe de Dampierre, l’artiste prudent devra s’efforcer de rendre l’occulte
manifeste, et de faire que « ce qui est dessous soit dessus », s’il désire voir
la lumière métallique interne irradier à l’extérieur.
Caisson 5 (pl. XXVII). — Une banderole mouvante accusait
ici le sens symbolique d’un dessin aujourd’hui disparu. Si nous en croyons l’Epigraphie Santone, celui-ci figurait
« une main tenant une pique ». Il n’en reste rien actuellement que le
phylactère et son inscription, amputée des deux dernières lettres :
. NON . SON . TALES . NVS . AMOR(ES) .
Ce ne sont pas là nos
amours… Mais cette phrase espagnole, solitaire, au sens vague, ne permet
guère de commentaire sérieux. Plutôt que répandre une version erronée, nous
préférons garder le silence sur ce motif incomplet.
Caisson 6 (pl. XXVII). — Les raisons d’impossibilité
évoquées pour le précédent bas-relief sont également valables pour celui-ci. Un
petit quadrupède, que l’état lépreux du calcaire ne permet pas d’identifier,
paraît enfermé dans une cage d’oiseau. Ce motif a beaucoup souffert. De sa
devise, on lit à peine deux mots :
appartenant à cette phrase conservée par quelques auteurs :
. AMPANSA . LIBERTA . VERA . CAPI . INTVS .
Voilà où mène l’abus
de la liberté... Il est vraisemblablement question, en ce sujet, de
l’esprit, d’abord libre, puis emprisonné à l’intérieur du corps comme en une
cage très forte. Mais il semble évident aussi que l’animal, tenant la place
ordinaire d’un oiseau, apportait, par son nom ou par son espèce, une
signification spéciale, précise, facile à situer dans le travail. Ces éléments,
indispensables pour l’interprétation exacte, nous faisant défaut, force nous
est de passer au caisson suivant.
Caisson 7 (pl. XXVII). — Gisante sur le sol, une lanterne
décrochée dont le portillon s’entr’ouvre montre sa chandelle éteinte. Le
phylactère qui signe ce sujet contient un avertissement à l’usage de l’artiste
impatient et versatile :
. SIC . PERIT . INCO(N)STANS .
Ainsi périt
l’inconstant... Comme la lanterne sans lumière, sa foi cesse de briller :
aisément vaincu, incapable de réagir, il tombe et cherche vainement, dans les
ténèbres qui l’environnent, cette clarté qu’on ne saurait trouver qu’en
soi-même.
Mais, si l’inscription n’offre rien d’équivoque, l’image, en
revanche, est beaucoup moins transparente. Cela provient de ce que
l’interprétation peut en être donnée de deux façons, eu égard à la méthode
employée ainsi qu’à la voie suivie. Nous y découvrons d’abord une allusion au feu de roue, lequel, sous peine d’arrêt
entraînant la perte consécutive des matières, ne saurait cesser un seul instant
son action. Déjà, dans la voie longue, un ralentissement de son énergie,
l’abaissement de la température sont des accidents préjudiciables à la marche
régulière de l’opération ; car, si rien n’est perdu, le temps, déja
considérable, s’en trouve encore augmenté. Un excès de feu gâte tout ;
cependant, si l’amalgame philosophique est simplement rougi, et non calciné, il
est possible de le régénérer en le dissolvant de nouveau, selon le conseil du
Cosmopolite, et en reprenant la coction avec plus de prudence. Mais
l’extinction complète du foyer cause irrémédiablement la ruine du contenu,
quoique celui-ci, à l’analyse, ne paraisse pas avoir subi de modification.
Aussi, pendant le cours entier du travail, doit-on se souvenir de l’axiome
hermétique rapporté par Linthaut, lequel enseigne que « l’or, résout une fois
en esprit, s’il sent le froid, se perd avec tout l’Œuvre ». N’activez donc pas
trop la flamme à l’intérieur de votre lanterne, et veillez à ne point la
laisser s’éteindre : vous tomberiez de Charybde en Scylla.
Appliqué à la voie courte, le symbole de la lanterne nous
fournit une autre explication de l’un des points essentiels du Grand-Œuvre. Ce
n’est plus le feu élémentaire, mais le feu potentiel, — flamme secrète de la
matière même, — que les auteurs dérobent au profane sous cette image familière.
Quel est donc ce feu mystérieux, naturel, inconnu, que l’artiste doit savoir introduire
dans son sujet ? C’est là une question qu’aucun philosophe n’a voulu résoudre,
même en réclamant le secours de l’allégorie. Artephius et Pontanus en parlent
si obscurément que cette chose importante reste incompréhensible ou passe
inapercue. Limojon de Saint-Didier assure que ce feu est de la nature de la
chaux. Basile Valentin, ordinairement plus prolixe, se contente d’écrire : «
Allume ta lampe et cherche la dragme perdue. » Trismosin n’est guère plus clair
: « Fais, dit-il, un feu dans ton verre, ou dans la terre qui le tient enfermé.
» La plupart des autres désignent cette lumière interne, cachée dans les
ténèbres de la substance, sous l’épithète de feu de lampe. Batsdorff décrit la lampe philosophique comme devant
toujours être abondamment pourvue d’huile, et sa flamme alimentée par
l’intermédiaire d’une mèche d’asbeste. Or, le grec ἄσβεστος signifie
inextinguible, de durée illimitée, infatigable, inépuisable, qualités
attribuées à notre feu secret, lequel, dit Basile Valentin, « ne brûle pas et
n’est pas brûlé ». Quant à la lampe, nous la retrouvons dans le mot grec
λαμπτήρ, lanterne, torche, flambeau, qui désignait le vase à feu où l’on
brûlait le bois pour s’éclairer. Tel est bien notre vase, dispensateur du feu
des sages, c’est-à-dire notre matière et son esprit, ou, pour tout dire, la
lanterne hermétique. Enfin, un terme voisin de λαμπάς, lampe, le vocable λάμπη,
exprime tout ce qui monte et vient à la surface, écume, mousse, scorie, etc. Et
cela indique, pour qui possède quelque teinture de science, la nature du corps,
ou, si l’on préfère, de l’enveloppe minérale contenant ce feu de lampe qui n’a
besoin que d’être excité par le feu ordinaire pour opérer les plus surprenantes
métamorphoses.
Un mot encore à l’adresse de nos frères. Hermès, dans sa
Table d’Émeraude, prononce ces paroles graves, véritables et conséquentes : «
Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais, doucement, avec grande
industrie. Il monte de la terre au ciel, et redescend du ciel en terre, et
reçoit ainsi la vertu des choses supérieures et celles des choses inférieures.
» Remarquez donc que le philosophe recommande de séparer, de diviser, non de
détruire, ni de sacrifier l’un pour conserver l’autre. Car s’il devait en être
ainsi, nous vous le demandons, de quel corps s’élèverait l’esprit, et dans
quelle terre le feu redescendrait-il ?
Pontanus affirme que toutes les superfluités de la pierre se
convertissent, sous l’action du feu, en une essence unique, et qu’en
conséquence celui qui prétend en séparer la moindre chose n’entend rien à notre
philosophie.
Caisson 8 (pl. XXVII). — Deux vases, l’un en forme de buire
repoussée et ciselée, l’autre, vulgaire pot de terre, sont figurés dans un même
encadrement qu’occupe cette parole de saint Paul :
. ALIVD . VAS . IN . HONOREM . ALIVD . IN . CONTVMELIAM .
Un vaisseau pour des
usages honorables, un autre pour de vils emplois... « Dans une grande
maison, dit l’Apôtre, il n’y a pas seulement des vaisseaux d’or et d’argent, il
y en a aussi de bois et de terre ; les uns sont réservés aux usages honorables,
et les autres aux usages vils. » [Second
Épître de saint Paul à Timothée, ch II, 20.]
Nos deux vases apparaissent donc bien définis, nettement
distingués, et en concordance absolue avec les préceptes de la théorie
hermétique. L’un est le vase de la nature, fait de la même argile rouge qui
servit à Dieu pour former le corps d’Adam ; l’autre est le vase de l’art, dont
toute la matière est composée d’or pur, clair, rouge, incombustible, fixe,
diaphane et d’incomparable éclat. Et ce sont là nos deux vaisseaux, lesquels ne
représentent véritablement que deux corps distincts contenant les esprits
métalliques, seuls agents dont nous ayons besoin.
Si le lecteur est au fait de la manière d’écrire des
philosophes, — manière traditionnelle que nous cherchons à bien imiter, afin
qu’on puisse expliquer les anciens par nous et nous contrôler par eux, — il lui
sera facile de comprendre ce que les hermétistes entendent par leurs vaisseaux.
Car ceux-ci ne figurent pas seulement deux matières, — ou plutôt une même
matière à deux états de son évolution, — mais ils symbolisent encore nos deux
voies, basées sur l’emploi de ces corps différents.
La première de ces voies, qui utilise le vase de l’art, est
longue, laborieuse, ingrate, accessible aux personnes fortunées, mais en grand
honneur, malgré la dépense qu’elle nécessite, parce que c’est elle que les
auteurs décrivent de préférence. Elle sert de support à leur raisonnement,
comme au développement théorique de l’Œuvre, exige un travail ininterrompu de
douze à dix-huit mois, et part de l’or naturel préparé, dissous dans le mercure
philosophique, lequel se cuit ensuite en matras de verre. C’est là le vase
honorable, réservé au noble usage de ces substances très précieuses, qui sont
l’or exalté et le mercure des sages.
La seconde voie ne réclame, du commencement à la fin, que le
secours d’une terre vile, abondamment répandue, de si bas prix qu’à notre
époque dix francs suffisent pour en acquérir une quantité supérieure aux
besoins. C’est la terre et la voie des pauvres, des simples et des modestes, de
ceux que la nature émerveille jusqu’en ses plus humbles manifestations. D’une
extrême facilité, elle ne demande que la présence de l’artiste, car le
mystérieux labeur se parfait de lui-même et se parachève en sept ou neuf jours
au plus. Cette voie, ignorée de la majorité des alchimistes pratiquants, s’élabore
entièrement dans un seul creuset de terre réfractaire. C’est elle que les
grands maîtres nomment un travail de
femme et un jeu d’enfant ; c’est à elle qu’ils appliquent le vieil axiome
hermétique : una re, una via, una
dispositione. Une seule matière, un seul vaisseau, un seul fourneau. Tel
est notre vase de terre, vase méprisé, vulgaire et d’emploi commun, « que tout
le monde a devant les yeux, qui ne coûte rien et se trouve chez toutes gens,
mais que personne toutefois ne peut connaître sans révélation ».
Caisson 9 (pl. XXVII). — Coupé par le milieu, un serpent,
malgré le caractère mortel de sa blessure, croit cependant pouvoir vivre longtemps
en cet état.
. DVM . SPIRO . SPERABO .
lui fait-on dire. Tant
que je respire, j’espère.
Le serpent, image du mercure, exprime, par ses deux
tronçons, les deux parties du métal dissous, que l’on fixera plus tard l’une
par l’autre, et de l’assemblage desquelles il prendra sa nature nouvelle, son
individualité physique, son efficacité.
Car le soufre et le mercure des métaux, extraits et isolés
sous l’énergie désagrégeante de notre premier agent, ou dissolvant secret, se
réduisent d’eux-mêmes, par simple contact, en forme d’huile visqueuse,
onctuosité grasse et coagulable, que les anciens ont appelée humide radical
métallique et mercure des sages. D’où il ressort que cette liqueur, malgré son
apparente homogénéité, est réellement composée des deux éléments fondamentaux
de tous les corps métalliques, et qu’elle peut être considérée logiquement
comme représentant un métal liquéfié et réincrudé, c’est-à-dire
artificiellement remis en un état voisin de sa forme originelle. Mais ces
éléments, se trouvant simplement associés et non radicalement unis, il semble
raisonnable que notre symboliste ait songé à figurer le mercure sous l’aspect
d’un reptile sectionné, dont les deux parts conservent chacune leur activité,
leurs vertus réciproques. Et c’est là ce qui justifie l’exclamation de
confiance fixée sur l’emblème lapidaire : tant
que je respire, j’espère. En cet état de simple mélange, le mercure
philosophique conserve l’équilibre, la stabilité, l’énergie de ses
constituants, quoique ceux-ci soient voués cependant à la mortification, à la
décomposition qui préparent et réalisent leur interpénétration mutuelle et
parfaite. Aussi, tant que le mercure n’a pas éprouvé l’étreinte du médiateur
igné, est-il possible de le conserver indéfiniment, pourvu qu’on ait soin de le
soustraire à l’action combinée de l’air et de la lumière. C’est ce que certains
auteurs donnent à entendre, lorsqu’ils assurent que « le mercure philosophique
garde toujours ses excellentes qualités s’il est tenu en flacon bien bouché » ;
et l’on sait qu’en langage alchimique tout récipient quelconque est dit bouché,
couvert, obturé ou luté, lorsqu’il est maintenu dans une obscurité complète.
VI (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Troisième série (pl. XXVIII).
 |
| Planche XXVIII |
Caisson 1. — Dressée sur son bâti, et plongeant à demi dans
l’auget, une meule de grès n’attend plus que le rémouleur pour la mettre en
action. Toutefois, l’épigraphe de ce sujet, qui devrait en souligner la
signification, semble, au contraire, ne présenter aucun rapport avec lui ; et
c’est avec une certaine surprise qu’on y lit cette inscription singulière :
. DISCIPVLVS . POTIOR . MAGISTRO .
L’élève est-il
supérieur au maître ?
On conviendra sans peine qu’il n’est guère besoin d’un
apprentissage sérieux pour faire tourner une meule, et nous n’avons jamais
entendu dire que le plus habile des gagne-petit, sur son engin rudimentaire,
eût acquis des droits à la célébrité. Pour utile et honorable qu’il soit, le
métier du rémouleur ne réclame point l’apport de dons innés, de connaissances
spéciales, de technique rare ni du moindre brevet de maîtrise. Il est donc
certain que l’inscription et l’image ont un autre sens, nettement ésotérique,
dont nous allons fournir l’interprétation.
[Nous ne blâmerons jamais assez ceux-là qui, cachés et
tout-puissants, décidèrent, à Paris, l’inexplicable destruction de la très
vieille rue des Nonnains-d’Hyères, laquelle ne s’opposait en rien à la
salubrité et offrait la remarquable harmonie de ses façades du XVIIIe siècle.
Ce vandalisme, perpétré sur une grande échelle, a entraîné la perte de
l’enseigne curieuse qui ornait, à la hauteur du premier étage, l’immeuble sus
au n° 5, à l’angle de l’étroite rue de l’Hôtel-de-Ville, jadis de la
mortellerie. Dégagé de la pierre, en ronde bosse, le motif, de grandes
dimensions, qui avait gardé ses couleurs d’origine, montrait un rémouleur, dans
son costume d’époque : tricorne noir, redingotte rouge, et bas blancs. L’homme
s’appliquait à aiguiser le fer, devant sa robuste brouette, mettant en activité
les deux éléments majeurs, c’est-à-dire le feu caché de sa meule et l’eau rare
qu’un gros sabot semblait dispenser en mince filet.]
Considérée dans ses emplois divers, la meule est l’un des
emblèmes philosophiques chargés d’exprimer le dissolvant hermétique, ou ce premier
mercure sans lequel il est tout à fait inutile d’entreprendre ni d’espérer rien
de profitable. C’est lui notre seule matière capable d’évertuer, d’animer et de
revivifier les métaux usuels, parce que ceux-ci se résolvent facilement en
elle, s’y divisent et s’y adaptent sous l’effet d’une mystérieuse affinité. Et,
quoique ce primitif sujet ne présente pas les qualités ni la puissance du
mercure philosophique, il possède néanmoins tout ce qu’il lui faut pour le
devenir, et il le devient, en effet, pourvu qu’on lui ajoute seulement la
semence métallique qui lui manque. L’art vient ainsi secourir la nature, en
permettant à cette habile et merveilleuse ouvrière de parfaire ce que, faute de
moyens, de matériaux ou de circonstances favorables, elle avait dû laisser
inachevé. Or, ce mercure initial, sujet de l’art et notre vrai dissolvant, est
précisément la substance que les philosophes nomment l’unique matrice, la mère de l’Œuvre ; sans elle, il nous serait
impossible de réaliser la décomposition préalable des métaux, ni, par suite,
d’obtenir l’humide radical ou mercure des sages, qui est véritablement la
pierre des philosophes. De sorte que ceux-là sont dans la vérité, qui prétendent
faire le mercure ou la pierre avec tous les métaux, aussi bien que ceux qui
soutiennent l’unité de la matière première et la mentionnent comme la seule
chose nécessaire.
Ce n’est pas au hasard que les hermétistes ont choisi la
meule pour signe hiéroglyphique du sujet, et notre Adepte a certainement obéi
aux mêmes traditions en lui donnant une place dans les caissons de Dampierre.
On sait que les meules ont une forme circulaire, et que le cercle est la
signature conventionnelle de notre dissolvant, ainsi d’ailleurs que tous les
corps susceptibles d’évoluer par rotation ignée. Nous retrouvons le mercure,
indiqué de cette façon, sur trois planches de l’Art du Potier, c’est-à-dire
sous l’aspect d’une meule de moulin, tantôt mue par un mulet, — image cabalistique
du mot grec μύλη, meule, — tantôt par un esclave ou un personnage de condition,
vêtu à l’instar d’un prince. [Cyprian Piccolpassi. Les Trois Libvres de l’Art du Potier, translatés de l’Italien en langue
françoyse par Maistre Claudius Popelyn, Parisien. Paris, Librairie
Internationale, 1861.] Ces gravures traduisent le double pouvoir du dissolvant
naturel, lequel agit sur les métaux comme la meulière sur le grain ou le grès
sur l’acier : il les divise, les broie, les aiguise. À telle enseigne qu’après
les avoir dissociés et partiellement digérés, il s’en trouve acidifié, prend
une vertu caustique et devient plus pénétrant qu’il ne l’était auparavant.
Les alchimistes du moyen âge se servaient du verbe acuer pour exprimer l’opération qui
donne au dissolvant ses propriétés incisives. Or, acuer vient du latin acuo,
aiguiser, affiler, rendre tranchant et pénétrant, ce qui correspond non
seulement à la nature nouvelle du sujet, mais concorde également avec le rôle
de la meule à aiguiser.
De cet ouvrage, quel est le maître ? Evidemment, celui qui
aiguise et qui fait tourner la meule, — ce rémouleur absent du bas-relief, —
c’est-à-dire le soufre actif du métal dissous. Quant au disciple, il représente
le premier mercure, de qualité froide et passive, que certains dénomment fidèle et loyal serviteur, et d’autres,
eu égard à sa volatilité, servus
fugitivus, l’esclave fugitif. On peut donc répondre à la question du
philosophe, qu’étant donné la différence même de leurs conditions, jamais
l’élève ne pourra s’élever au-dessus du maître ; mais on peut assurer, d’autre
part, qu’avec le temps le disciple, passé maître à son tour, deviendra l’alter
ego de son précepteur. Car si le maître s’abaisse jusqu’au niveau de son
inférieur dans la dissolution, il l’élèvera avec lui dans la coagulation, et la
fixation les rendra semblables l’un à l’autre, égaux en vertu, en valeur et en
puissance.
Caisson 2 (pl. XXVIII). — La tête de Méduse, posée sur un
socle, montre son rictus sévère et sa chevelure entrelacée de serpents ; elle est
ornée de l’inscription latine :
. CVSTOS . RERVM . PRVDENTIA .
La prudence est la
gardienne des choses... Mais le mot prudentia
a une signification plus étendue que prudence ou prévoyance ; il désigne encore
la science, la sagesse, l’expérience, la connaissance. Epigramme et figure
s’accordent à représenter, dans ce bas-relief, la science secrète dissimulée
sous les hiéroglyphes multiples et variés des caissons de Dampierre.
En effet, le nom grec Μέδοισα, Méduse, a pour racine μῆδος
et exprime la pensée dont on s’occupe, l’étude favorite ; μῆδος a formé
μηδοσύνη, dont le sens évoque la prudence et la sagesse. D’autre part, les
mythologues nous enseignent que Méduse était connue des Grecs sous le nom de
Γοργώ, c’est-à-dire la Gorgone, lequel servait aussi à qualifier Minerve ou
Pallas, déesse de la Sagesse. Peut-être découvrirait-on, dans ce rapprochement,
la raison secrète de l’égide, bouclier de Minerve, recouvert de la peau
d’Amalthée, chèvre nourrice de Jupiter, et décoré du masque de Méduse Ophiotrix.
Outre le rapprochement que l’on peut établir entre la chèvre et le bélier, —
celui-ci porteur de la toison d’or, celle-là pourvue de la corne d’abondance, —
nous savons que l’attribut d’Athèné avait le pouvoir pétrifiant. Méduse,
dit-on, changeait en pierre ceux dont le regard rencontrait le sien. Enfin, les
noms mêmes des sœurs de Méduse, Euryale et Sthéno, apportent également leur
part de révélation. Euryale, en grec Εὐρύαλος, signifie ce dont l’aire est
large, vaste, spacieuse ; Sthéno vient de Σθένος, force, puissance, énergie.
C’est ainsi que les trois Gorgones expriment symboliquement l’idée de pouvoir
et d’étendue propre à la philosophie naturelle.
Ces relations convergentes, qu’il nous est interdit
d’exposer plus clairement, permettent de conclure que, en dehors du fait
ésotérique précis mais à peine effleuré, notre motif a pour mission d’indiquer
la sagesse comme la source et la gardienne de toutes nos connaissances, le
guide sûr du laborieux à qui elle découvre les secrets cachés dans la nature.
Caisson 3 (pl. XXVIII). — Posé sur l’autel du sacrifice, un
avant-bras est consumé par le feu. L’enseigne de cet emblème igné tient en deux
mots :
Heureux malheur !...
Quoique le sujet semble, à priori, fort obscur et sans équivalent dans la
littérature et l’iconographie hermétiques, il cède pourtant à l’analyse et
s’accorde parfaitement avec la technique de l’Œuvre.
L’avant-bras humain, que les Grecs nommaient simplement le
bras, βραχίων, sert d’hiéroglyphe à la voie courte et abrégée. En effet, notre
Adepte, jouant sur les mots en cabaliste instruit, dissimule sous le substantif
βραχίων, bras, un comparatif de βραχύς, qui s’écrit et se prononce de la même
façon. Celui-ci signifie court, bref, de peu de durée, et forme plusieurs
composés, dont βραχύτης, brièveté. C’est ainsi que le comparatif βραχίων, bref,
homonyme de βραχίων, bras, prend le sens particulier de technique brève, ars brevis.
Mais les Grecs se servaient encore d’une autre expression
pour qualifier le bras. Lorsqu’ils évoquaient la main, χείρ, ils en
appliquaient, par extension, l’idée au membre supérieur tout entier, et lui
donnaient la valeur figurée d’une production artistique, habile, d’un procédé
spécial, d’une manière personnelle de travail, en résumé d’un tour de main
acquis ou révélé. Toutes ces acceptations caractérisent exactement les finesses
du Grand-Œuvre dans sa réalisation prompte, simple et directe, puisqu’elle ne
nécessite que l’application d’un feu très énergique, à laquelle se réduit le
tour de main en question. Or, ce feu n’est pas seulement figuré, sur notre
bas-relief, par les flammes, il l’est encore par le membre lui-même, que la
main indique comme étant un bras dextre ; et l’on sait assez que la locution
proverbiale « être le bras droit » se rapporte toujours à l’agent chargé
d’exécuter les volontés d’un supérieur, — le feu dans le cas présent.
À côté de ces raisons, — nécessairement abstraites parce
qu’elles sont voilées sous la forme lapidaire d’une image concise, — il en est
une autre, concrète, qui vient soutenir et confirmer, dans le domaine pratique,
la filiation ésotérique des premières. Nous l’énoncerons en disant que
quiconque, ignorant le tour de main de l’opération, se risque à l’entreprendre,
doit tout craindre du feu ; celui-là court un réel danger et peut difficilement
échapper aux conséquences d’un acte irréfléchi et téméraire. Pourquoi, dès
lors, nous dira-t-on, ne pas donner ce moyen ? Nous répondrons à cela que révéler
une manipulation de cet ordre serait livrer le secret de la voie courte, et que
nous n’avons point reçu de Dieu ni de nos frères l’autorisation de découvrir un
tel mystère. C’est déjà beaucoup que nous poussions la sollicitude et la
charité jusqu’à prévenir le débutant, que sa bonne étoile conduirait au seuil
de l’antre, de se tenir sur ses gardes et de redoubler de prudence. Un
avertissement semblable ne se rencontre guère dans les livres, forts succincts
sur tout ce qui regarde l’Œuvre bref, mais que l’Adepte de Dampierre
connaissait aussi parfaitement que Ripley, Basile Valentin, Philalèthe, Albert
le Grand, Huginus a Barma, Cyliani ou Naxagoras.
Cependant, et parce que nous jugeons utile de prévenir le
néophyte, on aurait tort de conclure que nous cherchions à le rebuter. S’il
veut risquer l’aventure, que ce soit pour lui l’épreuve du feu, à laquelle les
futurs initiés de Thèbes et d’Hermopolis devaient se soumettre, avant de
recevoir les sublimes enseignements. Le bras enflammé sur l’autel n’est-il pas
un symbole expressif du sacrifice, du renoncement qu’exige la science ? Tout se
paie ici-bas, non avec de l’or, mais avec de la peine, de la souffrance, en
laissant souvent une partie de soi-même ; et l’on ne saurait payer trop
chèrement la possession du moindre secret, de la plus infime vérité. Si donc
l’aspirant se sent doué de la foi et armé du courage nécessaire, nous lui
souhaiterons fraternellement de sortir sain et sauf de cette rude expérience,
laquelle se termine le plus souvent par l’explosion du creuset et la projection
du four. Alors pourra-t-il s’écrier, comme notre philosophe : heureux malheur ! Car l’accident,
l’obligeant à réfléchir sur la faute commise, lui fera découvrir sans doute le
moyen de pouvoir l’éviter, et le tour de main de l’opération régulière.
Caisson 4 (pl. XXVIII). — Fixée sur un tronc d’arbre couvert
de feuilles et chargé de fruits, une banderole déroulée porte l’inscription :
. MELIVS . SPE . LICEBAT .
Certes, on pouvait
espérer mieux… C’est là une image de l’arbre solaire que signale le
Cosmopolite dans son allégorie de la forêt verte, qu’il nous dit appartenir à
la nymphe Vénus. À propos de cet arbre métallique, l’auteur, relatant la façon
dont le vieillard Saturne travaille en présence du souffleur égaré, dit qu’il
prit du fruit de l’arbre solaire, le mit dans dix parties d’une certaine eau, —
fort rare et difficile à se procurer, — et en effectua facilement la
dissolution.
Notre Adepte entend ainsi parler du premier soufre, qui est
l’or des sages, fruit vert, non mûr, de l’arbor
scientiæ. Si la phrase latine trahit quelque déception d’un résultat
normal, et que beaucoup d’artistes seraient bien aises d’obtenir, c’est qu’au
moyen de ce soufre on ne peut encore opérer de transmutation. L’or
philosophique, en effet, n’est pas la pierre ; Philalèthe a soin de prévenir
l’étudiant que c’en est seulement la première matière. Et comme ce soufre
principe, d’après le même auteur, demande un labeur ininterrompu d’environ cent
cinquante jours, il est logique, et surtout humain, de penser qu’un résultat
aussi médiocre en apparence ne puisse satisfaire l’artiste, lequel escomptait
parvenir d’une traite à l’Élixir, ainsi qu’il arrive dans la voie courte.
Parvenu à ce point, l’apprenti doit reconnaître
l’impossibilité de continuer le travail, en poursuivant l’opération qui lui a
fourni le premier soufre. S’il veut aller plus loin, il lui faut retourner sur
se pas, entreprendre un second cycle d’épreuves nouvelles, labourer un an et
parfois davantage avant d’aboutir à la pierre du premier ordre. Mais si le
découragement ne l’atteint pas, qu’il suive l’exemple de Saturne et redissolve
dans le mercure, selon les proportions indiquées, ce fruit vert que la bonté
divine lui a permis de cueillir, et il verra ensuite, de ses yeux, se succéder
toutes les apparences d’une maturation progressive et parfaite. Nous ne
saurions trop lui rappeler, toutefois, qu’il se trouve engagé dans une voie
longue et pénible, semée de ronces et creusée de fondrières ; que l’art, y
ayant plus de part que la nature, les occasions d’errer, les écoles y sont
aussi plus nombreuses. Qu’il porte, de préférence, son attention sur le
mercure, que les philosophes ont tantôt appelé double, non sans cause, tantôt
ardent ou aiguisé, et acué de son propre sel. Il doit savoir, avant d’effectuer
la solution du soufre, que sa première eau, — celle qui lui a donné l’or
philosophique, — est trop débile pour servir d’aliment à cette semence solaire.
Et afin de vaincre la difficulté, qu’il s’efforce de comprendre l’allégorie du
Massacre des Innocents, de Nicolas Flamel, ainsi que l’explication qu’en donne
Limojon, aussi clairement que peut le faire un maître de l’art. [Limojon de
Saint-Didier. Lettre aux vrays Disciples
d’Hermès, dans le Triomphe Hermétique.
Amsterdam, Henry Wetstein, 1699.] Dès qu’il saura ce que sont, métalliquement,
ces esprits des corps désignés par le sang des innocents égorgés, de quelle
manière l’alchimiste opère la différenciation des deux mercures, il aura
franchi le dernier obstacle et rien, par la suite, sinon son impatience, ne
pourra le frustrer du résultat espéré.
Caisson 5 (pl. XXVIII). — Deux pèlerins, pourvus chacun d’un
chapelet, se rencontrent à proximité d’un édifice, — église ou chapelle, — que
l’on aperçoit au second plan. De ces hommes fort âgés, chauves, portant la
barbe longue et le même vêtement, l’un soutient sa marche à l’aide d’un bâton ;
l’autre, qui a le crâne protégé par un épais capuce, semble manifester une vive
surprise de l’aventure, et s’écrie :
. TROPT . TART . COGNEV . TROPT . TOST . LAISSÉ .
Parole de souffleur déçu, heureux de reconnaître enfin, au
terme de sa longue route, cet humide radical si ardemment désiré, mais désolé
d’avoir perdu, en de vains travaux, la vigueur physique indispensable à la
réalisation de l’Œuvre avec ce meilleur compagnon. Car c’est bien notre fidèle
serviteur, le mercure, qui est ici figuré sous l’aspect du premier vieillard.
Un léger détail le signale à l’attention de l’observateur sagace : le chapelet
qu’il tient forme, avec le bourdon, l’image du caducée, attribut symbolique
d’Hermès. D’autre part, nous avons dit fréquemment que la matière dissolvante
est communément reconnue, entre tous les philosophes, pour être le vieillard,
le pèlerin et le voyageur du grand Art, ainsi que l’enseignent Michel Maïer,
Stolcius et quantité d’autres maîtres.
Quant au vieil alchimiste, si joyeux de cette rencontre,
s’il n’a point su jusqu’ici où trouver le mercure, il montre assez combien
pourtant la matière lui en est familière, car son propre rosaire, hiéroglyphe
parlant, représente le cercle surmonté de la croix, symbole du globe terrestre
et signature de notre petit monde. On comprend alors pourquoi le malheureux
artiste regrette cette connaissance trop tardive, et son ignorance d’une
substance commune, qu’il avait à sa portée, sans jamais penser qu’elle pût lui
procurer l’eau mystérieuse vainement cherchée ailleurs…
Caisson 6 (pl. XXVIII). — Dans ce bas-relief sont figurés
trois arbres voisins et de pareille grandeur ; deux de ceux-ci montrent leur
tronc et leurs rameaux desséchés, tandis que le dernier, resté sain et
vigoureux, paraît être à la fois la cause et le résultat de la mort des autres.
Ce motif est orné de la devise :
. SI . IN . VIRIDI . IN . ARIDO . QVID .
S’il en est ainsi dans
les choses verdoyantes, qu’en sera-t-il dans les sèches ?
Notre philosophe pose ainsi le principe de la méthode
analogique, unique moyen, seule ressource dont l’hermétiste dispose pour la
résolution des secrets naturels. On peut donc répondre, d’après ce principe,
que ce qui se passe dans le règne végétal doit trouver son équivalence dans le
règne minéral. En conséquence, si les arbres secs et morts cèdent leur part de
nourriture et de vitalité au survivant planté à côté d’eux, il est logique de
considérer ce dernier comme leur héritier, celui auquel, en mourant, ils ont
légué la jouissance totale du fonds d’où ils tiraient leur subsistance. Sous
cet angle et de ce point de vue, il nous apparaît comme leur fils ou leur
descendant. Les trois arbres constituent ainsi un emblème transparent de la
façon dont naît la pierre des philosophes, premier être ou sujet de la pierre
philosophale.
L’auteur du Triomphe
Hermétique, rectifiant l’assertion erronée de son prédécesseur, Pierre-Jean
Fabre, dit sans ambage que « notre pierre naît de la destruction de deux corps
». [Limojon de Saint Didier, Le Triomphe
Hermétique. Amsterdam, Desbordes, 1710, p. A 4.] Nous préciserons que, de
ces corps, l’un est métallique, l’autre minéral, et qu’ils croissent tous deux
dans la même terre. L’opposition tyrannique de leur tempérament contraire les
retient de jamais s’accorder, sauf lorsque la volonté de l’artiste les y
oblige, en soumettant à l’action violente du feu ces antagonistes résolus.
Après un long et rude combat, ils périssent épuisés ; de leur décomposition
s’engendre alors un troisième corps, héritier de l’énergie vitale et des
qualités mixtionnées de ses parents défunts.
Telle est l’origine de notre pierre, pourvue dès sa
naissance de la double disposition métallique, laquelle est sèche et ignée, et
de la double vertu minérale, dont l’essence est d’être froide et humide. Ainsi
réalise-t-elle, en son état d’équilibre parfait, l’union des quatre éléments naturels,
que l’on rencontre à la base de toute philosophie expérimentale. La chaleur du
feu s’y trouve tempérée par la frigidité de l’air, et la sécheresse de la terre
neutralisée par l’humidité de l’eau.
Caisson 7 (pl. XXVIII). — La figure géométrique que nous
rencontrons ici ornait fréquemment les frontispices des manuscrits alchimiques
du moyen âge. On l’appelait communément Labyrinthe
de Salomon, et nous avons signalé ailleurs qu’elle se trouvait reproduite
sur le dallage de nos grandes églises ogivales. Cette figure porte pour devise
:
. FATA . VIAM . INVENIENT .
Les destins trouveront
bien leur voie... Notre bas-relief, caractérisant uniquement la voie
longue, révèle l’intention formelle, exprimée par la pluralité des motifs de
Dampierre, d’enseigner surtout l’Œuvre du riche. Car ce labyrinthe ne nous
offre qu’une seule entrée, tandis que les dessins du même sujet en montrent
généralement trois, lesquelles entrées correspondent, d’ailleurs, aux trois
porches des cathédrales gothiques placées sous l’invocation de la Vierge mère.
L’une, absolument droite, conduit directement à la chambre médiane, — où Thésée
tue le Minotaure, — sans rencontrer le moindre obstacle ; elle traduit la voie
courte, simple, aisée, de l’Œuvre du pauvre. La seconde, qui aboutit également
au centre, n’y débouche qu’après une série de détours, de retours, de
circonvolutions ; c’est l’hiéroglyphe de la voie longue, et nous avons dit
qu’elle se réfère à l’ésotérisme préféré de notre Adepte. Enfin, une troisième
galerie, dont l’ouverture est parallèle aux précédentes, se termine brusquement
en impasse, à faible distance du seuil, et ne mène à rien. Elle cause le
désespoir et la ruine des errants, des présomptueux, de ceux qui, sans étude
sérieuse, sans principes solides, se mettent néanmoins en route et risquent
l’aventure.
Quelle que soit leur forme, la complication de leur tracé,
les labyrinthes sont les symboles parlants du Grand-Œuvre considéré sous le
rapport de sa réalisation matérielle. Aussi les voyons-nous chargés d’exprimer
les deux grandes difficultés que comporte l’ouvrage : 1° accéder à la chambre
intérieure ; 2° avoir la possibilité d’en sortir. De ces deux points, le
premier regarde la connaissance de la matière, — qui assure l’entrée, — et
celle de sa préparation, — que l’artiste accomplit au centre du dédale. Le
second concerne la mutation, par le secours du feu, de la matière préparée.
L’alchimiste refait donc, en sens inverse, mais avec prudence, lenteur,
persévérance, le parcours rapidement effectué au début de son labeur. Afin de
ne point s’égarer, les philosophes lui conseillent de repérer sa route au
départ, — pour les opérations que nous pourrions dénommer analytiques, — en
employant ce fil d’Ariane sans lequel il risquerait fort de n’en pouvoir
revenir, — c’est-à-dire de s’égarer dans le travail d’unification synthétique.
C’est à cette seconde phase ou période de l’Œuvre que s’applique l’enseigne
latine du labyrinthe. En effet, à partir du moment où le compost, formé de
corps vitalisés, commence son évolution, le mystère le plus impénétrable couvre
alors de son voile l’ordre, la mesure, le rythme, l’harmonie et le progrès de
cette admirable métamorphose que l’homme n’a point la faculté de comprendre ni
d’expliquer. Abandonnée à son propre sort, soumise aux affres du feu dans les
ténèbres de son étroite prison, la matière régénérée suit la voie secrète
tracée par les destins.
Caisson 8 (pl. XXVIII). — Dessin effacé, sculpture au relief
disparu. Seule, l’inscription subsiste, et la netteté de sa gravure tranche sur
l’uniformité nue du calcaire environnant ; on y lit :
À moi le ciel !...
Exclamation d’ardent enthousiasme, de joie exubérante, cri d’orgueil,
dira-t-on, d’Adepte en possession du Magistère. Peut-être. Mais est-ce bien là
ce que veut rendre la pensée de l’auteur ? Nous nous permettons d’en douter,
car, nous basant sur tant de motifs sérieux et positifs, d’épigraphes au sens
pondéré, nous préférons y voir l’expression d’un espoir radieux dirigé vers la
connaissance des choses célestes, plutôt que l’idée présomptueuse et baroque
d’une illusoire conquête de l’empyrée.
Il est évident que le philosophe, parvenu au résultat
tangible du labeur hermétique, n’ignore plus quelle est la puissance, la
prépondérance de l’esprit, ni l’action vraiment prodigieuse qu’il exerce sur
l’inerte substance. Force, volonté, science même appartiennent à l’esprit ; la
vie est la conséquence de son activité ; le mouvement, l’évolution, le progrès
en sont les résultats. Et puisque tout tient de lui, que tout s’engendre et se
découvre par lui, il est raisonnable de croire qu’en définitive tout doit
nécessairement retourner à lui. Il suffit donc de bien observer ses
manifestations dans la matière grave, d’étudier les lois auxquelles il semble
obéir, de connaître ses directives pour acquérir quelque notion des choses et
des lois premières de l’univers. Aussi, peut-on conserver l’espoir d’obtenir,
par le simple examen du labeur spirituel dans l’ouvrage hermétique, les
éléments d’une conception moins vague du Grand-Œuvre divin, du Créateur et des
choses créées. Ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, a dit
Hermès ; et c’est par l’étude persévérante de tout ce qui nous est accessible,
que nous pouvons élever notre intelligence jusqu’à la compréhension de
l’inaccessible. C’est là l’idée naissante, dans l’idéal du philosophe, de la
fusion de l’esprit humain et de l’esprit divin, du retour de la créature au
Créateur, au foyer ardent, unique et pur d’où l’étincelle martyre, laborieuse,
immortelle, dut, sur l’ordre de Dieu, s’échapper pour s’associer à la matière
vile, jusqu’à l’accomplissement révolu de son périple terrestre.
Caisson 9 (pl. XXVIII). – Nos prédécesseurs n’ont reconnu,
en ce petit sujet, que le symbole attribué au roi de France Henri II. Il se
compose d’un simple croissant lunaire, que cette devise accompagne :
. DONEC . TOTVM . IMPLEAT . ORBEM .
Jusqu’à ce qu’il
emplisse toute la terre... Nous ne croyons pas que l’interprétation de cet
emblème, auquel Diane de Poitiers demeure tout à fait étrangère, puisse prêter
à la moindre équivoque. Le plus jeune des « fils de science » n’ignore point
que la lune, hiéroglyphe spagyrique de l’argent, marque le but final de l’Œuvre
au blanc et la période de transition de l’Œuvre au rouge. C’est au règne de la
lune que paraît la couleur caractéristique de l’argent, c’est-à-dire le blanc.
Artephius, Nicolas Flamel, Philalèthe et quantité d’autres maîtres enseignent
qu’à cette phase de la coction le rebis offre l’aspect de fils fins et soyeux,
de cheveux étendus à la surface et progressant de la périphérie vers le centre.
D’où le nom de blancheur capillaire qui sert à désigner cette coloration. La
lune, disent les textes, est alors dans son premier quartier. Sous l’influence
du feu, la blancheur gagne en profondeur, atteint toute la masse et vire, en
surface, au jaune-citron. C’est la pleine lune ; le croissant s’est amplifié
jusqu’à former le disque lunaire parfait : il a complètement rempli l’orbe. La
matière est pourvue d’un certain degré de fixité et de sécheresse, signes
assurés d’achèvement du petit Magistère. Si l’artiste désire ne pas aller plus
loin ou ne puisse conduire l’Œuvre jusqu’au rouge, il ne lui restera qu’à
multiplier cette pierre, en recommençant les mêmes opérations, pour l’augmenter
en puissance et en vertu. Et ces réitérations se pourront renouveler autant de
fois que la matière le permettra, c’est-à-dire tant qu’elle soit saturée de son
esprit et que celui-ci en « emplisse toute la terre ». Au delà du point de
saturation, ses propriétés changent ; trop subtile, on ne peut plus la
coaguler ; elle reste ainsi en huile épaisse, lumineuse dans l’obscurité,
désormais sans action sur les êtres vivants comme sur les corps métalliques.
Ce qui est vrai pour l’Œuvre au blanc l’est également pour
le grand Magistère. Dans ce dernier, il suffit seulement d’augmenter la
température, dès qu’on a obtenu la couleur citrine, sans cependant toucher ni
ouvrir le vaisseau, et à condition que l’on ait, au début, substitué le ferment
rouge au soufre blanc. C’est, du moins, ce que recommande Philalèthe et ne fait
point Flamel, quoique leur désaccord apparent s’explique aisément si l’on
possède bien les directives des voies et des opérations. Quoi qu’il en soit, en
poursuivant l’action du quatrième degré du feu, le compost se dissoudra de
lui-même, de nouvelles couleurs se succéderont jusqu’à ce qu’un rouge faible,
qualifié fleur de pêcher, devenant peu à peu plus intense à mesure que la
siccité s’étend, annonce le succès et la perfection de l’ouvrage. Refroidie, la
matière offre une texture cristalline, faite, semble-t-il, de petits rubis
agglomérés, rarement libres, toujours de forte densité et de brillant éclat,
fréquemment enrobés dans une masse amorphe, opaque et rousse, nommée par les
anciens la terre damnée de la pierre. Ce résidu, facile à séparer, n’est
d’aucune utilité et doit être jeté.
VII (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Quatrième série (pl. XXIX).
 |
| Planche XXIX |
Caisson 1. — Ce bas-relief nous présente un rocher que la
mer furieuse attaque et menace d’engloutir ; mais deux chérubins soufflent sur
les flots et apaisent la tempête. Le phylactère qui accompagne cette figure
exalte la constance dans les périls :
. IN . PERICVLIS . CONSTANTIA .
… vertu philosophique que l’artiste doit savoir garder
pendant le cours de la coction, et surtout au commencement de celle-ci, lorsque
les éléments déchaînés se heurtent et se repoussent avec violence. Plus tard,
malgré la longueur de cette phase ingrate, le joug en est moins pénible à
supporter, car l’effervescence se calme, et la paix naît enfin du triomphe des
éléments spirituels, – air et feu, – symbolisés par les angelots, agents de
notre mystérieuse conversion élémentaire. Mais, à propos de cette conversion,
peut-être n’est-il pas superflu d’apporter ici quelques précisions sur la
manière dont s’accomplit le phénomène, au sujet duquel les anciens ont fait
preuve, à notre avis, d’une réserve excessive.
Tout alchimiste sait que la pierre est composée des quatre
éléments unis, par une puissante cohésion, dans un état d’équilibre naturel et
parfait. Ce qui est moins connu, c’est la façon dont ces quatre éléments se
résolvent en trois principes physiques, que l’artiste prépare et assemble selon
les règles de l’art en tenant compte des conditions requises. Or, ces éléments
primaires, représentés dans notre caisson par la mer (eau), le roc (terre), le
ciel (air), et les chérubins (lumière, esprit, feu), se réduisent en sel,
soufre et mercure, principes matériels et tangibles de notre pierre. De ces
principes, deux sont réputés simples, le soufre et le mercure, parce qu’ils se
rencontrent naturellement combinés dans le corps des métaux ; un seul, le sel,
apparaît constitué en partie de substance fixe, en partie de matière volatile.
On sait, en chimie, que les sels, formés d’un acide et d’une base, révèlent,
par leur décomposition, la volatilité de l’un, de même que la fixité de
l’autre. Comme le sel participe à la fois du principe mercuriel par son
humidité froide et volatile (air), et du principe sulfureux par sa sécheresse
ignée et fixe (feu), il sert donc de médiateur entre les composants soufre et
mercure de notre embryon. Grâce à sa double qualité, le sel permet de réaliser
la conjonction, qui serait impossible sans lui, entre l’un et l’autre des
antagonistes, parents effectifs du roitelet hermétique. Ainsi, les quatre
éléments premiers se trouvent assemblés deux à deux dans la pierre en
formation, parce que le sel possède en lui le feu et l’air nécessaires à
l’assemblage du soufre-terre et du mercure-eau.
Toutefois, et bien que les composants salins soient voisins
des natures sulfureuse et mercurielle (parce que le feu recherche toujours un
aliment terrestre et que l’air se mélange volontiers à l’eau), ils n’ont pas
une affinité telle pour les principes matériels et pondérables de l’Œuvre,
soufre et mercure, que leur présence seule, leur catalyse, soit capable
d’éviter tout désaccord en ce mariage philosophique. Au contraire, ce n’est
qu’après de longs débats et de multiples chocs que l’air et le feu, rompant
leur association saline, agissent de concert pour rétablir la concorde entre
des ennemis qu’une simple différence d’évolution a séparés.
D’où nous devons conclure, dans l’explication théorique de
la conversion des éléments et de leur union indissoluble à l’état d’Élixir, que
le sel est l’unique instrument d’une harmonie durable, l’instigateur d’une paix
stable et féconde en résultats heureux. Et ce médiateur pacifique, non content
d’intervenir sans cesse pendant l’élaboration lente, tumultueuse et chaotique
de notre mixtion, contribue encore, de sa propre substance, à nourrir et à
fortifier le corps nouvellement formé. Image du Bon Pasteur, qui donne sa vie
pour ses brebis, le sel philosophique, son rôle terminé, meurt afin que notre
jeune monarque puisse vivre, grandir, étendre sa volonté souveraine sur toute
la nature métallique.
Caisson 2 (pl. XXIX). – L’humidité a rongé la table de fond
en la privant du relief qu’elle possédait jadis. Les rugosités imprécises et
frustres qui subsistent encore pourraient appartenir à quelques végétaux.
L’inscription a beaucoup souffert ; certaines lettres seulement ont pu résister
à l’injure du temps :
. . M . RI . . . V . RV . .
Il est impossible, avec aussi peu d’éléments, de rétablir la
phrase ; cependant, d’après l’ouvrage intitulé Paysages et Monuments du Poitou, que nous avons déja cité, les
végétaux seraient des épis de blé et l’inscription devrait se lire
La mort est un gain
pour moi… C’est une allusion à la nécessité de la mortification et de la
décomposition de notre semence minérale. Car de même que le grain de froment ne
pourrait germer, produire et se multiplier si la putréfaction ne l’avait
auparavant liquéfié dans la terre, de même est-il indispensable de provoquer la
désagrégation du rebis philosophal, où la semence est incluse, pour générer un
nouvel être, de nature semblable, mais susceptible de s’augmenter lui-même,
tant en poids et volume qu’en puissance et vertu. Au centre du composé,
l’esprit enfermé, vivant, immortel, toujours prêt à manifester son action,
n’attend que la décomposition du corps, la dislocation de ses parties, pour
travailler à l’épuration puis à la réfection de la substance mondifiée et
clarifiée avec l’aide du feu.
C’est donc la matière, grossière encore, du mercure
philosophique, qui parle dans l’épigraphe Mihi
mori lucrum. Non seulement la mort lui assure le bénéfice d’une enveloppe
corporelle beaucoup plus noble que la première, mais elle lui accorde, au
surplus, une énergie vitale qu’elle ne possédait pas, et la faculté génératrice
dont une mauvaise constitution l’avait jusqu’alors privée.
Telle est la raison pour laquelle notre Adepte, afin de
donner une image sensible de la régénération hermétique par la mort du compost,
a fait sculpter des épis sous la devise parabolique de ce petit sujet.
Caisson 3 (pl. XXIX). – Issant de nuages épais, une main
dont l’avant-bras est ulcéré, tient un rameau d’olivier. Ce blason, de
caractère morbide, a pour enseigne :
. PRVDENTI . LINITVR . DOLOR .
Le sage sait apaiser
la douleur... Le rameau d’olivier, symbole de paix et de concorde, marque
l’union parfaite des éléments générateurs de la pierre philosophale. Or, cette
pierre, par les connaissances certaines qu’elle apporte, par les vérités
qu’elle révèle au philosophe, lui permet de dominer les souffrances morales qui
affectent les autres hommes, et de vaincre les douleurs physiques en supprimant
la cause et les effets d’un grand nombre de maladies.
L’élaboration même de l’Élixir lui démontre que la mort,
transformation nécessaire, mais non pas anéantissement réel, ne doit pas
l’affliger. Bien au contraire, l’âme, libérée du fardeau corporel, jouit, en
plein essor, d’une merveilleuse indépendance, toute baignée de cette lumière
ineffable, accessible seulement aux esprits purs. Il sait que les phases de
vitalité matérielle et d’existence spirituelle se succèdent les unes les autres
d’après les lois qui en régissent le rythme et les périodes. L’âme ne quitte
son corps terrestre que pour en animer un nouveau. Le vieillard d’hier est
l’enfant de demain. Les disparus se retrouvent, les égarés se rapprochent, les
morts renaissent. Et l’attraction mystérieuse qui lie entre eux les êtres et
les choses d’évolution semblable, réunit à leur insu ceux qui vivent encore et
ceux qui ne sont plus. Il n’y a point, pour l’initié, de véritable, d’absolue
séparation, et la seule absence ne lui peut causer de chagrin. Ses affections,
il les reconnaîtra aisément, quoique revêtues d’une enveloppe différente, parce
que l’esprit, d’essence immortelle et doué d’éternelle mémoire, saura les lui
faire discerner…
Ces certitudes, matériellement contrôlées au long du travail
de l’Œuvre, lui assurent une sérénité morale indéfectible, le calme au milieu
des agitations humaines, le mépris des joies mondaines, un stoïcisme résolu et,
surtout, ce puissant réconfort que lui donne la connaissance secrète de ses
origines et de sa destinée.
Sur le plan physique, les propriétés médicinales de l’Élixir
mettent son heureux possesseur à l’abri des tares et des misères
physiologiques. Grâce à lui, le sage sait apaiser sa douleur. Batsdorff
certifie qu’il guérit toutes les maladies externes du corps,… ulcères,
écrouelles, loupes, paralysies, blessures et telles autres affections, étant
dissous dans une liqueur convenable et appliqué sur le mal, par le moyen d’un
linge imbibé de la liqueur. [Le Filet
d’Ariadne. Op. cit., p. 140.] De son côté, l’auteur d’un manuscrit
alchimique enluminé vante également les hautes vertus de la médecine des sages.
« L’Élixir, écrit-il, est une cendre divine, plus miraculeuse qu’autrement, et
se départ, ainsi qu’on le voit, selon la nécessité qui se présente, et ne
refuse personne, tant pour la santé du corps humain et la nourriture de cette
vie caduque et transitoire, que pour la résurrection des corps métalliques
imparfaits… En vérité, il outrepasse toutes les thériaques et médecines les
plus excellentes que les hommes pourroient faire, tant soient-ils subtils. Il
rend l’homme qui le possède bienheureux, grave, prospère, notable, audacieux,
robuste, magnanime. » [La Génération et
Opération du Grand-Œuvre. Bibl. de Lyon. Ms. cité.] Enfin, Jacques Tesson
donne aux nouveaux convertis de sages conseils sur l’emploi du baume universel.
« Nous avons parlé, dit l’auteur en s’adressant au sujet de l’art, du fruit de
bénédiction sorti de toy ; maintenant, nous dirons comment il te faut
appliquer ; c’est à soulager les pauvres, et non aux pompes mondaines ; c’est à
guérir les infirmes nécessiteux, et non les grands et puissants de la terre.
Car il nous faut prendre garde à qui nous donnons, et savoir qui nous devons
soulager, dans les infirmitez et maladies qui affligent l’espèce humaine.
N’administre ce puissant remède que par une inspiration de Dieu, qui voit tout,
connoît tout, ordonne tout. » [Jacques Tesson. Le Grand et Excellent Œuvre des Sages, contenant trois traités ou
dialogues. Dialogues du Lyon verd, du Grand Thériaque et du Régime. Ms. du
XVIIe siècle. Bibl. de Lyon, n° 971 (900).]
Caisson 4 (pl. XXIX). – Voici maintenant l’un des symboles
majeurs du Grand-Œuvre : la figure du cercle gnostique, formé par le corps du
serpent qui dévore sa queue, avec, pour devise, le mot latin
L’amitié… L’image
circulaire est, en effet, l’expression géométrique de l’unité, de l’affinité,
de l’équilibre et de l’harmonie. Tous les points de la circonférence étant
équidistants du centre et en étroit contact les uns avec les autres, ils
réalisent un orbe continu et fermé, lequel n’a point de commencement et ne peut
avoir de fin, de même que Dieu dans la métaphysique, l’infini dans l’espace et
l’éternité dans le temps.
Les Grecs nommaient ce serpent l’Ouroboros, des mots οὐρά, queue, et βορός, dévorant. Au moyen âge,
on l’assimilait au dragon en lui imposant une attitude et une valeur
ésotériques semblables à celles du serpent hellénique. Telle est la raison des
associations de reptiles, naturels ou fabuleux, que l’on rencontre presque
toujours chez les vieux auteurs. Draco
aut serpens qui caudam devoravit ; serpens aut lacerta viridis quæ propriam
caudam devoravit, etc., écrivent-ils fréquemment. Sur les monuments,
d’autre part, le dragon, permettant plus de mouvement et de pittoresque dans la
composition décorative, semble plaire davantage aux artistes ; c’est lui qu’ils
représentent de préférence. On peut le remarquer au portail nord de l’église
Saint-Armel, à Ploermel (Morbihan), où plusieurs dragons accrochés aux rampants
des gables, font la roue en se mordant la queue. Les célèbres stalles d’Amiens
offrent également une curieuse figure de dragon à tête de cheval, au corps
ailé, terminé par une queue décorative dont le monstre dévore l’extrémité.
Etant donné l’importance de cet emblème, – il est, avec le
sceau de Salomon, le signe distinctif du Grand-Œuvre, – sa signification reste
susceptible d’interprétations variées. Hiéroglyphe d’union absolue,
d’indissolubilité des quatre éléments et des deux principes ramenés à l’unité
dans la pierre philosophale, cette universalité en permet l’usage et
l’attribution aux diverses phases de l’Œuvre, puisque toutes visent au même but
et sont orientées vers l’assemblage, l’homogénéité des natures premières, la
mutation de leur antipathie native en amitié solide et stable. Généralement, la
tête du dragon ou de l’Ouroboros marque la partie fixe, et sa queue la partie
volatile du composé. C’est ainsi que l’entend le commentateur de Marc Fra
Antonio : « Cette terre, dit-il en parlant du soufre, par sa sécheresse ignée
et innée, attire à soy son propre humide et le consume ; et à cause de cela,
elle est comparée au dragon qui dévore sa queue. Au reste, elle n’attire et
n’assimile à soy son humide que parce qu’il est de sa mesme nature. » [La Lumière sortant par soy-mesme des
Ténèbres, ou Véritable Théorie de la Pierre des Philosophes, écrite en vers
italiens… Paris, L. d’Houry, 1687, p. 271.] D’autres philosophes en font
une application différente, témoin Linthaut, qui le rapporte aux périodes
colorées : « Il y a, écrit-il, trois couleurs principales qui se doivent
montrer en l’Œuvre, le noir, le blanc, le rouge. La noirceur, première couleur,
est nommée des Anciens dragon venimeux, quand ils disent : le dragon dévorera
sa propre queue. » [Henri de Lintaut. Commentaire
sur le Trésor des Trésors de Christophe de Gamon. Paris, Claude Morillon,
1610, p. 133.] L’ésotérisme est équivalent dans le Très précieux Don de Dieu, de Georges Aurach. David de Planis
Campy, plus éloigné de la doctrine, n’y voit qu’une version des cohobations
spagyriques.
Quant à nous, nous avons toujours compris l’Ouroboros comme
un symbole complet de l’ouvrage alchimique et de son résultat. Mais, quelle que
soit l’opinion des savants de notre époque sur cette figure, on peut du moins
être certain que tous les attributs de Dampierre, placés sous l’égide du
serpent qui se mord la queue, sont exclusivement relatifs au Grand-Œuvre et
présentent un caractère particulier, conforme à l’enseignement secret de la
science hermétique.
Caisson 5 (pl. XXIX). – Encore un sujet disparu et duquel on
ne peut rien déchiffrer. Quelques lettres incohérentes apparaissent seulement
sur le calcaire désagrégé :
Caisson 6 (pl. XXIX). – Une grande étoile à six rayons
resplendit sur les flots d’une mer mouvante. Au-dessus d’elle, la banderole
porte gravée cette devise latine dont le premier mot se trouve écrit en
espagnol :
. LVZ . IN . TENEBRIS . LVCET .
La lumière brille dans
les ténèbres… On s’étonnera sans doute que nous prenions pour des flots ce
que d’autres pensent être des nuées. Mais, en étudiant la manière dont le
sculpteur représente ailleurs l’eau et les nuages, on sera vite convaincu qu’il
n’y a point, de notre part, erreur, méprise ou mauvaise foi. Par cette étoile
marine, cependant, l’auteur de l’image ne prétend pas figurer l’astérie
commune, vulgairement dite étoile de mer. Celle-ci ne possède que cinq bras rayonnants,
tandis que la nôtre est pourvue de six branches distinctes. Nous devons donc
voir ici l’indication d’une eau étoilée, laquelle n’est autre que notre mercure
préparé, notre Vierge mère et son symbole, Stella
maris, mercure obtenu sous forme d’eau métallique blanche et brillante, que
les philosophes dénomment encore astre
(du grec ἀστήρ, brillant, éclatant). Ainsi le travail de l’art rend manifeste
et extérieur ce qui, auparavant, se trouvait diffus dans la masse ténébreuse,
grossière et vile du sujet primitif. De l’obscur chaos, il fait jaillir la
lumière après l’avoir rassemblée, et cette lumière brille désormais dans les
ténèbres, de même qu’une étoile au ciel nocturne. Tous les chimistes ont connu
et connaissent ce sujet, quoique fort peu savent en extraire la quintessence
radiante, si fortement enfouie dans la terrestréité et l’opacité du corps.
C’est pourquoi Philalèthe recommande à l’étudiant de ne point mépriser la
signature astrale, révélatrice du mercure préparé. « Aies soin, lui dit-il, de
régler ta route par l’étoile du nord, que notre aimant te fera paraître. Alors,
le sage se réjouira ; le fou, néanmoins, tiendra cela pour peu de chose. Il
n’apprendra pas la sagesse et regardera même, sans en comprendre la valeur, ce
pôle central fait de lignes entrecroisées, marque merveilleuse du
Tout-Puissant. » [Philalèthe, Introïtus
apertus. Op. cit., ch. IV, 3.]
Fortement intrigué par cette étoile, dont il ne parvenait
pas à s’expliquer l’importance ni la signification, Hoefer s’adressa à la
cabale hébraïque. « Iesod (יסןד),
écrit-il, signifie à la fois fondement et mercure, parce que le mercure est le
fondement de l’art transmutatoire. La nature du mercure est indiquée par les
noms אל חי (Dieu vivant), dont les
lettres produisent, par leur sommation, le nombre 49, que donnent également les
lettres כוכב (cocaf),
étoile. Mais quel sens faut-il attacher au mot כוכב ?
Écoutons la Kabbale : « Le caractère du véritable mercure consiste à se
couvrir, par l’action de la chaleur, d’une pellicule approchant plus ou moins
de la couleur de l’or ; et cela se peut faire même dans l’espace d’une seule
nuit. » Voilà le mystère qu’indique le mot כוכב,
étoile. » [Ferdinand Hoefer, Histoire de
la chimie. Paris, Firmin Didot, 1866, p. 248.] Cette exégèse ne nous
satisfait pas. Une pellicule, de quelque couleur qu’elle puisse être, ne
ressemble en rien aux radiations étoilées, et nos propres travaux nous sont
garants d’une signature effective, laquelle présente tous les caractères
géométriques et réguliers d’un astre parfaitement dessiné. Aussi,
préférons-nous le langage, moins chimique mais plus vrai, des maîtres anciens,
à cette description kabbalistique de l’oxyde rouge de l’hydrargyre. « Il est de
la nature de la lumière, dit l’auteur d’un ouvrage célèbre, de ne pouvoir
paroître à nos yeux sans être revêtue de quelque corps, et il faut que ce corps
soit propre aussi à recevoir la lumière ; là où est donc la lumière, là doit
aussi être nécessairement le véhicule de cette lumière. Voilà le moyen le plus
facile pour ne point errer. Cherche donc avec la lumière de ton esprit, la
lumière qui est enveloppée de ténèbres, et aprens de là que le sujet le plus
vil de tous selon les ignorans, est le plus noble selon les sages. » [La Lumière sortant par soy-mesme des
Ténèbres. Op. cit.]
Dans un récit allégorique concernant la préparation du
mercure, Trismosin est plus catégorique encore ; il affirme, comme nous, la
réalité visuelle du sceau hermétique. « Sur le poinct du jour, dit notre
auteur, on vid sortir par dessus la personne du roy une estoille tres-resplendissante,
et la lumière du jour illumina les ténèbres. » [Salomon Trismosin, La Toyson d’Or. Paris, Ch. Sevestre,
1612.] Quant à la nature mercurielle du support de l’étoile (qui est le ciel
des philosophes), Nicolas Valois nous la donne bien à entendre dans le passage
suivant : « Les sages, dit-il, nomment leur mer l’Œuvre entier, et dès que le
corps est réduit en eau, de laquelle il fut premièrement composé, icelle est
dite eau de mer, parce que c’est
vrayement une mer, dans laquelle plusieurs sages nautoniers ont fait naufrage,
n’ayant pas cet astre pour guide, qui ne manquera jamais à ceux qui l’ont une
fois connu. C’est cette estoile qui conduisoit les Sages à l’enfantement du
fils de Dieu, et cette mesme qui nous fait voir la naissance de ce jeune roy. »
[Les Cinq Livres de Nicolas Valois.
Ms. cité.] Enfin, dans son Catéchisme ou
Instruction pour le grade d’Adepte, annexé à son ouvrage intitulé l’Étoile flamboyante, le baron Tschoudy
nous informe que l’astre des philosophes se nommait ainsi chez les
francs-maçons. « La Nature, dit-il, n’est point visible, quoiqu’elle agisse
visiblement, car ce n’est qu’un esprit volatil, qui fait son office dans les
corps, et qui est animé par l’esprit universel, que nous connaissons, en
Maçonnerie vulgaire, sous le respectable emblème de l’Étoile flamboyante. »
Caisson 7 (pl. XXIX). – Au pied d’un arbre chargé de fruits,
une femme plante en terre plusieurs noyaux. Sur le phylactère, dont une
extrémité tient au tronc, et l’autre se déroule au-dessus du personnage, on lit
cette phrase latine :
. TV . NE . CEDE . MALIS .
Ne cède pas aux
erreurs... C’est un encouragement à persévérer dans la voie suivie et la
méthode employée, que donne notre philosophe au bon artiste, lequel se plaît à
naïvement imiter la simple nature, plutôt qu’à poursuivre de vaines chimères.
Les anciens désignaient souvent l’alchimie sous le nom
d’agriculture céleste, parce qu’elle offre, dans ses lois, ses circonstances et
ses conditions le plus étroit rapport avec l’agriculture terrestre. Il n’est
guère d’auteur classique qui ne prenne ses exemples et n’établisse ses
démonstrations sur les travaux champêtres. L’analogie hermétique apparaît ainsi
fondée sur l’art du cultivateur. De même qu’il faut une graine pour obtenir un
épi, – nisi granum frumenti, – de
même il est indispensable d’avoir tout d’abord la semence métallique, afin de
multiplier le métal. Or, chaque fruit porte en soi sa semence, et tout corps,
quel qu’il soit, possède la sienne. Le point délicat, que Philalèthe appelle le
pivot de l’art, consiste à savoir extraire du métal ou du minéral cette semence
première. C’est la raison pour laquelle l’artiste doit, au début de son
ouvrage, décomposer entièrement ce qui a été assemblé par la nature, car «
quiconque ignore le moyen de détruire les métaux, ignore aussi celui de les
perfectionner ». Ayant obtenu les cendres du corps, celles-ci seront soumises à
la calcination, qui brûlera les parties hétérogènes, adustibles, et laissera le
sel central, semence incombustible et pure que la flamme ne peut vaincre. Les
sages lui ont appliqué les noms de soufre, premier agent ou or philosophique.
Mais toute graine capable de germer, de croître et de
fructifier, réclame une terre propre.
L’alchimiste a besoin, lui aussi, d’un terrain approprié à
l’espèce et à la nature de sa semence ; ici encore, c’est au seul règne minéral
qu’il devra le demander. Certes, ce second travail lui coûtera plus de fatigue
et de temps que le premier. Et cela également concorde avec l’art du
cultivateur. Ne voyons-nous pas tous les soins de ce dernier dirigés vers une
exacte et parfaite préparation du sol ? Tandis que les semailles se font vite
et sans grand effort, la terre, au contraire, exige plusieurs labours, une
juste répartition des engrais, etc., travaux pénibles et de longue haleine dont
l’analogie se retrouve au Grand-Œuvre philosophal.
Que les vrais disciples d’Hermès étudient donc les moyens
simples et efficaces d’isoler le mercure métallique, mère et nourrice de cette
semence d’où naîtra notre embryon ; qu’ils s’appliquent à purifier ce mercure
et à exalter ses facultés, à l’instar du paysan qui augmente la fécondité de
l’humus en l’aérant fréquemment, en lui incorporant les produits organiques
nécessaires. Surtout, qu’ils se défient des procédés sophistiques, formules
capricieuses à l’usage des ignorants ou des avides. Qu’ils interrogent la
nature, observent de quelle manière elle opère, sachent discerner quels sont
ses moyens et s’ingénient à l’imiter de près. S’ils ne se laissent pas rebuter
et ne cèdent point aux erreurs, répandues à profusion dans les meilleurs livres
mêmes, sans doute verront-ils enfin le succès couronner leurs efforts. Tout
l’art se résume à découvrir la semence, soufre ou noyau métallique, à la jeter
dans une terre spécifique, ou mercure, puis à soumettre ces éléments au feu,
selon un régime de quatre températures croissantes, qui constituent les quatre
saisons de l’Œuvre. Mais le grand secret est celui du mercure, et c’est
vainement qu’on en cherchera l’opération dans les ouvrages des plus célèbres
auteurs. Aussi est-il préférable d’aller du connu à l’inconnu, par la méthode
analogique, si l’on désire approcher de la vérité sur un objet qui a fait le
désespoir, et causé la ruine de tant d’investigateurs plus enthousiastes que
profonds.
Caisson 8 (pl. XXIX). – Ce bas-relief porte seulement
l’image d’un bouclier circulaire, et l’injonction historique de la mère spartiate
:
. AVT . HVNC . AVT . SVPER . HVNC .
Ou avec lui, ou sur
lui… La Nature s’adresse ici au fils de science se préparant à entreprendre
la première opération. Nous avons dit déjà que cette manipulation, fort
délicate, comporte un réel danger, puisque l’artiste doit provoquer le vieux
dragon, gardien du verger des Hespérides, l’obliger à combattre, puis le tuer
sans merci s’il ne veut en être victime. Vaincre
ou mourir, tel est le sens voilé de l’inscription. Notre champion, malgré
sa vaillance, ne saurait donc agir avec trop de prudence, car l’avenir de
l’Œuvre et son propre destin dépendent de ce premier succès.
La figure du bouclier, – en grec ἀσπίς, abri, protection,
défense, – lui indique la nécessité d’une arme défensive. Quant à l’arme
d’attaque, c’est la lance, – λόγχη, sort, destin, – ou l’estoc, – διάληψις,
séparation, – qu’il devra employer. À moins qu’il ne préfère recourir au moyen
dont se servit Bellérophon, chevauchant Pégase, pour tuer la Chimère. Les
poètes feignent qu’il enfonça profondément dans la gorge du monstre un épieu de
bois, durci au feu et garni de plomb. La Chimère, irritée, vomissait des flammes ;
le plomb fondit, coula jusqu’aux entrailles de la bête, et ce simple artifice
en eut vite raison.
Nous appelons surtout l’attention du débutant sur la lance
et le bouclier, qui sont les meilleures armes que puisse utiliser le chevalier
expert et sûr de lui, celles qui signeront, s’il sort victorieux du combat, son
écu symbolique, en lui assurant la possession de notre couronne.
C’est ainsi que, de laboureur, on devient héraut (Κῆρυξ,
racine grecque de Κηρυκιοφόρος, qui porte le Caducée). D’autres, de même
courage et d’ardente foi, plus confiants dans la miséricorde divine qu’assurés
de leurs propres forces, abandonnèrent l’épée, la lance et le glaive pour la
croix. Ceux-là vainquirent mieux encore, car le dragon, matériel et démoniaque,
ne résista jamais à l’effigie spirituelle et toute-puissante du Sauveur, au
signe ineffable de l’Esprit et de la Lumière incarnés : In hoc signo vinces.
Au sage, dit-on, peu de paroles suffisent, et nous estimons
avoir assez parlé pour ceux qui voudront se donner la peine de nous comprendre.
Caisson 9 (pl. XXIX). – Une fleur champêtre, ayant l’aspect
du coquelicot, reçoit la lumière du soleil qui brille au-dessus d’elle. Ce
bas-relief a souffert de conditions atmosphériques défavorables, ou, peut-être,
de la mauvaise qualité de la pierre ; l’inscription qui ornait une banderole
dont on voit encore la trace est complètement effacée. Comme nous avons,
précédemment, analysé un sujet semblable (série II, caisson I), et que ce motif
est susceptible de plusieurs interprétations très différentes, nous garderons
le silence, par crainte d’une erreur possible, étant donné l’absence de sa
devise particulière.
VIII (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Cinquième série (pl. XXX).
 |
| Planche XXX |
Caisson 1. — Un stryge cornu, velu, pourvu d’ailes
membraneuses, nervées et griffues, les pieds et les mains en forme de serres,
est figuré accroupi. L’inscription fait parler en vers espagnols ce personnage
de cauchemar :
. MAS . PENADO . MAS . PERDIDO .
. Y . MENOS . AREPANTIDO .
Plus tu m’as nui, plus
tu m’as perdu, et moins je m’en suis repenti... Ce diable, image de la
grossièreté matérielle opposée à la spiritualité, est l’hiéroglyphe de la
première substance minérale, telle qu’on la trouve aux gîtes métallifères où
les mineurs vont l’arracher. On la voyait jadis représentée, sous la figure de
Satan, à Notre-Dame de Paris, et les fidèles, en témoignage de mépris et
d’aversion, venaient éteindre leurs cierges en les lui plongeant dans la
bouche, qu’il tenait ouverte. C’était, pour le peuple, maistre Pierre du
Coignet, la maîtresse pierre du coin, c’est-à-dire notre pierre angulaire et le
bloc primitif sur lequel tout l’Œuvre est édifié.
Il faut convenir que, pour être ainsi symbolisé sous des
dehors difformes et monstrueux, – dragon, serpent, vampire, diable, tarasque,
etc., – ce malheureux sujet doit être fort disgracié de la nature. En fait, son
aspect n’a rien de séduisant. Noir, couvert de lames écailleuses, souvent
revêtues de points rouges ou d’enduit jaune, friable et terne, d’odeur forte et
nauséeuse, que les philosophes définissent toxicum
et venenum, il tache les doigts lorsqu’on le touche et semble réunir tout
ce qui peut déplaire. C’est pourtant lui, ce primitif sujet des sages, vil et
méprisé des ignorants, qui est le seul, l’unique dispensateur de l’eau céleste,
notre premier mercure et le grand Alkaest. [Le terme alkaest, attribué tantôt à
Van Helmont, tantôt à Paracelse, serait l’équivalent du latin alcali est et donnerait la raison pour laquelle quantité d’artistes ont
travaillé à l’obtenir en partant des alcalins. Pour nous, alkaest dérive des
mots grecs ἀλκά, vocable dorien employé pour ἀλκή, force, vigueur, et εἰς, le
lieu ou encore ἑστία, foyer, le lieu ou le foyer de l’énergie.] C’est lui le
loyal serviteur et le sel de la terre que Mme Hillel-Erlanger appelle Gilly, et
qui fait triompher son maître de l’emprise de Véra. [Irène Hillel-Erlanger. Voyages en kaléidoscope. Paris, Georges
Crès, 1919.] Aussi l’a-t-on nommé le dissolvant universel, non pas qu’il soit
capable de résoudre tous les corps de la nature, – ce que beaucoup ont cru à
tort, – mais parce qu’il peut tout dans ce petit univers qu’est le Grand-Œuvre.
Au XVIIe siècle, époque de discussions passionnées entre chimistes et
alchimistes sur les principes de la vieille science, le dissolvant universel
fut l’objet de controverses ardentes. J.-H. Pott, qui s’appliqua à relever les
nombreuses formules de menstrues et s’efforça d’en
donner une analyse raisonnée, nous apporte surtout la preuve qu’aucun de leurs
inventeurs ne comprit ce que les Adeptes entendent par leur dissolvant. [J.-H.
Pott. Dissertations chymiques. T. I.
Dissertation sur les soufres des Métaux, soutenue à Hall, en 1716. Paris,
Th. Hérissant, 1759.] Quoique ceux-ci affirment que notre mercure est métallique
et homogène aux métaux, la plupart des chercheurs se sont obstinés à l’extraire
de matières plus ou moins éloignées du règne minéral. Certains croyaient le
préparer en saturant d’esprit volatil urineux (ammoniaque) un acide quelconque,
et circulaient ensuite ce mélange ; d’autres exposaient à l’air de l’urine
épaissie, dans le dessein d’y introduire l’esprit aérien, etc. Becker (Physica subterranea, Francofurti, 1669)
et Bohn (Épître sur l’insuffisance de
l’acide et de l’alcali) pensent que « l’alkaest est le principe mercuriel
le plus pur que l’on retire ou du mercure ou du sel marin, par des procédés
particuliers ». Zobel (Margarita
medicinalis) et l’auteur de Lullius
redivivus préparent leur dissolvant en saturant l’esprit de sel ammoniac
(acide chlorhydrique) avec de l’esprit de tartre (tartrate de potasse) et du
tartre cru (carbonate potassique impur). Hoffmann et Poterius volatilisent le
sel de tartre en le dissolvant d’abord dans l’eau, exposant la liqueur à la
putréfaction dans un vaisseau de bois de chêne, puis soumettant à la
sublimation la terre qui s’en est précipitée. « Un dissolvant qui laisse loin
derrière lui tous les autres, assure Pott, est le précipité qui résulte du
mélange du sublimé corrosif et du sel ammoniac. Quiconque saura l’employer
comme il faut pourra le regarder comme un véritable alkaest. » [Hoffmann. Notes sur Poterius, in Opera omnia, 16 vol. Genève, 1748 à
1754.] Le Fèvre, Agricola, Robert Fludd, de Nuysement, Le Breton, Etmuller et
d’autres encore, préfèrent l’esprit de rosée, ainsi que les extraits analogues
préparés « avec les pluies d’orage ou avec la pellicule grasse qui surnage les
eaux minérales ». Enfin, d’après Lenglet-Dufresnoy, Olaüs Borrichius (De Origine Chemiæ et in conspectu Chemicorum
celebriorum, num. XIV) « remarque que le capitaine Thomas Parry, Anglois, a
vu pratiquer en 1662 cette même science (l’alchimie) à Fez en Barbarie, et que
le grand alcahest, première matière de tous les philosophes, est connu depuis
longtemps en Afrique par les plus habiles artistes mahométans ». [Histoire de la Philosophie Hermétique.
Paris, Coustelier, 1742, t. I, p. 442.]
En résumé, toutes les recettes d’alkaest proposées par des
auteurs ayant surtout en vue la forme liquide attribuée au dissolvant
universel, sont inutiles, sinon fausses, et bonnes seulement pour la spagyrie.
Notre matière première est solide ; le mercure qu’elle fournit se présente
toujours sous l’aspect salin et avec une consistance dure. Et ce sel
métallique, ainsi que le dit fort justement Bernard Trévisan, s’extrait de la
Magnésie « par réitérée destruction d’icelle, en résolvant et sublimant ». À
chaque opération le corps se morcelle, se désagrège peu à peu, sans réaction
apparente, en abandonnant quantité d’impuretés ; l’extrait, purifié par
sublimations, perd également des parties hétérogènes, de telle sorte que sa
vertu se trouve condensée à la fin en une faible masse, de volume et de poids
très inférieurs à ceux du sujet minéral primitif. C’est ce que justifie très
exactement l’axiome espagnol ; car plus les réitérations sont nombreuses, plus
on fait de tort au corps brisé et dissocié, moins la quintessence qui en
provient a lieu de s’en repentir ; au contraire, elle augmente en force, en
pureté et en activité. Par là même, notre vampire acquiert le pouvoir de
pénétrer les corps métalliques, d’en attirer le soufre, ou leur véritable sang,
et permet au philosophe de l’assimiler au stryge nocturne des légendes
orientales.
Caisson 2 (pl. XXX). – Une couronne faite de feuilles et de
fruits : pommes, poires, coings, etc., est liée par des rubans dont les nœuds
serrent également quatre petits rameaux de laurier. L’épigraphe qui l’encadre
nous apprend que nul ne l’obtiendra s’il n’accomplit les lois du combat :
. NEMO . ACCIPIT . QVI . NON . LEGITIME . CERTAVERIT .
M. Louis Audiat voit en ce sujet une couronne de laurier ;
cela ne saurait nous surprendre : son observation est souvent imparfaite et
l’étude du détail ne le préoccupe guère. En réalité, ce n’est ni le lierre avec
lequel on couronnait les poètes antiques, ni le laurier doux au front des vainqueurs,
ni le palmier cher aux martyrs chrétiens, ni le myrthe, la vigne ou l’olivier
des dieux, qui sont ici figurés, mais tout simplement la couronne fructifère du
sage. Ses fruits marquent l’abondance des biens terrestres, acquise par la
pratique habile de l’agriculture céleste : voilà pour le profit et l’utilité ;
quelques branchettes de laurier, de relief si discret qu’on les distingue à
peine : voilà pour l’honneur du laborieux. Et pourtant, cette guirlande
rustique, que la sagesse propose aux investigateurs savants et vertueux, ne se
laisse pas gagner aisément. Notre philosophe nous le dit sans ambage : rude est le combat que l’artiste doit livrer
aux éléments, s’il veut triompher de la grande épreuve. Comme le chevalier
errant il lui faut orienter sa marche vers le mystérieux jardin des Hespérides
et provoquer l’horrible monstre qui en défend l’entrée. Tel est, pour demeurer
dans la tradition, le langage allégorique par lequel les sages entendent
révéler la première et la plus importante des opérations de l’Œuvre. En vérité,
ce n’est pas l’alchimiste en personne qui défie et combat le dragon hermétique,
mais une autre bête, également robuste, chargée de le représenter et que
l’artiste, en spectateur prudent, sans cesse prêt à intervenir, se doit d’encourager,
d’aider et de protéger. C’est lui le maître d’armes de ce duel étrange et sans
merci.
Peu d’auteurs ont parlé de cette première rencontre et du
danger qu’elle comporte. À notre connaissance, Cyliani est certainement
l’Adepte qui ait poussé le plus loin dans la description métaphorique qu’il en
donne. Cependant, nous n’avons découvert nulle part un récit aussi détaillé,
aussi exact en ses images, aussi près de la vérité et de la réalité que celui
du grand philosophe hermétique des temps modernes : de Cyrano Bergerac. On ne
connaît pas assez cet homme génial dont l’œuvre, mutilée à dessein, devait sans
doute embrasser toute l’étendue de la science. Quant à nous, nous n’avons guère
besoin du témoignage de M. de Sercy, affirmant que de Cyrano « reçut de l’Auteur
de la Lumière et de ce Maître des Sciences (Apollon), des lumières que rien ne
peut obscurcir, des connaissances où personne ne peut arriver », pour
reconnaître en lui un véritable et puissant initié. [Dédicace de l’Histoire comique des États et Empires du Soleil, adressée
par M. de Sercy à M. de Cyrano Mauvières, frère de l’auteur. Paris, Bauche,
1910.]
De Cyrano Bergerac met en scène deux êtres fantastiques,
figurant les principes Soufre et Mercure, issus des quatre éléments primaires :
la Salamandre sulfureuse, qui se plaît au milieu des flammes, symbolise l’air
et le feu dont le soufre possède la sécheresse et l’ardeur ignée, et la Remore
(aujourd’hui le Rémora), champion mercuriel, héritier de la terre et de l’eau
par ses qualités froides et humides. Ces noms sont choisis tout exprès et ne
doivent rien au caprice ni à la fantaisie. Σαλαμάνδρα, en grec, apparaît formé
de σαλ, anagramme de ἅλς, sel, et de μάνδρα, étable ; c’est le sel d’étable, le
sel d’urine des nitrières artificielles, le salpêtre des vieux spagyristes, – sal petri, sel de pierre, – qu’ils
désignaient encore sous l’épithète de Dragon. Remore, en grec Ἐχενηΐς, est ce
fameux poisson qui passait pour arrêter (selon certains) ou diriger (selon
d’autres) les vaisseaux naviguant sur les mers boréales, soumises à l’influence
de l’Étoile du nord. C’est l’échénéis dont parle le Cosmopolite, le dauphin
royal que les personnages du Mutus Liber s’évertuent à capturer, celui que
représente le poèle alchimique de P. F. Pfau, au musée de Winterthur (canton de
Zurich, Suisse), le même qui accompagne et pilote, sur le bas-relief ornant la
fontaine du Vertbois, le navire chargé d’une énorme pierre taillée. L’échénéis,
c’est le pilote de l’onde vive, notre mercure, l’ami fidèle de l’alchimiste, celui
qui doit absorber le feu secret, l’énergie ignée de la salamandre, et, enfin,
demeurer stable, permanent, toujours victorieux sous la sauvegarde et avec la
protection de son maître. Ces deux principes, de nature et de tendances
contraires, de complexion opposée, manifestent l’un pour l’autre une
antipathie, une aversion irréductibles. Mis en présence, ils s’attaquent
furieusement, se défendent avec âpreté, et le combat, sans trêve ni merci, ne
cesse que par la mort d’un des antagonistes. Tel est le duel ésotérique,
effroyable mais réel, que l’illustre de Cyrano nous raconte en ces termes.
« Je marchai environ l’espace de quatre cents stades, à la
fin desquels j’aperçus, au milieu d’une fort grande campagne, comme deux boules
qui, après avoir en bruissant tourné longtemps à l’entour l’une de l’autre,
s’approchoient et puis se reculoient. Et j’observai que, quand le heurt se
faisoit, c’étoit alors qu’on entendoit ces grands coups ; mais à force de
marcher plus avant, je reconnus que ce qui, de loin, m’avoit paru deux boules,
étoient deux animaux ; l’un desquels, quoique rond par en bas, formoit un
triangle par le milieu, et sa tête fort élevée, avec sa rousse chevelure qui
flottoit contremont, s’aiguisoit en pyramide ; son corps étoit troué comme un
crible, et, à travers ces pertuis déliés qui lui servoient de pores, on
apercevoit glisser de petites flammes qui sembloient le couvrir d’un plumage de
feu.
« En me promenant là tout autour, je rencontrai un Vieillard
fort vénérable qui regardoit ce fameux combat avec autant de curiosité que moi.
Il me fit signe de m’approcher : j’obéis et nous nous assîmes l’un auprès de
l’autre…
« Voici comment il me parla. « On verroit en ce globe où
nous sommes, les bois fort clairsemés, à cause du grand nombre de bêtes à feu qui
les désolent, sans les animaux glaçons qui, tous les jours, à la prière des
forêts leurs amies, viennent guérir les arbres malades ; je dis guérir, car, à
peine de leur bouche gelée ont-ils soufflé sur les charbons de cette peste,
qu’ils l’éteignent.
« Au monde de la Terre d’où vous êtes et d’où je suis, la
bête à feu s’appelle Salamandre, et l’animal glaçon y est connu sous le nom de
Remore. Or, vous saurez que les Remores habitent vers l’extrémité du pôle, au
plus profond de la mer Glaciale, et c’est la froideur évaporée de ces poissons,
à travers leurs écailles, qui fait geler en ces quartiers-là l’eau de mer,
quoique salée…
« Cette eau stigiade, de laquelle on empoisonna le grand
Alexandre, et dont la froideur pétrifia ses entrailles, étoit du pissat d’un de
ces animaux… Voilà pour ce qui est des animaux glaçons.
« Mais quant aux bêtes à feu, elles logent dans la terre,
sous des montagnes de bitume allumé, comme l’Etna, le Vésuve et le Cap Rouge.
Ces boutons, que vous voyez à la gorge de celui-ci, qui procèdent de
l’inflammation de son foie, ce sont… »
« Nous restâmes, après cela, sans parler, pour nous rendre
attentifs à ce fameux duel. La Salamandre attaquoit avec beaucoup d’ardeur,
mais la Remore soutenoit impénétrablement. Chaque heurt qu’ils se donnoient
engendroit un coup de tonnerre, comme il arrive dans les Mondes d’ici autour,
où la rencontre d’une nuée chaude avec une froide excite le même bruit. Des
yeux de la Salamandre, il sortoit, à chaque œillade de colère qu’elle dardoit
contre son ennemi, une rouge lumière dont l’air paroissoit allumée : en volant,
elle suoit de l’huile bouillante et pissoit de l’eau-forte. La Remore, de son
côté, grosse, pesante et carrée, montroit un corps tout écaillé de glaçons. Ses
larges yeux paroissoient deux assiettes de cristal, dont les regards portoient
une lumière si morfondante, que je sentois frissonner l’hiver sur chaque membre
de mon corps où elle les attachoit. Si je pensois mettre ma main au devant, ma
main en prenoit l’onglée ; l’air même, autour d’elle, atteint de sa rigueur,
s’épaississoit en neige ; la terre durcissoit sous ses pas, et je pouvois
compter les traces de la bête par le nombre des engelures qui m’accueilloient
quand je marchois dessus.
« Au commencement du combat, la Salamandre, à cause de la
vigoureuse contention de sa première ardeur, avoit fait suer la Remore ; mais,
à la longue, cette sueur s’étant refroidie, émailla toute la plaine d’un
verglas si glissant, que la Salamandre ne pouvoit joindre la Remore sans
tomber. Nous connûmes bien, le Philosophe et moi, qu’à force de choir et de se
relever tant de fois, elle s’étoit fatiguée ; car ces éclats de tonnerre,
auparavant si effroyables, qu’enfantoit le choc dont elle heurtoit son ennemie,
n’étoient plus que le bruit sourd de ces petits coups qui marquent la fin d’une
tempête, et ce bruit sourd, amorti peu à peu, dégénéra en un frémissement
semblable à celui d’un fer rouge plongé dans de l’eau froide. Quand la Remore
connut que le combat tiroit aux abois par l’affoiblissement du choc dont elle
se sentoit à peine ébranlée, elle se dressa sur un angle de son cube et se
laissa tomber de toute sa pesanteur sur l’estomac de la Salamandre, avec un tel
succès que le cœur de la pauvre Salamandre, où tout le reste de son ardeur
s’étoit concentrée, en se crevant fit un éclat si épouvantable que je ne sais
rien dans la Nature pour le comparer. Ainsi mourut la bête à feu sous la
paresseuse résistance de l’animal glaçon.
« Quelque temps après que la Remore se fut retirée, nous
approchâmes du champ de bataille, et le Vieillard s’étant ensuite enduit les
mains de la terre sur laquelle elle avoit marché, comme d’un préservatif contre
la brûlure, il empoigna le cadavre de la Salamandre. « Avec le corps de cet
animal, me dit-il, je n’ai que faire de feu dans ma cuisine ; car, pourvu qu’il
soit pendu à ma crémaillère, il fera bouillir et rôtir tout ce que j’aurois mis
à l’âtre. Quant aux yeux, je les garde soigneusement ; s’ils étoient nettoyés
des ombres de la mort, vous les prendriez pour deux petits soleils. Les Anciens
de notre Monde les savoient bien mettre en œuvre ; c’est ce qu’ils nommoient
des Lampes ardentes, et l’on ne les appendoit qu’aux sépultures pompeuses des
personnes illustres. Nos modernes en ont rencontré en fouillant quelques-uns de
ces fameux tombeaux ; mais leur ignorante curiosité les a crevés, en pensant
trouver, derrière les membranes rompues, ce feu qu’ils y voyaient reluire. »
[De Cyrano Bergerac, Histoire des
Oiseaux, dans l’Autre Monde. Histoire comique des États et Empires du Soleil.
Paris, Bauche, 1910, p. 79.]
[Les lampes ardentes, dites encore perpétuelles ou
inextinguibles, sont une des réalisations les plus surprenantes de la science
hermétique. Elles sont faites d’Élixir liquide, amené à l’état radiant et
maintenu dans un vide poussé aussi loin que possible. Dans son Dictionnaire des Arts et des Sciences, (Paris,
1731), Thomas de Corneille dit qu’en 1401, « un paysan déterra proche du Tibre,
à quelque distance de Rome, une lampe de Pallas qui avoit brûlé plus de deux
mille ans, comme on le vit par l’inscription, sans que rien eût pu l’éteindre.
La flamme s’en éteignit sitôt qu’on eut fait un petit trou dans la terre ». On
découvrit également, sous le pontificat de Paul III (1534-1549), dans le
tombeau de Tullia, fille de Cicéron, une lampe perpétuelle, brûlant encore et
donnant une vive lumière, bien que ce tombeau n’eût pas été ouvert depuis
quinze cent cinquante ans. Le Révérend S. Mateer, des Missions de Londres,
signale une lampe du temple de Trevaudrum, royaume de Travancore (Inde
méridionale) ; cette lampe, en or, brille « dans un creux recouvert d’une
pierre » depuis plus de cent vingt ans, et brûle encore à l’heure actuelle.]
Caisson 3 (pl. XXX). – Une pièce d’artillerie du XVIe siècle
est représentée au moment du coup de feu. Elle est entourée d’un phylactère
portant cette phrase latine :
. SI . NON . PERCVSSERO . TERREBO .
Si je n’atteins
personne, du moins j’épouvanterai.
Il est bien évident que le créateur du sujet entendait
parler au sens figuré. Nous comprenons qu’il s’adresse directement aux
profanes, aux instigateurs dépourvus de science, incapables par conséquent de
comprendre ces compositions, mais qui s’étonneront néanmoins de leur nombre
autant que de leur singularité et de leur incohérence. Les modernes sages
prendront ce labeur ancien pour une œuvre de dément. Et, de même que le canon
mal réglé surprend seulement par son tapage, notre philosophe pense avec raison
que s’il ne peut être compris de tous, tous seront étonnés du caractère
énigmatique, étrange et discordant qu’affectent tant de symboles et de scènes
inexplicables.
Aussi croyons-nous que le côté curieux et pittoresque de ces
figures retient surtout le spectateur, sans d’ailleurs l’éclairer. C’est là ce
qui a séduit M. Louis Audiat et tous les auteurs qui se sont occupés de
Dampierre ; leurs descriptions ne sont au fond qu’un bruit de paroles confuses,
vaines et sans portée. Mais, quoique nulles pour l’instruction du curieux,
elles nous apportent cependant le témoignage qu’aucun observateur, à notre
avis, n’a su découvrir l’idée générale cachée derrière ces motifs, ni la haute
portée du mystérieux enseignement qui s’en dégage.
Caisson 4 (pl. XXX). – Narcisse s’efforce de saisir, dans le
bassin où il s’est miré, sa propre image, cause de sa métamorphose en fleur,
afin qu’il puisse revivre grâce à ces eaux qui lui ont donné la mort :
. VT . PER . QVAS . PERIIT . VIVERE . POSSIT . AQVAS .
Les narcisses sont des végétaux à fleurs blanches ou jaunes,
et ce sont ces fleurs qui les ont fait distinguer par les mythologues et les
symbolistes ; elles offrent, en effet, les colorations respectives des deux
soufres chargés d’orienter les deux Magistères. Tous les alchimistes savent
qu’il faut se servir exclusivement du soufre blanc pour l’Œuvre à l’argent et
du soufre jaune pour l’Œuvre solaire, en évitant avec soin de les mélanger,
selon l’excellent conseil de Nicolas Flamel : il en résulterait une génération
monstrueuse, sans avenir et sans vertu.
Narcisse est ici l’emblème du métal dissous. Son nom grec,
Νάρκισσος, vient de la racine Νάρκη ou Νάρκα, engourdissement, torpeur. Or, les métaux réduits, dont la vie est
latente, concentrée, somnolente, paraissent de ce fait demeurer dans un état
d’inertie analogue à celui des animaux hibernants ou des malades soumis à
l’influence d’un narcotique (ναρκωτικός, rac. νάρκη). Aussi les dit-on morts,
par comparaison avec les métaux alchimiques que l’art a évertués et vitalisés.
Quant au soufre extrait par le dissolvant, – l’eau mercurielle du bassin, – il
reste le seul représentant de Narcisse, c’est-à-dire du métal dissocié et
détruit. Mais, de même que l’image réfléchie par le miroir des eaux porte tous
les caractères apparents de l’objet réel, de même le soufre garde les
propriétés spécifiques et la nature métallique du corps décomposé. De sorte que
ce soufre principe, véritable semence du métal, trouvant dans le mercure des
éléments nutritifs vivants et vivifiants, peut générer ensuite un être nouveau,
semblable à lui, d’essence supérieure toutefois, et capable d’obéir à la
volonté du dynamisme évolutif.
C’est donc avec raison que Narcisse, métal transformé en
fleur, ou soufre, – car le soufre, disent les philosophes, est la fleur de tous
les métaux, – espère retrouver l’existence, grâce à la vertu particulière des
eaux qui ont provoqué sa mort. S’il ne peut extraire son image de l’onde qui
l’emprisonne, celle-ci du moins lui permettra de la matérialiser en un « double
» chez lequel il retrouvera conservées ses caractéristiques essentielles.
Ainsi, ce qui cause la mort de l’un des principes donne la
vie à l’autre, puisque le mercure initial, eau métallique vivante, meurt pour
fournir au soufre du métal dissous les éléments de sa résurrection. C’est
pourquoi les anciens ont toujours affirmé qu’il fallait tuer le vif afin de
ressusciter le mort. La mise en pratique de cet axiome assure au sage la
possession du soufre vif, agent principal de la pierre et des transformations
que l’on en peut attendre. Il lui permet encore de réaliser le second axiome de
l’Œuvre : joindre la vie à la vie, en unissant le mercure premier-né de nature,
à ce soufre actif pour obtenir le mercure des philosophes, substance pure,
subtile, sensible et vivante. C’est là l’opération que les sages ont réservée
sous l’expression des noces chimiques, du
mariage mystique du frère et de la sœur, – car ils sont tous deux de même
sang et ont la même origine, – de Gabritius et de Beya, du Soleil et de la
Lune, d’Apollon et de Diane. Ce dernier vocable a fourni aux cabalistes la
fameuse enseigne d’Apollonius de Tyane, sous laquelle on a cru reconnaître un
prétendu philosophe, quoique les miracles de ce personnage fictif, de caractère
incontestablement hermétique, fussent, pour les initiés, revêtues du sceau
symbolique et consacrés à l’ésotérisme alchimique.
Caisson 5 (pl. XXX). – L’arche de Noé flotte sur les eaux du
Déluge, tandis qu’auprès d’elle une barque menace de sombrer. Dans le ciel du
sujet se lisent les mots
La vérité victorieuse…
Nous croyons avoir dit déjà que l’arche représente la totalité des matériaux
préparés et unis sous les noms divers de composé, rebis, amalgame, etc.,
lesquels constituent proprement l’archée, matière ignée, base de la pierre
philosophale. Le grec ἀρχή signifie commencement, principe, source, origine. Sous
l’action du feu externe, excitant le feu interne de l’archée, le compost tout
entier se liquéfie, revêt l’aspect de l’eau ; et cette substance liquide, que
la fermentation agite et boursoufle, prend, chez les auteurs, le caractère de
l’inondation diluvienne. D’abord jaunâtre et bourbeuse, on lui donne le nom de
laton ou laiton, qui n’est autre que celui de la mère de Diane et d’Apollon,
Latone. Les Grecs l’appelaient Λητώ, de λῆτος mis pour λήϊτος, avec le sens
ionien de bien commun, de maison commune (τὸ λήϊτον), significative de
l’enveloppe protectrice commune au double embryon. [Les linguistes veulent,
d’ailleurs, que Λητω se rapproche de Λαθειν, infinitif aoriste second de
Λανθανειν signifiant se tenir caché, échapper à tous
les yeux, être caché ou méconnu, en accord, pour nous, avec la phase ténébreuse
dont il sera bientôt question.] Notons, en passant, que les cabalistes, par un
de ces calembours dont ils sont coutumiers, ont enseigné que la fermentation
devait se faire à l’aide d’un vaisseau de bois, ou, mieux, dans un tonneau
coupé en deux, auquel ils appliquèrent l’épithète de chêne creux. Latone,
princesse mythologique, devient, dans le langage des Adeptes, la tonne, le
tonneau, ce qui explique pourquoi les débutants parviennent si difficilement à
identifier le vaisseau secret où fermentent nos matières.
Au bout du temps requis on voit monter à la superficie,
flotter et se déplacer sans cesse sous l’effet de l’ébullition, une très mince
pellicule, en ménisque, que les sages ont nommée l’Île philosophique [En particulier le Cosmopolite (Traité du Sel, p. 78) et l’auteur du
Songe Verd.], manifestation première de l’épaississement et de la coagulation.
C’est l’île fameuse de Délos, en grec Δῆλος, c’est-à-dire apparent, clair,
certain, laquelle assure un refuge inespéré à Latone fuyant la persécution de Junon,
et remplit le cœur de l’artiste d’une joie sans mélange. Cette île flottante,
que Poséidon, d’un coup de son trident, fit sortir du fond de la mer, est aussi
l’arche salvatrice de Noé portée sur les eaux du Déluge. « Cum viderem quod
aqua sensim crassior, nous dit Hermès, duriorque fieri inciperet, gaudebam ;
certo enim sciebam, ut invenirem quod querebam. » [« Quand je vis cette eau
devenir peu à peu plus épaisse, et qui commençait à durcir, alors je me
réjouissais, car je savais certainement que je trouverais ce que je cherchais.
»]
Progressivement, et sous l’action continue du feu interne,
la pellicule se développe, s’épaissit, gagne en étendue jusqu’à recouvrir toute
la surface de la masse fondue. L’île mouvante est alors fixée, et ce spectacle
donne à l’alchimiste l’assurance que le temps des couches de Latone est arrivé.
À ce moment, le mystère reprend ses droits. Une nuée lourde, obscure, livide,
monte et s’exhale de l’île chaude et stabilisée, couvre de ténèbres cette terre
en parturition, enveloppe et dissimule toutes choses de son opacité, remplit le
ciel philosophique des ombres cimmériennes (κιμμερικόν, vêtement de deuil) et,
dans la grande éclipse du soleil et de la lune, dérobe aux yeux la naissance
surnaturelle des jumeaux hermétiques, futurs parents de la pierre.
La tradition mosaïque rapporte que Dieu, vers la fin du
Déluge, fait souffler sur les eaux un vent chaud, qui les évapore et en abaisse
le niveau. Le sommet des montagnes émerge de l’immense nappe liquide, et
l’arche vient alors se poser sur le mont Ararat, en Arménie. Noé, ouvrant la
fenêtre du vaisseau, lâche le corbeau, lequel est, pour l’alchimiste et dans sa
minuscule Genèse, la réplique des ombres cimmériennes, de ces nuées ténébreuses
qui accompagnent l’élaboration cachée d’êtres nouveaux et de corps régénérés.
Par ces concordances, et le témoignage matériel du labeur
lui-même, la vérité s’affirme victorieuse, en dépit des négateurs, des
sceptiques, hommes de peu de foi, toujours prêts à rejeter, dans le domaine de
l’illusion et du merveilleux, la réalité positive qu’ils ne sauraient
comprendre parce qu’elle n’est point connue et moins encore enseignée.
Caisson 6 (pl. XXX). – Une femme, agenouillée au pied d’une
tombe sur laquelle on lit ce mot bizarre :
affecte le plus profond désespoir. La banderole qui
agrémente cette figure porte l’inscription :
. VICTA . JACET . VIRTVS .
La vertu gît vaincue…
Devise d’André Chénier, nous dit Louis Audiat, en guise d’explication, et sans
tenir compte du temps écoulé entre la Renaissance et la Révolution. Il n’est
pas ici question du poète, mais bien de la vertu du soufre, ou de l’or des
sages, lequel repose sous la pierre, attendant la décomposition complète de son
corps périssable. Car la terre sulfureuse, dissoute dans l’eau mercurielle,
prépare, par la mort du composé, la libération de cette vertu, qui est
proprement l’âme ou le feu du soufre. Et cette vertu, momentanément prisonnière
de l’enveloppe corporelle, ou cet esprit immortel, flottera sur les eaux
chaotiques, jusqu’à la formation du corps nouveau, ainsi que nous l’enseigne
Moïse dans la Genèse (ch. I, v. 2).
C’est donc l’hiéroglyphe de la mortification que nous avons
sous les yeux, et c’est lui qui se répète également dans les gravures de la Pretiosa Margarita novella dont Pierre
Bon de Lombardie a illustré son drame du Grand-Œuvre. Quantité de philosophes
ont adopté ce mode d’expression et voilé, sous des sujets funèbres ou macabres,
la putréfaction spécialement appliquée au second Œuvre, c’est-à-dire à
l’opération chargée de décomposer et de liquéfier le soufre philosophique, issu
du premier labeur, en Élixir parfait. Basile Valentin nous montre un squelette
debout sur son propre cercueil, dans l’une de ses Douze Clefs, et nous dépeint
une scène d’inhumation dans une autre. Flamel place non seulement les symboles
humanisés de l’Ars magna au charnier des Innocents, mais il décore sa plaque
tumulaire, que l’on voit exposée dans la chapelle du musée de Cluny, d’un
cadavre rongé de vers avec cette inscription :
De terre suis venu et
en terre retourne.
Senior Zadith enferme, à l’intérieur d’une sphère
transparente, un agonisant décharné. Henri de Linthaut dessine, sur un feuillet
du manuscrit de l’Aurore, le corps
inanimé d’un roi couronné, étendu sur la dalle mortuaire, tandis que son
esprit, sous la figure d’un ange, s’élève vers une lanterne perdue dans les
nues. Et nous-mêmes, après ces grands maîtres, avons exploité le même thème
dans le frontispice du Mystères des
Cathédrales.
Quant à la femme qui, sur la tombe de notre caisson, traduit
ses regrets en gestes désordonnés, elle figure la mère métallique du soufre ;
c’est à elle qu’appartient le vocable singulier gravé sur la pierre qui
recouvre son enfant : Taiacis. Ce
terme baroque, né sans doute d’un caprice de notre Adepte, n’est, en réalité,
qu’une phrase latine aux mots assemblés, et écrite à l’envers de manière à être
lue en commençant par la fin : Sic ai at, hélas ! ainsi du moins… (pourra-t-il
renaître). Suprême espoir au fond de la suprême douleur. Jésus lui-même dut
souffrir dans sa chair, mourir et demeurer trois jours au sépulcre, afin de
racheter les hommes, et de ressusciter ensuite dans la gloire de son
incarnation humaine et l’accomplissement de sa mission divine.
Caisson 7 (pl. XXX). – Représentée en plein vol, une colombe
tient en son bec un rameau d’olivier. Ce sujet est distingué par l’inscription
:
. SI . TE . FATA . VOCANT .
Si les destins t’y
appellent... L’emblème de la colombe au rameau vert nous est donné par
Moïse dans sa description du Déluge universel. Il est dit, en effet (Genèse,
ch. VIII, v. 11), que Noé, ayant donné l’essor à la colombe, celle-ci revint
vers le soir en rapportant une branche verte d’olivier. C’est là le signe par
excellence de la véritable voie et de la marche régulière des opérations. Car
le travail de l’Œuvre étant un abrégé et une réduction de la Création, toutes
les circonstances de l’ouvrage divin se doivent retrouver en petit dans celui
de l’alchimiste. En conséquence, lorsque le patriarche fait sortir de l’arche
le corbeau, nous devons entendre qu’il est question, pour notre Œuvre, de la
première couleur durable, c’est-à-dire de la couleur noire, parce que la mort
du composé, devenue effective, les matières se putréfient et prennent une
coloration bleue très sombre que ses reflets métalliques permettent de comparer
aux plumes du corbeau. D’ailleurs, le récit biblique précise que cet oiseau,
retenu par les cadavres, ne revient pas à l’arche. Toutefois, la raison
analogique qui fait attribuer à la couleur noire le terme de corbeau, n’est pas
uniquement fondée sur une identité d’aspect ; les philosophes ont encore donné
au compost parvenu à la décomposition le nom expressif de corps bleu (d’où provient le vieux juron médiéval), et les
cabalistes celui de corps beau, non
qu’il soit agréable à voir, mais parce qu’il apporte le premier témoignage
d’activité des matériaux philosophiques. Cependant, malgré le signe d’heureux
présage que les auteurs s’accordent à reconnaître dans l’apparition de la
couleur noire, nous recommandons de n’accueillir ces démonstrations qu’avec
réserve, en ne leur attribuant pas plus de valeur qu’elles n’en ont. Nous
savons combien il est facile de l’obtenir, même au sein de substances
étrangères, pourvu que celles-ci soient traitées selon les règles de l’art. Ce
critérium est donc insuffisant, bien qu’il justifie cet axiome connu, que toute
matière sèche se dissout et se corrompt dans l’humidité qui lui est naturelle
et homogène. C’est la raison pour laquelle nous mettons en garde le débutant et
lui conseillons, avant de se livrer aux transports d’une joie sans lendemain,
d’attendre prudemment la manifestation de la couleur verte, symptôme du
dessèchement de la terre, de l’absorption des eaux et de la végétation du
nouveau corps formé.
Ainsi, frère, si le ciel daigne bénir ton labeur et, selon
la parole de l’Adepte, si te fata vocant,
tu obtiendras d’abord le rameau d’olivier, symbole de paix et d’union des
éléments, puis la blanche colombe qui te l’aura apporté. Alors seulement tu
pourras être certain de posséder cette lumière admirable, don de
l’Esprit-Saint, que Jésus envoya, au cinquantième jour (Πεντηκοστή), sur ses
apôtres bien-aimés. Telle est la consécration matérielle du baptême initiatique
et de la révélation divine. « Et comme Jésus sortait de l’eau, nous dit saint
Marc (ch. I, v. 10), Jean vit tout à coup les cieux s’entr’ouvrir et le
Saint-Esprit descendre sur lui sous la forme corporelle d’une colombe. »
Caisson 8 (pl. XXX). – Deux avant-bras dont les mains se
joignent, sortent d’un cordon de nuages. Ils ont pour devise :
. ACCIPE . DAQVE . FIDEM .
Reçois ma parole et
donne-moi la tienne... Ce motif n’est, en somme, qu’une traduction du signe
utilisé par les alchimistes pour exprimer l’élément eau. Nuées et bras
composent un triangle à sommet dirigé en bas, l’hiéroglyphe de l’eau, opposée
au feu que symbolise un triangle semblable mais retourné.
Il est certain qu’on ne saurait comprendre notre première
eau mercurielle sous cet emblème d’union, puisque les deux mains serrées en
pacte de fidélité et d’attachement appartiennent à deux individualités
distinctes. Nous avons dit, et répétons ici, que le mercure initial est un
produit simple, et le premier agent chargé d’extraire la partie sulfureuse et
ignée des métaux. Toutefois, si la séparation du soufre par ce dissolvant lui
laisse retenir quelques portions de mercure, ou permette à celui-ci d’absorber
une certaine quantité de soufre, quoique ces combinaisons puissent recevoir la
dénomination de mercure philosophique, on ne doit pas cependant espérer
réaliser la pierre au moyen de cette seule mixtion. L’expérience démontre que
le mercure philosophique, soumis à la distillation, abandonne facilement son
corps fixe, laissant le soufre pur au fond de la cornue. D’autre part, et
malgré l’assurance des auteurs qui accordent au mercure la prépondérance dans
l’Œuvre, nous constatons que le soufre se désigne lui-même comme étant l’agent
essentiel, puisqu’en définitive c’est lui qui demeure, exalté sous le nom
d’Élixir ou multiplié sous celui de pierre philosophale, dans le produit final
de l’ouvrage. Ainsi le mercure, quel qu’il soit, reste soumis au soufre, car il
est le serviteur et l’esclave, lequel, se laissant absorber, disparaît et se
confond avec son maître. En conséquence, comme la médecine universelle est une
véritable génération, que toute génération ne se peut accomplir sans le secours
de deux facteurs, d’espèces semblable mais de sexe différent, nous devons
reconnaître que le mercure philosophique est impuissant à produire la pierre,
et cela parce qu’il est seul. C’est lui, pourtant, qui tient dans le travaille
rôle de femelle, mais celle-ci, disent d’Espagnet et Philalèthe, doit être unie
à un second mâle, si l’on veut obtenir le composé connu sous le nom de Rebis,
matière première du Magistère.
C’est le mystère de la parole cachée, ou verbum demissum, que notre Adepte a
reçue de ses prédécesseurs, qu’il nous transmet sous le voile du symbole, et
pour la conservation de laquelle il nous demande la nôtre, c’est-à-dire le
serment de ne point découvrir ce qu’il a jugé bon de garder secret : accipe daque fidem.
Caisson 9 (pl. XXX). – Sur un sol rocheux, deux colombes,
malheureusement décapitées, se font vis-à-vis. Elles portent pour épigraphe
l’adage latin :
. CONCORDIA . NVTRIT . AMOREM .
La concorde nourrit
l’amour... Vérité éternelle, dont nous retrouvons l’application partout
ici-bas, et que le Grand-Œuvre confirme par l’exemple le plus frappant qu’il
soit possible de rencontrer dans l’ordre des choses minérales. L’ouvrage
hermétique tout entier n’est, en effet, qu’une harmonie parfaite, réalisée
d’après les tendances naturelles des corps inorganiques entre eux, de leur
affinité chimique et, si le mot n’est pas trop excessif, de leur amour
réciproque.
Les deux oiseaux composants le sujet de notre bas-relief
représentent ces fameuses Colombes de Diane, objet du désespoir de tant de
chercheurs, et célèbre énigme qu’imagina Philalèthe pour recouvrir l’artifice
du double mercure des sages. En proposant à la sagacité des aspirants cette
obscure allégorie, le grand Adepte ne s’est point étendu sur l’origine de ces
oiseaux ; il enseigne seulement, de la façon la plus brève, que « les Colombes
de Diane sont enveloppées inséparablement dans les embrassements éternels de
Vénus ». Or, les alchimistes anciens plaçaient sous la protection de Diane «
aux cornes lunaires » ce premier mercure dont nous avons maintes fois parlé
sous le nom de dissolvant universel. Sa blancheur, son éclat argentin lui
valurent aussi l’épithète de Lune des
Philosophes et de Mère de la pierre ;
c’est dans ce sens qu’Hermès l’entend lorsqu’il dit, en parlant de l’Œuvre : «
Le Soleil est son père et la Lune sa mère. » Limojon de Saint-Didier, pour
aider l’investigateur à déchiffrer l’énigme, écrit dans l’Entretien d’Eudoxe et de Pyrophile : « Considérez enfin par quels
moyens Geber enseigne de faire les sublimations requises à cet art ; pour moy,
je ne puis faire davantage que de faire le même souhait qu’a fait un autre
philosophe : Sidera Veneris, et
corniculatæ Dianæ tibi propitia sunto. » [« Que l’astre de Vénus et les
cornes de Diane te soient favorables. »]
On peut donc envisager les Colombes de Diane comme deux
parties de mercure dissolvant, – les deux pointes du croissant lunaire, –
contre une de Vénus, laquelle doit tenir étroitement embrassées ses colombes
favorites. La correspondance se trouve confirmée par la double qualité,
volatile et aérienne, du mercure initial dont l’emblème a toujours été pris
parmi les oiseaux, et par la matière même d’où provient le mercure, terre
rocailleuse, chaotique, stérile sur laquelle les colombes se reposent.
Lorsque, nous dit l’Écriture, la Vierge Marie eut accompli,
selon la loi de Moïse, les sept jours de la purification (Exode, XIII, 2),
Joseph l’accompagna au temple de Jérusalem, afin d’y présenter l’Enfant et
offrir la victime, conformément à la loi du Seigneur (Lévitique, XII, 6, 8),
savoir : un couple de tourterelles ou deux petits de colombes. Ainsi apparaît,
dans le texte sacré, le mystère de l’Ornithogale, ce fameux lait des oiseaux, – Ὀρνίθιον γάλα, –
dont les grecs parlaient comme d’une chose extraordinaire et fort rare. «
Traire le lait des oiseaux » (Ὀρνίθιον γάλα ἀμέλγειν) était chez eux un
proverbe qui équivalait à réussir, à connaître la faveur du destin et le succès
en toute entreprise. Et nous devons convenir qu’il faut être l’élu de la
Providence pour découvrir les colombes de Diane et pour posséder l’ornithogale,
synonyme hermétique du Lait de vierge
cher à Philalèthe. Ὄρνις, en grec, désigne non seulement l’oiseau en général,
mais plus expressément le coq et la poule, et c’est peut-être de là que dérive
le vocable ὀρνίθιον γάλα, lait de poule, obtenu en délayant un jaune d’œuf dans
du lait chaud. Nous n’insisterons pas sur ces rapports, parce qu’ils
dévoileraient l’opération secrète cachée sous l’expression des colombes de Diane. Disons cependant que
les plantes appelées ornithogales sont des liliacées bulbeuses, à fleurs d’un
beau blanc, et l’on sait que le lis est, par excellence, la fleur emblématique
de Marie.
IX (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Sixième série (pl. XXXI).
 |
| Planche XXXI |
Caisson 1. — Perçant les nuées, une main d’homme lance
contre un rocher sept boules qui rebondissent vers elle. Ce bas-relief est orné
de l’inscription :
Heurté, je rebondis…
Image de l’action et de la réaction, ainsi que de l’axiome hermétique Solve et coagula, dissous et coagule.
Un sujet analogue se remarque sur l’un des caissons du
plafond de la chapelle Lallemant, à Bourges ; mais les boules y sont remplacées
par des châtaignes. Or, ce fruit auquel son péricarpe épineux a fait donner le
nom vulgaire de hérisson (en grec ἐχῖνος, oursin, châtaigne de mer), est une
figuration assez exacte de la pierre philosophale telle qu’on l’obtient par la
voie brève. Elle paraît, en effet, constituée d’une sorte de noyau cristallin
et translucide, à peu près sphérique, de couleur semblable à celle du rubis
balai, enfermé dans une capsule plus ou moins épaisse, rousse, opaque, sèche et
couverte d’aspérités, laquelle, à la fin du travail, est souvent crevassée,
parfois même ouverte, comme le brou des noix et des châtaignes. Ce sont donc
bien les fruits du labeur hermétique que la main céleste jette contre le
rocher, emblème de notre substance mercurielle. Chaque fois que la pierre, fixe
et parfaite, est reprise par le mercure afin de s’y dissoudre, de s’y nourrir
de nouveau, d’y augmenter non seulement en poids et en volume, mais encore en
énergie, elle retourne par la coction à son état, à sa couleur et à son aspect
primitifs. On peut dire qu’après avoir touché le mercure elle revient à son
point de départ. Ce sont ces phases de chute et d’ascension, de solution et de
coagulation qui caractérisent les multiplications successives qui donnent à
chaque renaissance de la pierre une puissance théorique décuple de la
précédente. Toutefois, et quoique beaucoup d’auteurs n’envisagent aucune limite
à cette exaltation, nous pensons avec d’autres philosophes qu’il serait
imprudent, au moins en ce qui concerne la transmutation et la médecine, de
dépasser la septième réitération. C’est la raison pour laquelle Jean Lallemant
et l’Adepte de Dampierre n’ont figuré que sept boules ou châtaignes sur les
motifs dont nous parlons.
Illimitée pour les philosophes spéculatifs, la
multiplication est cependant bornée dans le domaine pratique. Plus la pierre
progresse, plus elle devient pénétrante et d’élaboration rapide : elle n’exige,
à chaque degré d’augmentation, que le huitième du temps demandé par l’opération
précédente. Généralement, – et nous considérons ici la voie longue, – il est
rare que la quatrième réitération réclame plus de deux heures ; la cinquième
est donc accomplie en une minute et demie, tandis que douze secondes
suffiraient à parachever la sixième : l’instantanéité d’une telle opération la
rendrait impraticable. D’autre part, l’intervention du poids et du volume, sans
cesse accrus, obligerait à réserver une grande partie de la production, faute
d’une quantité proportionnelle de mercure, toujours long et fastidieux à
préparer. Enfin, la pierre multipliée aux degrés cinquième et sixième
exigerait, étant donné son pouvoir igné, une masse importante d’or pur pour
l’orienter vers le métal, – sinon on s’exposerait à la perdre en entier. Il est
donc préférable, à tout point de vue, de ne pas pousser trop loin la subtilité
d’un agent doué déjà d’une énergie considérable, à moins que l’on ne veuille,
quittant l’ordre des possibilités métalliques et médicales, posséder ce Mercure
universel, brillant et lumineux dans l’obscurité, afin d’en construire la lampe
perpétuelle. Mais le passage de l’état solide à l’état liquide, qui se doit
réaliser en ce lieu, étant éminemment dangereux, ne peut être tenté que par un
maître très savant et d’une habileté consommée…
De tout ce qui précède, nous devons conclure que les
impossibilités matérielles signalées à propos de la transmutation, tendent à
ruiner la thèse d’une progression géométrique croissante et indéfinie, basée
sur le nombre dix cher aux théoriciens purs. Gardons-nous de l’enthousiasme
irréfléchi, et ne laissons jamais circonvenir notre jugement par les arguments
spécieux, les théories brillantes, mais creuses, des amateurs de prodigieux. La
science et la nature nous réservent assez de merveilles pour nous satisfaire,
sans que nous éprouvions le besoin d’y ajouter encore les vaines fantaisies de
l’imagination.
Caisson 2 (pl. XXXI). – C’est un arbre mort, aux branches
coupées, aux racines déchaussées, que nous présente ce bas-relief. Il ne porte
point d’inscription, mais seulement deux signes de notation alchimique gravés
sur un cartouche ; l’un, figure schématique du niveau, exprime le Soufre ;
l’autre, triangle équilatéral à sommet supérieur, désigne le Feu.
L’arbre desséché est un symbole des métaux usuels réduits de
leurs minerais et fondus, auxquels les hautes températures des fours
métallurgiques ont fait perdre l’activité qu’ils possédaient dans leur gîte
naturel. C’est pourquoi les philosophes les qualifient morts et les
reconnaissent impropres au travail de l’Œuvre, jusqu’à ce qu’ils soient revivifiés,
ou réincrudés selon le terme consacré, par ce feu interne qui ne les abandonne
jamais complètement. Car les métaux, fixés sous la forme industrielle que nous
leur connaissons, gardent encore, au plus profond de leur substance, l’âme que
le feu vulgaire a resserrée et condensée, mais qu’il n’a pu détruire. Et cette
âme, les sages l’ont nommée feu ou soufre, parce qu’elle est véritablement
l’agent de toutes les mutations, de tous les accidents observés dans la matière
métallique, et cette semence incombustible que rien ne peut ruiner tout à fait,
ni la violence des acides forts, ni l’ardeur de la fournaise. Ce grand principe
d’immortalité, chargé par Dieu même d’assurer, de maintenir la perpétuité de
l’espèce et de reformer le corps périssable, subsiste et se retrouve jusque
dans les cendres des métaux calcinés, alors que ceux-ci ont souffert la
désagrégation de leurs parties et vu consumer leur enveloppe corporelle.
Les philosophes jugèrent donc, non sans raison, que les
qualités réfractaires du soufre, sa résistance au feu, ne pouvaient appartenir
qu’au feu ou à quelque esprit de nature ignée. C’est ce qui les a conduits à
lui donner le nom sous lequel il est désigné et que certains artistes croient
provenir de son aspect, bien qu’il n’offre aucun rapport avec le soufre commun.
En grec, soufre se dit θεῖον, mot dont la racine est θεῖος, qui signifie divin,
merveilleux, surnaturel ; τὸ θεῖον n’exprime pas seulement la divinité, mais
encore le côté magique, extraordinaire d’une chose. Or, le soufre philosophique,
considéré comme le dieu et l’animateur du Grand-Œuvre, révèle par ses actions
une énergie formatrice comparable à celle de l’Esprit divin. Ainsi, et quoique
qu’il faille attribuer la préséance au mercure, – pour demeurer dans l’ordre
des acquisitions successives, – nous devons reconnaître que c’est au soufre,
âme incompréhensible des métaux, que notre pratique est redevable de son
caractère mystérieux et en quelque sorte surnaturel.
Cherchez donc le soufre dans le tronc mort des métaux
vulgaires, et vous obtiendrez en même temps ce feu naturel et métallique qui
est la clef principale du labeur alchimique. « C’est là, dit Limojon de
Saint-Didier, le grand mystère de l’art, puisque tous les autres dépendent de
l’intelligence de celuy-cy. Que je serois satisfait, ajoute l’auteur, s’il
m’estoit permis de vous expliquer ce secret sans équivoque ; mais je ne puis
faire ce qu’aucun philosophe n’a cru estre en son pouvoir. Tout ce que vous
pouvez raisonnablement attendre de moy, c’est de vous dire que le feu naturel
est un feu en puissance, qui ne brûle pas les mains, mais qui fait paraître son
efficacité pour peu qu’il soit excité par le feu extérieur. »
Caisson 3 (pl. XXXI). – Une pyramide hexagonale, faite de
plaques de tôle rivées, porte, accrochés à ses parois, divers emblèmes de
chevalerie et d’hermétisme, pièces d’armure et pièces honorables : targes,
armet, brassard, gantelets, couronne et guirlandes. Son épigraphe est tirée
d’un vers de Virgile (Énéide, XI, 641) :
. SIC . ITVR . AD . ASTRA .
C’est ainsi qu’on
s’immortalise... Cette construction pyramidale, dont la forme rappelle
celle de l’hiéroglyphe adopté pour désigner le feu, n’est autre que l’Athanor,
mot par lequel les alchimistes signalent le fourneau philosophique
indispensable à la maturation de l’Œuvre. Deux portes de côté y sont ménagées
et se font vis-à-vis ; elles obturent des fenêtres vitrées qui permettent
l’observation des phases du travail. Une autre, située à la base, donne accès
au foyer ; enfin, une petite plaque, près du sommet, sert de registre et de
bouche d’évacuation aux gaz issus de la combustion. À l’intérieur, si nous nous
en rapportons aux descriptions très détaillées de Philalèthe, Le Tesson, Salmon
et autres, ainsi qu’aux reproductions de Rupescissa, Sgobbis, Pierre Vicot,
Huginus à Barma, etc., l’Athanor est agencé de manière à recevoir une écuelle
de terre ou de métal, appelée nid ou arène, parce que l’œuf y est soumis à
incubation dans le sable chaud (latin, arena, sable). Quant au combustible
utilisé pour le chauffage, il paraît assez variable, quoique beaucoup d’auteurs
accordent leur préférence aux lampes thermogènes.
Du moins est-ce là ce que les maîtres enseignent au sujet de
leur fourneau. Mais l’Athanor, demeure du feu mystérieux, se réclame d’une
conception moins vulgaire. Par ce four secret, prison d’une invisible flamme,
il nous paraît plus conforme à l’ésotérisme hermétique d’entendre la substance
préparée, – amalgame ou rebis, – servant d’enveloppe et de matrice au noyau
central où sommeillent ces facultés latentes que le feu commun va bientôt
rendre actives. La matière seule étant le véhicule du feu naturel et secret,
immortel agent de toutes nos réalisations, reste pour nous l’unique et
véritable Athanor (du grec Ἀθάνατος, qui se renouvelle et ne meurt jamais).
Philalèthe nous dit, à propos du feu secret, dont les sages ne sauraient se
passer, puisque c’est lui qui provoque toutes les métamorphoses au sein du
composé, qu’il est d’essence métallique et d’origine sulfureuse. On le
reconnaît minéral, parce qu’il naît de la prime substance mercurielle, source
unique des métaux ; sulfureux, parce que ce feu, dans l’extraction du soufre
métallique, a pris les qualités spécifiques du « père des métaux ». C’est donc
un feu double, – l’homme double igné de Basile Valentin, – qui renferme à la
fois les vertus attractives, agglutinantes et organisatrices du mercure, et les
propriétés siccatives, coagulantes et fixatives du soufre. Pour peu que l’on
ait quelque teinture de philosophie, on comprendra facilement que ce double
feu, animateur du rebis, ayant seulement besoin du secours de la chaleur pour
passer du potentiel à l’actuel, et rendre sa puissance effective, ne saurait
appartenir au fourneau, bien qu’il représente métaphoriquement notre Athanor,
c’est-à-dire le lieu de l’énergie, du principe d’immortalité enclos dans le
composé philosophal. Ce double feu est le pivot de l’art et, selon l’expression
de Philalèthe, « le premier agent qui fait tourner la roue et mouvoir l’essieu
» ; aussi le désigne-t-on souvent par l’épithète feu de roue, parce qu’il paraît développer son action selon un mode
circulaire, dont le but est la conversion de l’édifice moléculaire, rotation
symbolisée dans la roue de Fortune et dans l’Ouroboros.
Ainsi, la matière détruite, mortifiée puis recomposée en un
nouveau corps, grâce au feu secret qu’excite celui du fourneau, s’élève
graduellement à l’aide des multiplications, jusqu’à la perfection du feu pur,
voilée sous la figure de l’immortel Phénix : sic itur ad astra. De même l’ouvrier, fidèle serviteur de la
nature, acquiert, avec la connaissance sublime, le haut titre de chevalier,
l’estime de ses pairs, la reconnaissance de ses frères et l’honneur, plus
enviable que toute la gloire mondaine, de figurer parmi les disciples d’Élie.
Caisson 4 (pl. XXXI). – Clos de son étroit couvercle, la
panse rebondie mais fendue, un vulgaire pot de terre remplit, de sa majesté
plébéienne et lézardée, la surface de ce caisson. Son inscription affirme que
le vase dont nous voyons l’image doit s’ouvrir de lui-même et rendre manifeste,
par sa destruction, l’achèvement de ce qu’il renferme :
. INTVS . SOLA . FIENT . MANIFESTA . RVINA .
Parmi tant de figures diverses, d’emblèmes avec lesquels il
fraternise, notre sujet paraît d’autant plus original que son symbolisme se
rapporte à la voie sèche, dite encore Œuvre de Saturne, aussi rarement traduite
en iconographie que décrite dans les textes. Basée sur l’emploi de matériaux
solides et cristallisés, la voie brève (ars
brevis) exige seulement le concours du creuset et l’application de
températures élevées. Cette vérité, Henckel l’avait entrevue lorsqu’il remarque
que « l’artiste Élias, cité par Helvétius, prétend que la préparation de la
pierre philosophale se commence et s’achève en quatre jours de temps, et qu’il a
montré, en effet, cette pierre encore adhérente aux tessons du creuset ; il me
semble, poursuit l’auteur, qu’il ne serait pas si absurde de mettre en question
si ce que les alchimistes appellent des grands mois, ne seroient pas autant de
jours, – ce qui seroit un espace de temps très borné, – et s’il n’y auroit pas
une méthode dans laquelle toute l’opération ne consisteroit qu’à
tenir longtemps les matières dans le plus grand degré de fluidité, ce qu’on
obtiendroit par un feu violent, entretenu par l’action des soufflets ; mais
cette méthode ne peut pas s’exécuter dans tous les laboratoires, et peut-être
même tout le monde ne la trouveroit-il pas praticable. » [J.-F. Henckel. Traité de l’Appropriation, dans Pyritologie ou Histoire naturelle de la
Pyrite. Paris, J.-T. Hérissant, 1760, p. 375, § 416.]
Mais, à l’inverse de la voie humide, dont les ustensiles de
verre permettent le contrôle facile et l’observation juste, la voie sèche ne
peut éclairer l’opérateur, à quelque moment qu’il en soit du travail. Aussi,
quoique le facteur temps, réduit au minimum, constitue un avantage sérieux dans
la pratique de l’ars brevis, en
revanche, la nécessité des hautes températures présente le grave inconvénient
d’une incertitude absolue quant à la marche de l’opération. Tout se passe dans
le plus profond mystère à l’intérieur du creuset soigneusement clos, enfoui au
centre des charbons incandescents. Il importe donc d’être très expérimenté, de
bien connaître la conduite et la puissance du feu, puisqu’on ne saurait, du commencement
à la fin, y découvrir la moindre indication. Toutes les réactions
caractéristiques de la voie humide étant indiquées chez les auteurs classiques,
il est possible à l’artiste studieux d’acquérir les points de repère assez
précis pour l’autoriser à entreprendre son long et pénible ouvrage. Ici, au
contraire, c’est dépourvu de tout guide que le voyageur, hardi jusqu’à la
témérité, s’engage en ce désert aride et brûlé. Nulle route tracée, nul indice,
nul jalon ; rien que l’inertie apparente de la terre, de la roche, du sable. Le
brillant kaléidoscope des phases colorées n’égaie point sa marche indécise ;
c’est en aveugle qu’il poursuit son chemin, sans autre certitude que celle de
sa foi, sans autre espoir que sa confiance en la miséricorde divine…
Pourtant, à l’extrémité de sa carrière, l’investigateur
apercevra un signe, le seul, celui dont l’apparition indique le succès et
confirme la perfection du soufre par la fixation totale du mercure ; ce signe
consiste dans la rupture spontanée du vaisseau. Le temps expiré, en découvrant
latéralement une partie de sa paroi, on remarque, quand l’expérience est
réussie, une ou plusieurs lignes d’une clarté éblouissante, nettement visibles
sur le fond moins éclatant de l’enveloppe. Ce sont les fêlures révélatrices de
l’heureuse naissance du jeune roi. De même qu’au terme de l’incubation l’œuf de
poule se brise sous l’effort du poussin, de même la coque de notre œuf se rompt
dès que le soufre est achevé. Il y a, entre ces effets, une évidente analogie,
malgré la diversité des causes, car, dans l’Œuvre minéral, la rupture du
creuset ne peut logiquement être attribuée qu’à une action chimique,
malheureusement impossible à concevoir ni à expliquer. Notons cependant que le
fait, fort connu, se produit fréquemment sous l’influence de certaines
combinaisons de moindre intérêt. C’est ainsi, par exemple, qu’en abandonnant
des creusets neufs ayant servi une seule fois à la fusion de verres
métalliques, à la production d’hepar sulphuris ou d’antimoine diaphorétique, et
après les avoir bien nettoyés, on les trouve fissurés au bout de quelques
jours, sans qu’on puisse découvrir la raison obscure de ce phénomène tardif.
L’écartement considérable de leur panse montre que la fracture semble se
produire par la poussée d’une force expansive, agissant du centre vers la
périphérie, à la température ambiante et longtemps après usage des vaisseaux.
Signalons enfin la concordance remarquable qui existe entre
le motif de Dampierre et celui de Bourges (hôtel Lallemant, plafond de la
chapelle). Parmi les caissons hermétiques de celui-ci, on voit également un pot
de terre, incliné, dont l’ouverture, évasée et fort large, est obturée à l’aide
d’une membrane de parchemin liée sur les bords. Sa panse, trouée, laisse
échapper de belles macles de différentes grosseurs. L’indication de la forme
cristalline du soufre, obtenu par voie sèche, est donc très nette et vient
confirmer, en le précisant, l’ésotérisme de notre bas-relief.
Caisson 5 (pl. XXXI). – Une main céleste, dont le bras est
bardé de fer, brandit l’épée et la spatule. Sur le phylactère on lit ces mots
latins :
. PERCVTIAM . ET . SANABO .
Je blesserai et je
guérirai… Jésus a dit de même : « Je tuerai et je ressusciterai. » Pensée
ésotérique d’une importance capitale dans l’exécution capitale du Magistère. «
C’est la première clef, assure Limojon de Saint-Didier, celle qui ouvre les
prisons obscures dans lequel le soufre est renfermé ; c’est elle qui sait
extraire la semence du corps, et qui forme la pierre des philosophes par la
conjonction du mâle avec la femelle, de l’esprit avec le corps, du soufre avec
le mercure. Hermès a manifestement démontré l’opération de cette première clef
par ces paroles : De cavernis metallorum
occultus est, qui lapis est venerabilis, colore splendidus, mens sublimis et
mare patens. » [« Il (le soufre) est caché au plus profond des métaux ;
c’est lui qui est la pierre vénérable, de couleur éclatante, une âme élevée et
une vaste mer. »] [Le Triomphe
hermétique. Lettre aux Vrays Disciples d’Hermès. Op cit., p. 127.]
L’artifice cabalistique, sous lequel notre Adepte a
dissimulé la technique que Limojon cherche à nous enseigner, consiste dans le
choix du double instrument figuré sur notre caisson. L’épée qui blesse, la
spatule chargée d’appliquer le baume guérisseur, ne sont en vérité qu’un seul
et même agent doué du double pouvoir de tuer et de ressusciter, de mortifier et
de régénérer, de détruire et d’organiser. Spatule, en grec, se dit σπάθη ; or,
ce mot signifie également glaive, épée,
et tire son origine de σπάω, arracher, extirper, extraire. Nous avons donc bien ici l’indication
exacte du sens hermétique fourni par la spatule et par l’épée. Dès lors,
l’investigateur en possession du dissolvant, seul facteur capable d’agir sur
les corps, de les détruire et d’en extraire la semence, n’aura qu’à rechercher
le sujet métallique qui lui paraîtra le mieux approprié à remplir son dessein.
Ainsi, le métal dissous, broyé, « mis en pièces », lui abandonnera ce grain
fixe et pur, esprit qu’il porte en soi, gemme brillante, parée de magnifique
couleur, première manifestation de la pierre des sages, Phœbus naissant et père
effectif du grand Élixir. Dans un dialogue allégorique entre un monstre replié
au fond d’une obscure caverne, pourvu de « sept cornes pleines d’eaux », et l’alchimiste errant, pressant de questions ce sphinx
débonnaire, Jacques Tesson fait parler ainsi ce représentant fabuleux des sept
métaux vulgaires : « Il faut que tu entendes, lui dit-il, que je suis descendu
des régions célestes et suis tombé icy-bas, en ces cavernes de la terre, où je
me suis nourry un espace de tems ; mais je ne désire rien plus que d’y
retourner ; et le moyen de ce faire, c’est que tu me tues et puis que tu me
ressuscites, et de l’instrument que tu me tueras, tu me ressusciteras. Car, comme
dit la blanche colombe, celuy qui m’a tué me fera revivre. » [Jacques Tesson, Le Lyon verd ou l’Œuvre des Sages.
Premier traité. Ms. cité.]
Nous pourrions faire une intéressante remarque au sujet du
moyen, ou instrument, expressément figuré par le brassard d’acier dont est muni
le bras céleste, car aucun détail ne doit être négligé dans une étude de ce
genre ; mais nous estimons qu’il convient de ne point tout dire, et préférons
laisser à qui voudra s’en donner la peine le soin de déchiffrer cet hiéroglyphe
complémentaire. La science alchimique ne s’enseigne pas ; chacun doit
l’apprendre soi-même, non pas de manière spéculative, mais bien à l’aide d’un
travail persévérant, en multipliant les essais et les tentatives de façon à
toujours soumettre les productions de la pensée au contrôle de l’expérience.
Celui qui craint le labeur manuel, la chaleur des fourneaux, la poussière du
charbon, le danger des réactions inconnues et l’insomnie des longues veilles,
celui-là ne saura jamais rien.
Caisson 6 (pl. XXXI). – Un lierre est figuré enroulé autour
d’un tronc d’arbre mort, 264 dont toutes les branches ont été coupées de main
d’homme. Le phylactère qui complète ce bas-relief porte les mots :
L’auteur anonyme de l’Ancienne
Guerre des Chevaliers, dans un dialogue entre la pierre, l’or et le
mercure, fait dire à l’or que la pierre est un ver gonflé de venin, et l’accuse
d’être l’ennemie des hommes et des métaux. Rien n’est plus vrai ; à telle
enseigne que d’autres reprochent à notre sujet de contenir un poison
redoutable, dont la seule odeur, affirment-ils, suffirait à provoquer la mort.
C’est cependant de ce minéral toxique qu’est faite la médecine universelle, à
laquelle aucune maladie humaine ne résiste, pour incurable qu’elle puisse être
reconnue. Mais ce qui lui donne toute sa valeur et le rend infiniment précieux
aux yeux du sage, c’est l’admirable vertu qu’il possède de revivifier les
métaux réduits et fondus, et de perdre ses propriétés vénéneuses en leur
laissant son activité propre. Aussi apparaît-il comme l’instrument de la
résurrection et du rachat des corps métalliques, morts sous la violence du feu
de réduction, raison pour laquelle il porte dans son blason le signe du
Rédempteur, la croix.
Par ce que nous venons de dire, le lecteur aura compris que
la pierre, c’est-à-dire notre sujet minéral, est figurée sur le présent motif
par le lierre, plante vivace, d’odeur forte, nauséabonde, tandis que le métal a
pour représentant l’arbre inerte et mutilé. Car ce n’est pas un arbre sec,
simplement dépourvu de feuillage et réduit à son squelette, que l’on voit ici :
il exprimerait alors, pour l’hermétiste, le soufre en sa sécheresse ignée ;
c’est un tronc, volontairement mutilé, que la scie a amputé de ses maîtresses
branches. Le verbe grec πρίω signifie également scier, couper avec la scie et
étreindre, serrer, lier fortement. Notre arbre, étant à la fois scié et
étreint, nous devons penser que le créateur de ces images a désiré indiquer
clairement le métal et l’action dissolvante exercée contre lui. Le lierre,
embrassant le tronc comme pour l’étouffer, traduit bien la dissolution par le
sujet préparé, plein de vigueur et de vitalité ; mais cette dissolution, au
lieu d’être ardente, effervescente et rapide, semble lente, difficile, toujours
imparfaite. C’est que le métal, quoique entièrement attaqué, n’est solubilisé
qu’en partie ; aussi est-il recommandé de réitérer fréquemment l’affusion de
l’eau sur le corps, pour en extraire le soufre ou la semence « qui fait toute
l’énergie de notre pierre ». Et le soufre métallique reçoit la vie de son
ennemi même, en réparation de son inimitié et de sa haine. Cette opération, que
les sages ont appelée réincrudation ou retour à l’état primitif, a surtout pour
objet l’acquisition du soufre et sa revivification par
le mercure initial. Il ne faudrait donc pas prendre à la lettre ce retour à la
matière originelle du métal traité, puisqu’une grande partie du corps, formée
d’éléments grossiers, hétérogènes, stériles ou mortifiés, n’est plus susceptible
de régénération. Quoi qu’il en soit, il suffit pour l’artiste d’obtenir ce
soufre principe, séparé du métal ouvert et rendu vivant, grâce au pouvoir
incisif de notre premier mercure. Avec ce corps nouveau, où l’amitié et l’harmonie remplacent l’aversion, – car les vertus et
propriétés respectives des deux natures contraires sont confondues en lui, – il
pourra espérer parvenir d’abord au mercure philosophique, par la médiation de
cet agent essentiel, puis à l’Élixir, objet de ses désirs secrets.
Caisson 7 (pl. XXXI). – Là où Louis Audiat reconnaît la
figure de Dieu le Père, nous voyons simplement celle d’un centaure, qu’une
banderole, portant les sigles du Sénat et du peuple romain, cache à demi. Le
tout décore un étendard dont la hampe est solidement fichée en terre.
Il s’agit donc bien d’une enseigne romaine, et l’on peut
conclure que le sol sur lequel elle flotte est lui-même romain. D’ailleurs, les
lettres
abréviatives des mots Senatus
Populusque Romanus, accompagnent ordinairement les aigles et forment, avec
la croix, les armes de la Ville éternelle.
Cette enseigne, placée tout exprès pour indiquer une terre
romaine, nous donne à penser que le philosophe de Dampierre n’ignorait point le
symbolisme particulier de Basile Valentin, Senior Zadith, Mynsicht, etc. Car
ces auteurs nomment terre romaine et vitriol romain la substance terrestre qui
fournit notre dissolvant, sans lequel il serait impossible de réduire les
métaux en eau mercurielle, ou, si l’on préfère, en vitriol philosophique. Or,
d’après Valmont de Bomare, « le vitriol romain, appelé encore vitriol des
Adeptes, n’est pas la couperose verte, mais un sel double vitriolique de fer et
de cuivre ». [Valmont de Bomare. Minéralogie
ou Nouvelle Exposition du Règne minéral. Paris, Vincent, 1774.] Chambon est
du même avis et cite comme équivalent le vitriol de Salzbourg, qui est
également un sulfate cupro-ferrique. Les grecs l’appelaient Σῶρυ, et les
minéralogistes hellènes nous le décrivent comme étant un sel d’odeur forte et
désagréable, qui, lorsqu’on le broyait, devenait noir en prenant une
consistance spongieuse et un aspect gras.
Dans son Testamentum,
Basile Valentin signale les excellentes propriétés et les rares vertus du
vitriol ; mais on ne reconnaîtra la véracité de ses paroles que si l’on sait,
auparavant, de quel corps il entend parler. « Le Vitriol, écrit-il, est un
notable et important minéral auquel nul autre, dans la nature, ne saurait être
comparé, et cela parce que le Vitriol se familiarise avec tous les métaux plus
que toutes les autres choses ; il leur est très prochainement allié, puisque,
de tous les métaux, l’on peut faire un vitriol ou cristal ; car le vitriol et
le cristal ne sont reconnus que pour une seule et même chose. C’est pourquoi je
n’ai pas voulu retarder paresseusement son mérite, comme la raison le requiert,
attendu que le Vitriol est préférable aux autres minéraux, et que la première
place après les métaux lui doit être accordée. Car, bien que tous les métaux et
minéraux soient doués de grandes vertus, celui-ci néanmoins, savoir le Vitriol,
est seul suffisant pour en tirer et faire la bénite pierre, ce que nul autre au
monde ne pourrait accomplir seul à son imitation. » Plus loin, notre Adepte
revient sur le même sujet en précisant la nature double du vitriol romain : «
Je dis ici à ce propos, qu’il faut que tu imprimes vivement cet argument en ton
esprit, que tu portes entièrement tes pensées sur le vitriol métallique, et que
tu te souviennes que je t’ai confié cette connaissance que l’on peut, de Mars
et Vénus, faire un magnifique vitriol dans lequel les trois principes se
rencontrent, lesquels servent souvent à l’enfantement et production de notre
pierre. »
Relevons encore une remarque fort importante d’Henckel à
propos du vitriol. « Parmi tous les noms qui ont été donnés au vitriol, dit cet
auteur, il n’y en a pas un seul qui ait rapport au fer ; on l’appelle toujours chalcantum, chalcitis, cuperosa ou cupri
rosa, etc. Et ce n’est pas seulement parmi les Grecs et les Latins que l’on
a privé le fer de la part qui lui appartient dans le vitriol ; on en a fait
autant en Allemagne, et on y donne encore aujourd’hui à tous les vitriols en
général, et surtout à celui qui contient le plus de fer, le nom de kupfer wasser, eau cuivreuse, ou, ce qui
revient au même, de couperose. » [J.-F. Henckel. Pyritologie, ch VII, p. 184. Op. cit.]
Caisson 8 (pl. XXXI). – Le sujet de ce bas-relief est assez
singulier ; on y voit un jeune gladiateur, presque un enfant, s’acharnant à
taillader, à grands coups d’épée, une ruche emplie de gâteaux de miel et dont
il a ôté le couvercle. Deux mots en composent l’enseigne :
Le glaive miellé...
Cet acte bizarre d’adolescent fougueux et emporté, livrant bataille aux
abeilles comme Don Quichote à ses moulins, n’est, au fond, que la traduction
symbolique de notre premier travail, variante originale du thème si connu et si
souvent exploité en hermétisme, le frappement du rocher. On sait qu’après leur
sortie d’Égypte, les enfants d’Israël durent camper à Réphidim (Exode, XVII,
I ; Nombres, XXXIII, 14), « où il n’y avait point d’eau à boire pour le peuple
». Sur le conseil de l’Éternel (Exode, XVII, 6), Moïse, par trois fois, frappa
de sa verge le rocher Horeb, et une source d’eau vive jaillit de la pierre aride.
La mythologie nous offre également quelques répliques du même prodige.
Callimaque (Hymne à Jupiter, 31) dit
que la déesse Rhée, ayant frappé de son sceptre la montagne arcadienne,
celle-ci s’ouvrit en deux et que l’eau s’en échappa avec abondance. Appolonius
d’Alexandrie (Argonautes, 1146)
relate le miracle du mont Dindyme et assure que la roche n’avait jamais
auparavant donné naissance à la moindre source. Pausanias attribue un fait
semblable à Atalante, laquelle, pour se désaltérer, fit sourdre une fontaine en
heurtant de son javelot un rocher des environs de Cyphante, en Laconie.
Dans notre bas-relief, le gladiateur tient la place de
l’alchimiste, figuré ailleurs sous les traits d’Hercule, – héros des douze
travaux symboliques, – ou encore sous l’aspect d’un chevalier armé de pied en
cap, ainsi qu’on le remarque au portail de Notre-Dame de Paris. La jeunesse du
personnage exprime cette simplicité qu’il faut savoir observer tout au long de
l’ouvrage, en imitant et en suivant de près l’exemple de la nature. D’autre
part, nous devons croire que si l’Adepte de Dampierre accorde la préférence au
gladiateur, c’est pour signifier sans aucun doute que l’artiste doit travailler
ou combattre seul contre la matière. Le mot grec μονόμαχος, qui signifie
gladiateur, est composé en effet, de μόνος, seul, et de μάχομαι, combattre.
Quant à la ruche, elle doit le privilège de figurer la pierre à cet artifice
cabalistique qui fait dériver ruche de roche par permutation de voyelles. Le
sujet philosophique, notre première pierre, – en grec πέτρα, – transparaît
clairement sous l’image de la ruche ou roche, car πέτρα signifie aussi roc,
rocher, termes utilisés par les sages pour désigner le sujet hermétique.
Davantage, notre spadassin, en frappant à coups redoublés la
ruche emblématique et en tranchant au hasard ses rayons, en fait une masse
informe, hétérogène, de cire, de propolis et de miel, magma incohérent,
véritable méli-mélo, pour employer le langage des dieux, d’où le miel coule au
point d’en enduire son épée, substituée au bâton de Moïse. C’est là le second
chaos, résultat du combat primitif, que nous dénommons cabalistiquement
méli-mélo, parce qu’il contient le miel (μέλι), – eau visqueuse et glutineuse
des métaux, – toujours prêt à s’écouler (μέλλω). Les maîtres de l’art nous
affirment que l’ouvrage entier est un labeur d’Hercule, et qu’il faut commencer
par frapper la pierre, roche ou ruche, qui est notre matière première, avec
l’épée magique du feu secret, afin de déterminer l’écoulement de cette eau
précieuse qu’elle renferme dans son sein. Car le sujet des sages n’est guère
qu’une eau congelée, ce qui lui a fait donner, pour cette raison, le nom de
Pégase (de Πηγάς, rocher, glace, eau congelée ou terre dure et sèche). Et la
fable nous apprend que Pégase, entre autres actions, fit jaillir, d’un coup de
pied, la fontaine Hippocrène. Πήγασος, Pégase, a pour racine πηγή, source, de
sorte que le coursier ailé des poètes se confond avec la source hermétique,
dont il possède les caractères essentiels : la mobilité des eaux vives et la
volatilité des esprits.
Comme emblème de la matière première, la ruche se rencontre
souvent dans les décorations empruntant leurs éléments à la science d’Hermès.
Nous l’avons vue sur le plafond de l’hôtel Lallemant et parmi les panneaux du
poêle alchimique de Winterthur. Elle occupe encore l’une des cases du jeu de
l’Oie, labyrinthe populaire de l’Art sacré, et recueil des principaux
hiéroglyphes du Grand-Œuvre.
Caisson 9 (pl. XXXI). – Le soleil, perçant les nues, darde
ses rayons vers un nid de farlouse, contenant un petit œuf et posé sur un
tertre gazonné. [La farlouse des prés (Anthus pratensis) est un petit oiseau
voisin des alouettes. Il fait son nid dans l’herbe. On le nommait Ἄνθος chez
les Grecs : mais ce mot a une autre signification de caractère nettement
ésotérique. Ἄνθος désigne encore la fleur et la partie la plus parfaite, la
plus distinguée d’une chose ; c’est aussi l’efflorescence, la mousse ou l’écume
de solutions dont les parties légères montent et viennent cristalliser à la surface.
Cela suffit pour donner une idée claire de la naissance du petit oiseau dont
l’unique œuf doit engendrer notre Phénix.] Le phylactère, qui donne au
bas-relief sa signification, porte l’inscription :
. NEC . TE . NEC . SINE . TE .
Non pas toi, mais rien
sans toi… Allusion au soleil, père de la pierre, suivant Hermès et la
pluralité des philosophes hermétiques. L’astre symbolique, figuré dans sa
splendeur radiante, tient la place du soleil métallique ou soufre, que beaucoup
d’artistes ont cru être l’or naturel. Erreur grave, d’autant moins excusable
que tous les auteurs établissent parfaitement la différence existant entre l’or
des sages et le métal précieux. C’est, en effet, du soufre des métaux que les
maîtres entendent parler lorsqu’ils décrivent la manière d’extraire et de
préparer ce premier agent, lequel, d’ailleurs, n’offre aucune ressemblance
physico-chimique avec l’or vulgaire. Et c’est également ce soufre, conjoint au
mercure, qui collabore à la génération de notre œuf en lui donnant la faculté
végétative. Ce père réel de la pierre est donc indépendant d’elle, puisque la
pierre provient de lui, d’où la première partie de l’axiome : nec te ; et comme il est impossible de
rien obtenir sans l’aide du soufre, la seconde proposition se trouve justifiée
: nec sine te. Or, ce que nous disons
du soufre est vrai pour le mercure. De sorte que l’œuf, manifestation de la
nouvelle forme métallique émanée du principe mercuriel, s’il doit sa substance
au mercure ou Lune hermétique, tire sa vitalité et sa possibilité de
développement du soufre ou soleil des sages.
En résumé, il est philosophiquement exact d’assurer que les
métaux sont composés de soufre et de mercure, ainsi que l’enseigne Bernard
Trévisan ; que la pierre, quoique formée des mêmes principes, ne donne point
naissance à un métal ; qu’enfin, le soufre et le mercure, considérés à l’état
isolé, sont les seuls parents de la pierre, mais ne peuvent être confondues
avec elle. Nous nous permettons d’attirer l’attention du lecteur sur ce fait
que la coction philosophale du rebis fournit un soufre, et non un assemblage
irréductible de ses composants, et que ce soufre, par assimilation complète du
mercure, revêt des propriétés particulières qui tendent à l’éloigner de
l’espèce métallique. Et c’est sur cette constance d’effet qu’est fondée la
technique de multiplication et d’accroissement, parce que le soufre nouveau
reste toujours susceptible d’absorber une quantité déterminée et
proportionnelle de mercure.
X (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Septième série (pl. XXXII).
 |
| Planche XXXII |
Caisson 1. — Les tables de la loi hermétique, sur lesquelles
on lit une phrase française, mais si singulièrement présentée, que M. Louis
Audiat n’en a point su découvrir le sens :
. EN . RIEN . GIST . TOVT .
Devise primordiale que se plaisent à répéter les philosophes
anciens, et par laquelle ils entendent signifier l’absence de valeur, la
vulgarité, l’extrême abondance de la matière basique d’où ils tirent tout ce
qui leur est nécessaire. « Tu trouveras tout en tout ce qui n’est rien d’autre
qu’une vertu styptique ou astringente des métaux et des minéraux », écrit
Basile Valentin au livre des Douze Clefs.
Ainsi, la véritable sagesse nous enseigne à ne point juger
des choses selon leur prix, l’agrément qu’on en reçoit, la beauté de leur
aspect. Elle nous conduit à estimer dans l’homme le mérite personnel, non le
dehors ou la condition, et dans les corps la qualité spirituelle qu’ils
tiennent cachée en eux.
Aux yeux du sage, le fer, ce paria de l’industrie humaine,
est incomparablement plus noble que l’or, l’or plus méprisable que le plomb ;
car cette lumière vive, cette eau ardente, active et pure que les métaux
communs, les minéraux et les pierres ont conservée, l’or seul en est dépourvu.
Ce souverain à qui tant de gens rendent hommage, pour lequel tant de
consciences s’avilissent dans l’espoir d’obtenir ses faveurs, n’a de riche et
de précieux que le vêtement. Roi somptueusement paré, l’or n’est pourtant qu’un
corps inerte, mais magnifique, un brillant cadavre à l’égard du cuivre, du fer
ou du plomb. Cet usurpateur, qu’une foule ignorante et cupide élève au rang des
dieux, ne peut même se prévaloir d’appartenir à la vieille et puissante famille
des métaux ; dépouillé de son manteau, il révèle alors la bassesse de ses origines
et nous apparaît comme une simple résine métallique, dense, fixe et fusible,
triple qualité qui le rend notoirement impropre à la réalisation de notre
dessein.
On voit ainsi combien il serait vain de travailler sur l’or,
car celui qui n’a rien ne peut évidemment rien donner. C’est donc à la pierre
brute et vile qu’il faut s’adresser, sans répugnance pour son aspect misérable,
son odeur infecte, sa coloration noire, ses haillons sordides. Car ce sont
précisément ces caractères peu séduisants qui permettent de la reconnaître, et
l’ont fait regarder de tout temps comme une substance primitive, issue du chaos
originel, et que Dieu, lors de la Création et de l’organisation de l’univers,
aurait réservée pour ses serviteurs et ses élus. Tirée du Néant, elle en porte
l’empreinte et en subit le nom : Rien.
Mais les philosophes ont découvert qu’en sa nature élémentaire et désordonnée,
faite de ténèbres et de lumière, de mauvais et de bon rassemblés dans la pire
confusion, ce Rien contenait Tout ce qu’ils pouvaient désirer.
Caisson 2 (pl. XXXII). – La lettre majuscule H surmontée
d’une couronne, que M. Louis Audiat présente comme étant la signature blasonnée
du roi de France Henri II, n’offre plus aujourd’hui qu’une inscription en
partie martelée, mais qui se lisait autrefois :
. IN . TE . OMNIS . DOMINATA . RECVMBIT .
En toi repose toute la
puissance.
Nous avons eu précédemment l’occasion de dire que la lettre
H, ou du moins le caractère graphique qui lui est apparenté, avait été choisi
par les philosophes pour désigner l’esprit, âme universelle des choses, ou ce
principe actif et tout-puissant que l’on reconnaît être, dans la nature, en
perpétuel mouvement, en agissante vibration. C’est sur la forme de la lettre H
que les constructeurs du moyen âge ont édifié les façades des cathédrales,
temples glorificateurs de l’esprit divin, magnifiques interprètes des
aspirations de l’âme humaine dans son essor vers le Créateur. Ce caractère
correspond à l’êta (H), septième lettre de l’alphabet grec, initiale du verbe
solaire, demeure de l’esprit, astre dispensateur de la lumière : Ἥλιος, soleil.
C’est aussi le chef du prophète Élie, – en grec Ἡλιάς solaire, – que les
Écritures disent être monté au ciel, tel un pur esprit, dans un char de lumière
et de feu. C’est encore le centre et le cœur de l’un des monogrammes du Christ
: I H S, abréviation de Iesus Hominum Salvator, Jésus Sauveur des Hommes. C’est
également ce signe qu’employaient les francs-maçons médiévaux pour désigner les
deux colonnes du temple de Salomon, au pied desquelles les ouvriers recevaient
leur salaire : Jakin et Bohas, colonnes dont les tours des églises
métropolitaines ne sont que la traduction libre, mais hardie et puissante.
C’est enfin l’indication du premier échelon de l’échelle des sages, scala philosophorum, de la connaissance
acquise de l’agent hermétique, promoteur mystérieux des transformations de la
nature minérale, et celle du secret retrouvé de la Parole perdue. Cet agent
était jadis désigné, entre les Adeptes, sous l’épithète d’aimant ou d’attractif.
Le corps chargé de cet aimant s’appelait lui-même Magnésie, et c’est lui, ce
corps, qui servait d’intermédiaire entre le ciel et la terre, se nourrissant
des influences astrales, ou dynamisme céleste, qu’il transmettait à la
substance passive, en les attirant à la manière d’un aimant véritable. De
Cyrano Bergerac, dans un de ses récits allégoriques, parle ainsi de l’esprit
magnésien dont il paraît fort bien informé, tant en ce qui concerne la
préparation que l’usage.
« Vous n’avez pas oublié, je pense, écrit notre auteur, que
je me nomme Hélie, car je vous l’ai dit naguère. Vous saurez donc que j’étais
en votre monde et que j’habitais avec Élisée, un hébreu comme moi, sur les
agréables bords du Jourdain, où je menais, parmi les livres, une vie assez douce
pour ne pas la regretter, encore qu’elle s’écoulât. Cependant, plus les
lumières de mon esprit croissaient, plus aussi croissait la connaissance de
celles que je n’avais point. Jamais nos prêtres ne me ramentevaient Adam, que
le souvenir de cette Philosophie parfaite qu’il avait possédée ne me fît
soupirer. Je désespérais de la pouvoir acquérir, quand un jour, après avoir
sacrifié pour l’expiation des faiblesses de mon être mortel, je m’endormis, et
l’Ange du Seigneur m’apparut en songe ; aussitôt que je
fus réveillé, je ne manquai pas de travailler aux choses qu’il m’avait
prescrites : je pris de l’aimant environ deux pieds en carré, que je mis dans
un fourneau ; puis, lorsqu’il fut bien purgé, précipité et dissous, j’en tirai
l’attractif ; je calcinai tout cet Élixir et le réduisie à la grosseur
d’environ une balle médiocre.
« En suite de ces préparations, je fis construire un chariot
de fer fort léger, et de là à quelques mois, tous mes engins étant achevés,
j’entrai dans mon industrieuse charrette. Vous me demanderez possible à quoi
bon tout cet attirail. Sachez que l’Ange m’avait dit en
songe que si je voulais acquérir une science parfaite comme je le désirais, je
montasse au monde de la Lune, où je trouverais devant le Paradis d’Adam,
l’Arbre de la Science, parce qu’aussitôt que j’aurais tâté de son fruit, mon
âme serait éclairée de toutes les vérités dont une créature est capable ; voilà
donc le voyage pour lequel j’avais bâti mon chariot. Enfin, je montai dedans
et, lorsque je fus bien ferme et bien appuyé sur le siège, je jetai fort haut
en l’air cette boule d’aimant. Or, la machine de fer, que j’avais forgée tout
exprès plus massive au milieu qu’aux extrémités, fut enlevée aussitôt, et dans
un parfait équilibre, à mesure que j’arrivais où l’aimant m’avait attiré, et,
dès que j’avais sauté jusque-là, ma main le faisait repartir… À la vérité,
c’était un spectacle à voir bien étonnant, car l’acier de cette maison volante,
que j’avais poli avec beaucoup de soin, réfléchissait de tous côtés la lumière du
soleil si vive et si brillante, que je croyais moi-même être emporté dans un
chariot de feu… Quand depuis j’ai fait réflexion sur cet enlèvement miraculeux,
je me suis bien imaginé que je n’aurais pas pu vaincre, par les vertus occultes
d’un simple corps naturel, la vigilance du Séraphin que Dieu a ordonné pour la
garde de ce paradis. Mais parce qu’il se plaît à se servir de causes secondes,
je crus qu’il m’avait inspiré ce moyen pour y entrer, comme il voulut se servir
des côtes d’Adam pour lui faire une femme, quoiqu’il pût la former de terre
aussi bien que lui. » [De Cyrano Bergerac. L’Autre
Monde, ou Histoire comique des États et Empires de la Lune. Paris, Bauche,
1910, p. 38.]
Quant à la couronne qui complète le signe important que nous
étudions, ce n’est point celle du roi de France Henri II, mais bien la couronne
royale des élus. C’est elle que l’on voit orner le front du Rédempteur sur les
crucifix des XIe, XIIe et XIIIe siècles, en particulier à Amiens (Christ
byzantin appelé Saint-Sauve) et à Notre-Dame de Trèves (sommet du portail). Le
chevalier de l’Apocalypse (ch. VI, v. 2), monté sur un cheval blanc, emblème de
pureté, reçoit comme attributs distinctifs de ses hautes vertus un arc et une
couronne, dons du Saint-Esprit. Or, notre couronne, – les initiés savent ce
dont nous entendons parler, – est précisément le domicile d’élection de
l’esprit. C’est une misérable substance, ainsi que nous l’avons dit, à peine
matérialisée, mais qui le renferme en abondance. Et c’est là ce que les
philosophes antiques ont fixé dans leur corona
radiata, décorée de rayons en saillie, laquelle n’était attribuée qu’aux
dieux ou aux héros déifiés. Ainsi expliquerons-nous que cette matière, véhicule
de la lumière minérale, se révèle, grâce à la signature rayonnante de l’esprit,
comme la terre promise réservée aux élus de la Sapience.
Caisson 3 (pl. XXXII). – C’est un symbole ancien et souvent
exploité que nous rencontrons en ce lieu : le dauphin entortillé sur le bras
d’une ancre marine. L’épigraphe latine qui lui sert d’enseigne en donne la
raison :
. SIC . TRISTIS . AVRA . RESEDIT .
Ainsi s’apaise cette
terrible tempête... Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de relever le
rôle important que remplit le poisson sur le théâtre alchimique. Sous le nom de
dauphin, d’échénéide ou de rémora, il caractérise le principe humide et froid
de l’Œuvre, qui est notre mercure, lequel se coagule peu à peu au contact et
par l’effet du soufre, agent de dessication et de fixité. Ce dernier est ici
figuré par l’ancre marine, organe stabilisateur des vaisseaux, auxquels il
assure un point d’appui et de résistance à l’effort des flots. La longue
opération qui permet de réaliser l’empâtement progressif et la fixation finale
du mercure, offre une grande analogie avec les traversées maritimes et les
tempêtes qui les accueillent. C’est une mer agitée et houleuse que présente en
petit l’ébullition constante et régulière du compost hermétique. Les bulles
crèvent à la surface et se succèdent sans cesse ; de lourdes vapeurs chargent
l’atmosphère du vase ; les nuées troubles, opaques, livides, obscurcissent les
parois, se condensent en gouttelettes ruisselant sur la masse effervescente.
Tout contribue à donner le spectacle d’une tempête en réduction. Soulevée de
tous côtés, ballottée par les vents, l’arche flotte néanmoins sous la pluie
diluvienne. Astérie s’apprête à former Délos, terre hospitalière et salvatrice
des enfants de Latone. Le dauphin nage à la surface des flots impétueux, et
cette agitation dure jusqu’à ce que le rémora, hôte invisible des eaux
profondes, arrête enfin, comme une ancre puissante, le navire allant à la
dérive. Le calme renaît alors, l’air se purifie, l’eau s’efface, les vapeurs se
résorbent. Une pellicule couvre toute la superficie, et, s’épaississant,
s’affermissant chaque jour, marque la fin du déluge, le stade d’atterrissage de
l’arche, la naissance de Diane et d’Apollon, le triomphe de la terre sur l’eau,
du sec sur l’humide, et l’époque du nouveau Phénix. Dans le bouleversement
général et le combat des éléments s’acquiert cette paix permanente, l’harmonie
résultant du parfait équilibre des principes, symbolisés par le poisson fixé
sur l’ancre : sic tristis aura resedit.
Ce phénomène d’absorption et de coagulation du mercure par
une proportion très inférieure de soufre semble être la cause première de la
fable du rémora, petit poisson auquel l’imagination populaire et la tradition
hermétique attribuaient la faculté d’arrêter dans leur marche les plus grand
navires. Voici d’ailleurs ce qu’en dit, en un discours allégorique et plein
d’enseignement, le philosophe René François : « L’empereur Caligula cuida un
jour enrager, s’en retournant à Rome avec une puissante armée navale. Tous les
superbes navires, tant bien armez et si bien esperonnez singloient à souhait ;
le vent en pouppe enfloit toutes les voiles ; les vagues et le ciel sembloient
estre partisans de Caligula, secondans ses desseins, quant au plus beau, voilà
la galere capitanesse et imperiale qui est arrestée tout court. Les autres
voloient. L’empereur se courrouce, le pilote redouble son sifflet, quatre cens
espaliers et galiots qui estoient à la rame, cinq à chaque banc, suent à force
de pousser ; le vent se renforce, la mer se fasche de cet affront, tout le
monde s’estonne de ce miracle, quand l’empereur se va imaginer que quelque
monstre marin l’arrestoit sur ce lieu. Adonc force plongeons se precipitent en
mer et, nageans entre deux eaux, firent la ronde à l’entour de ce chasteau
flottant ; ils vont trouver un meschant petit poissonneau, d’un demy pied de long,
qui s’estant attaché au timon, prenoit son passe temps d’arrester la galere qui
domptoit l’univers. Il sembloit qu’il se voulut moquer de l’empereur du genre
humain, qui piaffe tant avec ses mondes de gendarmes et ses tonnerres de fer
qui le font seigneur de la terre. Voicy, dit-il en son langage de poisson, un
nouveau Annibal aux portes de Rome, qui tient en une prison flottante Rome et
son empereur : Rome la princesse menera sur terre les rois captifs en son
triomphe, et je conduiray en triomphe marin, par les contrées de l’Océan, le
Prince de l’Univers. Cesar sera roy des hommes, et moy je seray le Cesar des
Cesars ; toute la puissance de Rome est maintenant mon esclave et peut faire
tout son dernier effort, car tant que je voudray, je la tiendray en ceste
conciergerie royale. En me joüant et me joignant à ce galion, je feray plus en
un instant qu’ils n’ont fait en huit cens ans, massacrans le genre humain et
depeuplans le monde. Pauvre empereur ! que tu es loin de ton conte, avec tous
tes cent cinquante millions de revenu, et trois cent millions d’hommes qui sont
à ta solde : un malotru poissonneau t’a rendu son esclave ! Que la mer se
despite, que le vent enrage, que tout le monde devienne forçat, et tous les
arbres avirons, si ne feront-ils un pas sans mon passe-port et sans mon congé…
Voicy le vray Archimedes des poissons, car luy seul arreste tout le monde ;
voicy l’aymant animé qui captive tout le fer et les armes de la premiere
monarchie du monde ; je ne sçay qui appelle Rome l’ancre dorée du genre humain,
mais ce poisson est l’ancre des ancres… O merveille de Dieu ! ce bout de
poisson fait honte, non seulement à la grandeur romaine, mais à Aristote qui
perd icy son crédit, et à la philosophie qui y fait banqueroute, car ils ne
treuvent aucune raison de cest effort, qu’une bouche sans dents arreste un
navire poussé par les quatre elemens, et luy fasse prendre port au beau mitan
des plus cruelles tempestes. Pline dit que toute la nature est cachée comme en
sentinelle, et logée en garnison dans les plus petites créatures ; je le crois,
et, quant à moy, je pense que ce petit poisson est le pavillon mouvant de la
nature et de toute sa gendarmerie ; c’est elle qui aggraffe et arreste ces
galeres ; elle qui bride, sans autre bride que le museau d’un poissonneau, ce
qui ne se peut brider… Las ! que ne rabbatons-nous les cornes de nostre vaine
arrogance, avec une si sainte consideration ; car si Dieu se jouant par un
petit escumeur de mer, et le pyrate de la nature, il arreste et accroche tous
nos desseins, qui s’envolent à pleine voiles d’un pole à l’autre, s’il y
employe sa toute-puissance, a quel poinct reduira-t-il nos affaires ? Si de
rien il fait tout, et d’un poisson, ou plutost d’un petit rien, nageant et
faisant du poisson, il accable toutes nos esperances, helas ! quand il y
employera tout son pouvoir et toutes les armées de sa justice, hé ! où en
serons-nous ? » [René François. Essay des
Merveilles de Nature et des plus nobles artifices. Lyon, J. Huguetan, 1642,
ch. XV, p. 125.]
Caisson 4 (pl. XXXII). – Près de l’arbre aux fruits d’or, un
dragon robuste et trapu exerce sa vigilance à l’entrée du jardin des
Hespérides. Le phylactère particulier à ce sujet porte, gravée, cette
inscription :
. AB . INSOMNI . NON . CVSTODITA . DRACONE .
En dehors du dragon
qui veille, les choses ne sont pas gardées… Le mythe du dragon préposé à la
surveillance du verger fameux et de la légendaire Toison d’Or, est assez connu
pour nous éviter la peine de le reproduire. Il suffit d’indiquer que le dragon
est choisi comme représentant hiéroglyphique de la matière minérale brute avec
laquelle on doit commencer l’Œuvre. C’est dire quelle est son importance, le
soin qu’il faut apporter à l’étude des signes extérieurs et des qualités
susceptibles d’en permettre l’identification, de faire
reconnaître et distinguer le sujet hermétique entre les multiples minéraux que
la nature met à notre disposition.
Chargé de surveiller l’enclos merveilleux où les philosophes
vont quérir leurs trésors, le dragon passe pour ne jamais sommeiller. Ses yeux
ardents demeurent constamment ouverts. Il ne connaît ni repos ni lassitude et
ne saurait vaincre l’insomnie qui le caractérise et lui assure sa véritable
raison d’être. C’est d’ailleurs ce qu’exprime le nom grec qu’il porte. Δράκων a
pour racine δέρκομαι, regarder, voir, et, par extension, vivre, mot voisin
lui-même de δερκευνής, qui dort les yeux ouverts. La langue primitive nous
révèle, à travers l’enveloppe du symbole, l’idée d’une activité intense, d’une
vitalité perpétuelle et latente enclose dans le corps minéral. Les mythologues
nomment notre dragon Ladon, vocable dont l’assonance se rapproche de Laton et
que l’on peut assimiler au grec Λήθω, être caché, inconnu, ignoré, comme la
matière des philosophes.
L’aspect général, la laideur reconnue du dragon, sa férocité
et son singulier pouvoir vital correspondent exactement avec les particularités
externes, les propriétés et les facultés du sujet. La cristallisation spéciale
de celui-ci se trouve clairement indiquée par l’épiderme écailleux de celui-là.
Semblables sont les couleurs, car la matière est noire, ponctuée de rouge ou de
jaune, comme le dragon qui en est l’image. Quant à la qualité volatile de notre
minéral, nous la voyons traduite par les ailes membraneuses dont le monstre est
pourvu. Et parce qu’il vomit, dit-on, quand on l’attaque, du feu et de la
fumée, et que son corps finit en queue de serpent, les poètes, pour ces
raisons, l’ont fait naître de Typhaon et d’Echidna. Le grec Τυφάων, terme
poétique de Τυφῶν ou Τυφώς, – le Typhon égyptien, – signifie remplir de fumée,
allumer, embraser. Ἔχιδνα n’est autre que la vipère. D’où nous pouvons conclure
que le dragon tient de Typhaon sa nature chaude, ardente, sulfureuse, tandis
qu’il doit à sa mère sa complexion froide et humide, avec la forme
caractéristique des ophidiens.
Or, si les philosophes ont toujours dissimulé le nom
vulgaire de leur matière sous une infinité d’épithètes, en revanche ils se sont
montrés fort prolixes en ce qui concerne sa forme, ses vertus et, parfois même,
sa préparation. D’un commun accord, ils affirment que l’artiste ne doit rien
espérer découvrir ni produire en dehors du sujet, parce qu’il est le seul corps
capable, en toute la nature, de lui procurer les éléments indispensables. À
l’exclusion des autres minéraux et des autres métaux, il conserve les principes
nécessaires à l’élaboration du Grand-Œuvre. Par sa figuration monstrueuse, mais
expressive, ce primitif sujet nous apparaît nettement comme le gardien et
l’unique dispensateur des fruits hermétiques. Il en est le dépositaire, le
conservateur vigilant, et notre Adepte parle en sage lorsqu’il enseigne qu’en
dehors de cet être solitaire les choses philosophales ne sont pas gardées,
puisque nous les chercherions vainement ailleurs. Aussi, est-ce à propos de ce
premier corps, parcelle du chaos originelle et mercure commun des philosophes,
que Geber s’écrie : « Loué soit le Très-Haut, qui a créé notre mercure et lui a
donné une nature à laquelle rien ne résiste ; car sans lui les alchimistes
auraient beau faire, tout leur labeur deviendrait inutile. »
« Mais, demande un autre Adepte, où est donc ce mercure
aurifique qui, résout en sel et souphre, devient l’humide radical des metaux et
leur semence animée ? Il est emprisonné dans une prison si forte que la nature
même ne sçauroit l’en tirer, si l’art industrieux ne luy en facilite les
moyens. » [La Lumière sortant par
soy-mesme des Ténèbres, ch. II, chant V, p. 16. Op. cit.]
Caisson 5 (pl. XXXII). – Un cygne, majestueusement posé sur
l’eau calme d’un étang, a le col traversé d’une flèche. Et c’est sa plainte
ultime que nous traduit l’épigraphe de ce petit sujet agréablement exécuté :
PROPRIIS . PEREO .
PENNIS .
Je meurs par mes
propres plumes... L’oiseau, en effet, fournit l’une des matières de l’arme
qui servira à le tuer ; l’empennage de la flèche, assurant sa direction, la
rend précise, et les plumes du cygne, remplissant cet office, contribuent ainsi
à le perdre. Ce bel oiseau, dont les ailes sont emblématiques de la volatilité,
et la blancheur neigeuse l’expression de la pureté, possède les deux qualités
essentielles du mercure initial ou de notre eau dissolvante. Nous savons qu’il
doit être vaincu par le soufre, – issu de sa substance et que lui-même a
engendré, – afin d’obtenir après sa mort ce mercure philosophique, en partie
fixe et en partie volatil, que la maturation subséquente élèvera au degré de
perfection du grand Élixir. Tous les auteurs enseignent qu’il
faut tuer le vif si l’on désire ressusciter le mort ; c’est pourquoi le bon
artiste n’hésitera pas à sacrifier l’oiseau d’Hermès, et à provoquer la
mutation de ses propriétés mercurielles en qualités sulfureuses, puisque toute
transformation reste soumise à la décomposition préalable et ne peut se
réaliser sans elle.
Basile Valentin assure que « l’on doit donner à manger un
cygne blanc à l’homme double igné », et, ajoute-t-il, « le cygne rôti sera pour
la table du roi ». Aucun philosophe, à notre connaissance, n’a levé le voile
qui recouvre ce mystère, et nous nous demandons s’il est expédient de commenter
d’aussi graves paroles. Cependant, nous souvenant des longues années durant
lesquelles nous avons nous-mêmes stationné devant cette porte, nous pensons
qu’il serait charitable d’aider le travailleur, parvenu jusque-là, à en
franchir le seuil. Tendons-lui donc une main secourable et découvrons, dans les
limites permises, ce que les plus grands maîtres ont cru prudent de réserver.
Il est évident que Basile Valentin, en employant
l’expression homme double igné,
entend parler d’un principe second, résultant d’une combinaison de deux agents
de complexion chaude et ardente, ayant, par conséquent, la nature des soufres
métalliques. D’où l’on peut conclure que, sous la
dénomination simple de soufre, les Adeptes, à un moment donné du travail,
conçoivent deux corps combinés, de propriétés semblables mais de spécificité
différente, pris conventionnellement pour un seul. Cela posé, quelles seront
les substances capables de céder ces deux produits ? Une telle question n’a
jamais reçu de réponse. Toutefois, si l’on considère que les métaux ont leurs
représentants emblématiques figurés par des divinités mythologiques, tantôt
masculines, tantôt féminines ; qu’ils tiennent ces affectations particulières
des qualités sulfureuses reconnues expérimentalement, le symbolisme et la fable
seront susceptibles de jeter quelque clarté sur ces choses obscures.
Chacun sait que le fer et le plomb sont placés sous la
domination d’Arès et de Chronos, et qu’ils reçoivent les influences planétaires
respectives de Mars et de Saturne ; l’étain et l’or, soumis à Zeus et Apollon,
épousent les vicissitudes de Jupiter et du Soleil. Mais pourquoi Aphrodite et
Artémis dominent-elles le cuivre et l’argent, sujets de Vénus et de la Lune ?
Pourquoi le mercure est-il redevable de sa complexion au messager de l’Olympe,
le dieu Hermès, bien qu’il soit dépourvu de soufre et remplisse les fonctions
réservées aux femmes chimico-hermétiques ? Devons-nous accepter ces relations
comme véritable, et n’y aurait-il point, dans la répartition des divinités
métalliques et de leurs correspondances astrales, une confusion voulue,
préméditée ? Si l’on nous interrogeait sur ce point, nous répondrions sans
hésiter par l’affirmative. L’expérience démontre, de façon certaine, que
l’argent possède un soufre magnifique, aussi pur et éclatant que celui de l’or,
sans en avoir toutefois la fixité. Le plomb donne un produit médiocre, de
couleur presque égale, mais peu stable et fort impur. Le soufre de l’étain, net
et brillant, est blanc et ferait plutôt ranger ce métal sous la protection
d’une déesse que sous l’autorité d’un dieu. Le fer, par contre, a beaucoup de
soufre fixe, d’un rouge sombre, terne, immonde et si défectueux que, malgré sa
qualité réfractaire, on ne saurait vraiment trop à quoi l’utiliser. Et
pourtant, l’or excepté, on chercherait vainement, dans les autres métaux, un
mercure plus lumineux, plus pénétrant et plus maniable. Quant au soufre du
cuivre, Basile Valentin nous le décrit fort exactement dans le premier livre de
ses Douze Clefs : « La lascive Vénus, dit-il, est bien colorée, et tout son
corps n’est presque que teinture et couleur semblable à celle du Soleil,
laquelle, à cause de son abondance, tire grandement sur le rouge. Mais, parce
que son corps est lépreux et malade, la teinture fixe n’y peut pas demeurer,
et, le corps périssant, la teinture périt avec lui, à moins qu’elle ne soit
accompagnée d’un corps fixe, où elle puisse établir son siège et sa demeure de
façon stable et permanente. » [Les Douze
Clefs de Philosophie. Texte corrigé sur l’édition de Francfort ; Éditions
de Minuit, 1956, p. 86.]
Si l’on a bien compris ce que veut enseigner le célèbre
Adepte, et que l’on examine avec soin les rapports existant entre les soufres
métalliques et leurs symboles respectifs, on n’éprouvera guère de peine à rétablir
l’ordre ésotérique conforme au travail. L’énigme se laissera déchiffrer et le
problème du soufre double sera facilement résolu.
Caisson 6 (pl. XXXII). – Deux cornes d’abondance
s’entrecroisent sur le caducée de Mercure. Elles ont pour épigraphe cette
maxime latine :
. VIRTVTI . FORTUNA . COMES .
La fortune accompagne
la vertu… Axiome d’exception, vérité contestable dans son application au
mérite véritable, – où la fortune récompense si rarement la vertu, – qu’il
convient d’en chercher ailleurs la confirmation et la règle. Or, c’est de la
vertu secrète du mercure philosophique, figuré par l’image du caducée, que
l’auteur de ces symboles entend parler. Les cornes d’abondance traduisent
l’ensemble des richesses matérielles que la possession du mercure assure aux
bons artistes. Par leur croisement en X, elles indiquent la qualité spirituelle
de cette noble et rare substance, dont l’énergie brille comme un feu pur, au
centre du corps exactement sublimé.
Le caducée, attribut du dieu Mercure, ne saurait donner
place à la moindre équivoque, tant au regard du sens secret qu’au point de vue
de la valeur symbolique. Hermès, père de la science hermétique, est à la fois
considéré comme créateur et créature, maître de la philosophie et matière des
philosophes. Son sceptre ailé porte l’explication de l’énigme qu’il propose, et
la révélation du mystère couvrant le composé du composé, chef-d’œuvre de la
nature et de l’art, sous l’épithète vulgaire de mercure des sages.
À l’origine, le caducée ne fut qu’une simple baguette,
sceptre primitif de quelques personnages sacrés ou fabuleux appartenant plutôt
à la tradition qu’à l’histoire. Moïse, Atalante, Cybèle, Hermès emploient cet
instrument, doué d’une sorte de pouvoir magique, en des conditions semblables
et génératrices de résultats équivalents. Le ῥάβδος grec est, effectivement,
une verge, un bâton, une hampe de javelot, un dard et le sceptre d’Hermès. Ce
mot dérive de ῥάσσω, lequel signifie frapper,
partager, détruire. Moïse frappe de sa verge le roc aride qu’Atalante, à
l’exemple de Cybèle, perce de son javelot. Mercure sépare et tue les deux
serpents engagés dans un duel furieux, en jetant sur eux le bâton des
πτεροφόροι, c’est-à-dire des courriers et messagers, qualifiés porteurs d’ailes parce qu’ils avaient,
pour insigne de leur charge, des ailes à leur bonnet. Le pétase ailé d’Hermès
justifie donc sa fonction de messager et de médiateur des dieux. L’adjonction
des serpents à la baguette, complétée par le chapeau (πέτασος)
et les talonnières (ταρσοὶ), donna au caducée sa forme définitive, avec
l’expression hiéroglyphique du mercure parfait.
Sur le caisson de Dampierre, les deux serpents montrent des
têtes canines, l’une de chien, l’autre de chienne, version imagée des deux
principes contraires, actif et passif, fixe et volatil, mis au contact du
médiateur figuré par la baguette magique, qui est notre feu secret. Artephius
nomme ces principes chien de Corascène et
chienne d’Arménie, et ce sont ces mêmes serpents qu’Hercule enfant étouffe
dans son berceau, les seuls agents dont l’assemblage, le combat et la mort,
réalisés par l’entremise du feu philosophique, donnent naissance au mercure
hermétique vivant et animé. Et comme ce double mercure possède double
volatilité, les ailes du pétase, opposées à celles des talonnières sur le
caducée, servent à exprimer ces deux qualités réunies, de la manière la plus
claire et la plus parlante.
Caisson 7 (pl. XXXII). – Dans ce bas-relief, Cupidon, l’arc
d’une main et de l’autre une flèche, chevauche la Chimère sur un amas de nuages
constellés. Le phylactère qui souligne ce sujet indique qu’Éros est ici le
maître éternel :
. ÆTERNVS . HIC . DOMINVS .
Rien n’est plus vrai, d’ailleurs, et d’autres caissons nous
l’ont appris. Éros, personnification mythique de la concorde et de l’amour,
est, par excellence, le seigneur, le maître éternel de l’Œuvre. Lui seul peut
réaliser l’accord entre des ennemis qu’une haine implacable pousse sans cesse à
s’entre-dévorer. Il remplit le pacifique office du prêtre que l’on voit unir, –
sur une gravure des Douze Clefs de
Basile Valentin, – le roi et la reine hermétiques. C’est encore lui qui darde,
dans le même ouvrage, une flèche vers une femme soutenant un énorme matras tout
rempli d’eau nébuleuse…
La mythologie nous apprend que la Chimère portait trois
têtes différentes sur un corps de lion terminé en queue de serpent : une tête
de lion, l’autre de chèvre et la troisième de dragon. Des parties constituantes
du monstre, deux sont prépondérantes, le lion et le dragon, parce qu’ils
apportent dans l’assemblage, l’un la tête et le corps, l’autre la tête et la
queue. En analysant le symbole dans l’ordre des acquisitions successives, la
première place appartient au dragon, qui se confond toujours avec le serpent ;
on sait que les Grecs nommaient δράκων le dragon plutôt que le serpent. C’est
là notre matière initiale, le sujet même de l’art, considéré en son premier
être et dans l’état où la nature nous le fournit. Le lion vient ensuite, et
quoiqu’il soit l’enfant du sujet des sages et d’un métal caduc, il surpasse de
beaucoup en vigueur ses propres parents et devient vite plus robuste que son
père. Fils indigne d’un vieillard et d’une très jeune femme, il témoigne dès sa
naissance d’une inconcevable aversion pour sa mère. Insociable, féroce,
agressif, on ne saurait rien espérer de cet héritier violent et cruel, s’il
n’était ramené, à la faveur d’un providentiel accident, à plus de calme et de
pondération. Encouragé par sa mère Aphrodite, Éros, déjà mécontent du
personnage, lui décoche une flèche d’airain et le blesse grièvement. À demi
paralysé, il est alors ramené à sa mère, laquelle, pour rétablir ce fils
ingrat, lui donne pourtant son propre sang, voire une partie de sa chair, et
meurt après l’avoir sauvé. « La mère, dit la Tourbe des Philosophes, est toujours plus pitoyable à l’enfant que
l’enfant à sa mère. » De ce contact étroit et prolongé du soufre-lion et du
dissolvant-dragon se forme un être nouveau, régénéré en quelque façon, aux
qualités mixtionnées, représenté symboliquement par la chèvre, ou, si l’on préfère,
par la Chimère elle-même. Le mot grec Χίμαιρα, Chimère, signifie également jeune chèvre (cab. Χ-μήτηρ). Or, cette
jeune chèvre, qui doit son existence et ses brillantes qualités à l’opportune
intervention d’Éros, n’est autre que le mercure philosophique, issu de
l’alliance du soufre et du mercure principes, lequel possède toutes les
facultés requises pour devenir le fameux bélier à toison d’or, notre Élixir et
notre pierre. Et c’est toute l’ordonnance du labeur hermétique que découvre
l’antique Chimère, et, ainsi que le dit Philalèthe, c’est aussi toute notre
philosophie.
Le lecteur voudra bien nous excuser d’avoir utilisé
l’allégorie, afin de mieux situer les points importants de la pratique, mais
nous n’avons pas d’autre moyen et continuons en cela la vieille tradition
littéraire. Et si nous réservons, dans le récit, la part essentielle qui
revient au petit Cupidon, – maître de l’Œuvre et seigneur de céans, – c’est
uniquement par obéissance à la discipline de l’Ordre, et pour ne point être
parjure envers nous-mêmes. Au reste, le lecteur perspicace trouvera, disséminés
volontairement dans les pages de ce livre, des indications complémentaires sur
le rôle du médiateur, dont nous ne devions point parler davantage en ce lieu.
Caisson 8 (pl. XXXII). – Nous retrouvons ici un motif déjà
rencontré ailleurs et surtout en Bretagne. C’est une hermine, figurée à
l’intérieur d’un petit enclos que limite une claie circulaire, symbole
particulier de la reine Anne, femme de Charles VIII et de Louis XII. On le voit
figurer, à côté du porc-épic emblématique de Louis XII, au manteau de la grande
cheminée de l’hôtel Lallemant, à Bourges. Son épigraphe renferme le même sens
et emploie presque les mêmes mots que la fameuse devise de l’ordre de l’Hermine
: Malo mori quam fœdari, je préfère
la mort à une souillure. Cet ordre de chevalerie, fondé d’abord en 1381 par
Jean V, duc de Bretagne, devait disparaître au XVe siècle. Restitué ensuite par
le roi de Naples, Ferdinand Ier, l’an 1483, l’ordre de l’Hermine, ayant perdu
tout caractère hermétique, ne formait plus qu’une association peu cohérente de
chevalerie patricienne.
L’inscription gravée sur le phylactère de notre caisson
porte :
. MORI . POTIVS . QVAM . FEDARI .
Plutôt la mort que la
souillure... Belle et noble maxime d’Anne de Bretagne ; maxime de pureté,
appliquée au petit carnassier dont la blanche fourrure fait, dit-on, l’objet
des soins empressés de son élégant et souple possesseur. Mais, dans
l’ésotérisme de l’Art sacré, l’hermine, image du
mercure philosophique, signale la netteté absolue d’un produit sublimé, que
l’adjonction du soufre, ou feu métallique, contribue à rendre plus éclatant
encore.
En grec, hermine se dit ποντικός, mot dérivé de πόντος ou
πόντιος, le gouffre, l’abîme, la mer, l’océan ; c’est l’eau pontique des
philosophes, notre mercure, la mer repurgée avec son soufre, parfois simplement
l’eau de notre mer, ce qu’il faut lire eau de notre mère, c’est-à-dire de la
matière primitive et chaotique appelée sujet des sages. Les maîtres nous
enseignent que leur mercure second, cette eau pontique dont nous parlons, est
une eau permanente, laquelle, contrairement aux corps liquides, « ne mouille
pas les mains », et leur source qui coule dans la mer hermétique. Pour
l’obtenir, disent-ils, il convient de frapper trois fois le rocher, afin d’en
extraire l’onde pure mêlée à l’eau grossière et solidifiée, généralement
figurée par des blocs rocheux émergeant de l’océan. Le vocable πόντιος exprime
spécialement tout ce qui habite la mer ; il éveille à l’esprit ce poisson caché
que le mercure a capté et retient dans les mailles de son filet, celui que
l’ancienne coutume de la fête des Rois nous offre tantôt sous sa forme (sole,
dauphin), tantôt sous l’aspect du « baigneur » ou de la fève, dissimulés entre
les lames feuilletées de la galette traditionnelle. [Cf. Fulcanelli. Le Mystère des Cathédrales. Paris, J.
Schemit, 1926, p. 126] L’hermine pure et blanche apparaît ainsi comme un
emblème expressif du mercure commun uni au soufre-poisson dans la substance du
mercure philosophique.
Quant à la clôture, elle nous révèle quels sont ces signes
extérieurs qui, au dire des Adeptes, constituent le meilleur critérium du
produit secret et fournissent le témoignage d’une préparation canonique et
conforme aux lois naturelles. La palissade tressée servant d’enclos à l’hermine
et, réellement, d’enveloppe au mercure animé, suffirait à expliquer le dessin
des stigmates en question. Mais notre but étant de les définir sans équivoque,
nous dirons que le mot grec χαράκωμα, palissade, dérivé de χαράσσω, tracer,
graver, marquer d’une empreinte, possède ainsi une origine semblable à celle du
terme χαρακτήρ, c’est-à-dire linéament gravé, forme distinctive, caractère. Et
le caractère propre du mercure est, précisément, d’affecter à sa surface un
réseau de lignes entre-croisées, tressées à la manière des paniers d’osier
(κάλαθος), des couffins, mannes, gabions et corbeilles. Ces figures
géométriques, d’autant plus apparentes et mieux gravées que la matière est plus
pure, sont un effet de la volonté toute-puissante de l’Esprit ou de la Lumière.
Et cette volonté imprime à la substance une disposition extérieure cruciforme
(Χίασμα) et donne au mercure sa signature philosophique effective. C’est la
raison pour laquelle on compare cette enveloppe aux mailles du filet servant à
pêcher le poisson symbolique ; à la corbeille eucharistique que porte sur son
dos l’Ἰχθύς des Catacombes romaines ; à la crèche de Jésus, berceau de
l’Esprit-Saint incarné dans le Sauveur des hommes ; au ciste de Bacchus, que l’on
disait contenir on ne sait quel objet mystérieux ; au berceau d’Hercule enfant,
étouffant les deux serpents envoyés par Junon, et à celui de Moïse sauvé des
eaux ; au gâteau des rois, porteur des mêmes caractères ; à la galette du Petit
Chaperon rouge, la plus charmante création, peut-être, de ces fables
hermétiques que sont les Contes de ma
mère l’Oie, etc.
Mais l’empreinte significative du mercure animé, marque
superficielle du travail de l’esprit métallique, ne peut être obtenue qu’après
une série d’opérations, ou purifications, longues, ingrates et rebutantes.
Aussi, ne doit-on négliger aucune peine, aucun effort et ne craindre ni le
temps, ni la fatigue, si l’on veut être assuré du succès. Quoi qu’on fasse ou
qu’on veuille tenter, jamais l’esprit ne demeurera stable dans un corps immonde
ou insuffisamment purifié. La devise, toute spirituelle, qui accompagne notre
hermine le proclame : Plutôt la mort que
la souillure. Que l’artiste se souvienne de l’un des grands travaux
d’Hercule, le nettoyage des écuries d’Augias ; « il faut faire passer sur notre
terre, disent les sages, toutes les eaux du déluge. » Ce sont là des images
expressives du labeur qu’exige la purification parfaite, ouvrage simple,
facile, mais si fastidieux qu’il a découragé quantité d’alchimistes plus avides
que laborieux, plus enthousiastes que persévérants.
Caisson 9 (pl. XXXII). – Quatre cornes d’où s’échappent des
flammes, avec la devise :
Vainement... C’est
la traduction lapidaire des quatre feux de notre coction. Les auteurs qui en
ont parlé nous les décrivent comme autant de degrés différents et proportionnés
du feu élémentaire agissant, au sein de l’Athanor, sur le rebis philosophal. Du
moins est-ce là le sens suggéré aux débutants, et que ceux-ci s’empressent, sans
trop de réflexion, de mettre en pratique.
Pourtant, les philosophes certifient eux-mêmes qu’ils ne
parlent jamais plus obscurément que lorsqu’ils paraissent s’exprimer avec
précision ; aussi, leur clarté apparente abuse-t-elle ceux qui se laissent
séduire par le sens littéral, et ne cherchent point à s’assurer s’il concorde
ou non avec l’observation, la raison et la possibilité de nature. C’est
pourquoi nous devons prévenir les artistes qui tenteront de réaliser l’Œuvre
selon ce processus, c’est-à-dire en soumettant l’amalgame philosophique aux
températures croissantes des quatre régimes du feu, qu’ils seront
infailliblement victimes de leur ignorance et frustrés du résultat escompté.
Qu’ils cherchent tout d’abord à découvrir ce que les anciens entendaient par
l’expression imagée du feu, et celle des quatre degrés successifs de son
intensité. Car il ne s’agit point en ce lieu du feu des cuisines, de nos
cheminées ou des hauts fourneaux. « Dans notre Œuvre, affirme Philalèthe, le
feu ordinaire ne sert qu’à éloigner le froid et les accidents qu’il pourrait
causer. » En un autre endroit de son traité, le même auteur dit positivement
que notre coction est linéaire, c’est-à-dire égale, constante, régulière et
uniforme d’un bout à l’autre de l’ouvrage. Presque tous les philosophes ont
pris pour exemple du feu de coction ou maturation, l’incubation de l’œuf de
poule, non pas au regard de la température à adopter, mais à celui de
l’uniformité et de la permanence. Aussi, nous conseillons vivement de
considérer avant toute chose le rapport que les sages ont établi entre le feu
et le soufre, afin d’obtenir cette notion essentielle que les quatre degrés de
l’un doivent infailliblement correspondre aux quatre degrés de l’autre, ce qui
est dire beaucoup en peu de mots. Enfin, dans sa description si minutieuse de
la coction, Philalèthe n’omet pas de faire remarquer combien l’opération réelle
est éloignée de son analyse métaphorique, parce qu’au lieu d’être directe,
comme on le croit généralement, elle comporte plusieurs phases ou régimes,
simples réitérations d’une seule et même technique. À notre avis, ces paroles
représentent ce que l’on a dit de plus sincère sur la pratique secrète des
quatre degrés du feu. Et, quoique l’ordre et le développement de ces travaux
soient réservés par les philosophes et toujours enveloppés de silence, le
caractère spécial que revêt la coction ainsi comprise permettra néanmoins aux
artistes avisés de retrouver le moyen simple et naturel qui doit en favoriser
l’exécution.
M. Louis Audiat, dont nous avons relevé, au cours de cette
étude, quelques fantaisies assez piquantes, n’a point été demander à la science
ancienne une explication vraisemblable de ce curieux caisson. « Le plaisant,
écrit-il, se mêle aussi à nos textes. Voici une grosse malice en un petit mot :
Frustra. Des cornes flamboyantes !
C’est en vain qu’on garde sa femme ! »
Nous ne croyons pas que l’auteur, mû de compassion devant ce
« témoignage » de l’Adepte malheureux, ait voulu montrer la moindre irrévérence
pour la mémoire de sa compagne… Mais l’ignorance est aveugle et l’infortune
mauvaise conseillère. M. Louis Audiat aurait dû le savoir et s’abstenir de
généraliser…
XI (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
La huitième et dernière série ne comprend qu’un seul caisson
consacré à la science d’Hermès. Il représente des roches abruptes dont la
silhouette sauvage se dresse au milieu des flots. Ce tableau lapidaire porte
pour enseigne :
. DONEC . ERVNT . IGNES .
Tant que durera le feu...
Allusion aux possibilités d’action que l’homme tient du principe igné, esprit,
âme ou lumière des choses, unique facteur de toutes les mutations matérielles.
Des quatre éléments de la philosophie antique, trois seulement figurent ici :
la terre, représentée par les rochers, l’eau par l’onde marine, l’air par le
ciel du paysage sculpté. Quant au feu, animateur et modificateur des trois
autres, il ne semble exclu du sujet que pour mieux souligner sa prépondérance,
sa puissance et sa nécessité, ainsi que l’impossibilité d’une action quelconque
sur la substance, sans le secours de cette force spirituelle capable de la
pénétrer, de la mouvoir, de changer en actuel ce qu’elle a de potentiel.
Tant que durera le feu, la vie rayonnera dans l’univers ;
les corps, soumis aux lois d’évolution dont il est l’agent essentiel,
accompliront les différents cycles de leurs métamorphoses, jusqu’à leur
transformation finale en esprit, lumière ou feu. Tant que durera le feu, la
matière ne cessera de poursuivre sa pénible ascension vers l’intégrale pureté,
en passant de la forme compacte et solide (terre) à la forme liquide (eau),
puis de l’état gazeux (air) à l’état radiant (feu). Tant que durera le feu, l’homme pourra exercer son industrieuse activité sur les
choses qui l’entourent et, grâce au merveilleux instrument igné, les soumettre
à sa volonté propre, les plier, les assujettir à son utilité. Tant que durera
le feu, la science bénéficiera de possibilités étendues dans tous les domaines
du plan physique et verra s’élargir le champ de ses connaissances et de ses
réalisations. Tant que durera le feu, l’homme sera en rapport direct avec Dieu,
et la créature connaîtra mieux son Créateur…
Nul sujet de méditation n’apparaît plus profitable au
philosophe ; aucune ne sollicite davantage l’exercice de sa pensée. Le feu nous
enveloppe et nous baigne de toutes parts ; il vient à nous par l’air, l’eau, la
terre même, qui en sont les conservateurs et les divers véhicules ; nous le
rencontrons en tout ce qui nous approche ; nous le sentons agir en nous pendant
la durée entière de notre existence terrestre. Notre naissance est le résultat
de son incarnation ; notre vie, l’effet de son dynamisme ; notre mort, la
conséquence de sa disparition. Prométhée dérobe le feu du ciel pour animer
l’homme qu’il avait, ainsi que Dieu, formé du limon de la terre. Vulcain crée
Pandore, la première femme, que Minerve dote du mouvement en lui insufflant le
feu vital. Un simple mortel, le sculpteur Pygmalion, désireux d’épouser son
propre ouvrage, implore Vénus d’animer, par le feu céleste, sa statue de
Galatée. Chercher à découvrir la nature et l’essence du feu, c’est chercher à
découvrir Dieu, dont la présence réelle s’est toujours révélée sous l’apparence
ignée. Le buisson ardent (Exode, III, 2) et l’embrasement du Sinaï lors de la
remise du décalogue (Exode, XIX, 18) sont deux manifestations par lesquelles
Dieu apparut à Moïse. Et c’est sous la figure d’un être de jaspe et de sardoine
couleur de flamme, assis sur un trône incandescent et fulgurant, que saint Jean
décrit le Maître de l’univers (Apocalypse, IV, 3, 5). « Notre Dieu est un feu
dévorant », écrit saint Paul dans son Épître aux Hébreux (ch. XII, 29). Ce
n’est donc pas sans raison que toutes les religions ont considéré le feu comme
la plus claire image et l’emblème le plus expressif de la divinité. « Un
symbole des plus anciens, dit Pluche, puisqu’il est devenu universel, est le
feu que l’on entretenoit perpétuellement dans le lieu de l’assemblée des
peuples. Rien n’étoit plus propre à leur donner une idée sensible de la
puissance, de la beauté, de la pureté et de l’éternité de l’être qu’ils
venoient adorer. Ce symbole magnifique a été en usage dans tout l’Orient. Les
Perses le regardoient comme la plus parfaite image de la divinité. Zoroastre
n’en introduisit point l’usage sous Darius Histarpès, mais il enchérit par des
vues nouvelles sur une pratique établie longtemps avant lui. Les prytanées des
Grecs étoient un foyer perpétuel. La Vesta des Étrusques, des Sabins et des
Romains n’étoit rien de plus. On a retrouvé le même usage au Pérou et dans
d’autres parties de l’Amérique. Moyse conserva la pratique du feu perpétuel
dans le lieu saint, parmi les cérémonies dont il fixa le choix et prescrivit le
détail aux Israélites. Et le même symbole si expressif, si noble et si peu
capable de jeter l’homme dans l’illusion, subsiste encore aujourd’hui dans tous
nos temples. » [Noël Pluche. Histoire du
Ciel. Paris, veuve Estienne, 1739. Tome I, p. 24.]
Prétendre que le feu provient de la combustion, c’est
relever un fait d’observation courante, sans en fournir d’explication. Les
lacunes de la science moderne découlent pour la plupart de cette indifférence,
voulue ou non, à l’égard d’un agent si important et si universellement répandu.
Que penser de l’étrange obstination qu’observent certains savants à méconnaître
le point de contact qu’il constitue, le trait d’union qu’il réalise entre la
Science et la Religion ? Si la chaleur naît du mouvement, comme on le prétend,
qui donc, demanderons-nous, génère et entretient le mouvement, producteur du
feu, sinon le feu lui-même ? Cercle vicieux d’où matérialistes et sceptiques ne
pourront jamais s’échapper. Pour nous, le feu ne saurait être le résultat ou
l’effet de la combustion, mais sa cause véritable. C’est par son dégagement de
la matière grave, qui le tenait enfermé, que le feu se manifeste et qu’apparaît
le phénomène connu sous le nom de combustion. Et, que ce dégagement soit
spontané ou provoqué, le simple bon sens nous oblige à admettre et à soutenir
que la combustion est le résultat du dégagement igné et non pas la cause
première du feu.
Impondérable, insaisissable, toujours mouvant, le feu
possède toutes les qualités que nous reconnaissons aux esprits ; il est
néanmoins matériel, puisque nous éprouvons sa clarté lorsqu’il brille, et que,
même obscur, notre sensibilité nous en décèle la présence par la chaleur
rayonnante. Or, la qualité spirituelle du feu ne nous est-elle pas révélée dans
la flamme ? Pourquoi celle-ci tend-elle sans cesse à s’élever, comme un
véritable esprit, malgré nos efforts pour la contraindre à s’abaisser vers le
sol ? N’y a-t-il pas là une manifestation formelle de cette volonté qui, en la
libérant de l’emprise matérielle, l’éloigne de la terre et la rapproche de sa
patrie céleste ? Et qu’est-ce que la flamme, sinon la forme visible, la
signature même et l’effigie propre du feu ?
Mais ce que nous devons surtout retenir, comme ayant la
priorité dans la science qui nous intéresse, c’est la haute vertu purificatrice
que possède le feu. Principe pur par excellence, manifestation physique de la
pureté même, il signale ainsi son origine spirituelle et découvre sa filiation
divine. Constatation assez singulière, le mot grec πῦρ, qui sert à désigner le
feu, présente exactement la prononciation du qualificatif français pur ; aussi,
les philosophes hermétiques, en unissant le nominatif au génitif, créèrent-ils
le terme πῦρ-πυρός, le feu du feu, ou phonétiquement, le pur du pur, et
regardèrent le purpura latin et le pourpre français comme le sceau de la
perfection absolue dans la propre couleur de la pierre philosophale.
XII (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)
Notre étude des caissons de Dampierre est terminée. Il nous
reste seulement à signaler quelques motifs décoratifs ne présentant d’ailleurs
aucun rapport avec les précédents ; ils montrent des ornements symétriques, –
rinceaux, entrelacs, arabesques, agrémentés ou non de figures, – dont la
facture dénote une exécution postérieure à celle des sujets symboliques. Tous
sont dépourvus de phylactères et d’inscriptions. Enfin, les dalles de fond d’un
petit nombre de caissons attendent encore la main du sculpteur.
Il est à présumer que l’auteur du merveilleux grimoire, dont
nous avons entrepris de déchiffrer les feuillets et les signes, a dû, par suite
de circonstances ignorées, interrompre une œuvre que ses successeurs ne
pouvaient poursuivre ni achever, faute de la comprendre. Quoi qu’il en soit, le
nombre, la variété, l’importance ésotérique des sujets de ce superbe recueil
font de la galerie haute du château de Dampierre une admirable collection, un
véritable musée d’emblèmes alchimiques, et classent notre Adepte parmi les
maîtres inconnus les mieux instruits des mystères de l’Art sacré.
Mais, avant de quitter cet ensemble magistral, nous nous
permettrons d’en rapprocher l’enseingement d’un curieux tableau de pierre que
l’on voit au palais Jacques-Cœur, à Bourges, et qui nous semble pouvoir lui
tenir lieu de conclusion et de sommaire. Ce panneau sculpté forme le tympan
d’une porte ouverte sur la cour d’honneur et représente trois arbres exotiques,
– palmier, figuier dattier, – croissant au milieu de plantes herbacées ; un
encadrement de fleurs, de feuilles et de rameaux entoure ce bas-relief (pl.
XXXIII).
 |
| Planche XXXIII |
Le palmier et le dattier, arbres de la même famille, étaient
connus des Grecs sous le nom de Φοίνιξ (latin Phœnix), qui est notre Phénix
hermétique ; ils figurent les deux Magistères et leur résultat, les deux
pierres blanche et rouge, lesquelles n’ont qu’une seule et même nature comprise
sous la dénomination cabalistique de Phénix. Quant au figuier occupant le
centre de la composition, il indique la substance minérale d’où les philosophes
tirent les éléments de la renaissance miraculeuse du Phénix, et c’est le
travail entier de cette renaissance qui constitue ce qu’il est convenu d’appeler
le Grand-Œuvre.
D’après les Évangiles apocryphes, ce fut un figuier ou
sycomore (figuier de Pharaon) qui eut l’honneur d’abriter la sainte Famille
lors de sa fuite en Égypte, de la nourrir de ses fruits et de la désaltérer,
grâce à l’eau limpide et fraîche que Jésus enfant fit sourdre d’entre ses
racines. [Cf. Évangile de l’Enfance,
ch. XXIII, XXV, dans Apocryphes de Migne,
t. I, p. 995.] Or, figuier, en grec, se dit συκῆ, de σῦκον, figue, mot
fréquemment employé pour κύσθος, racine κύω, porter dans son sein, contenir :
c’est la Vierge mère qui porte l’Enfant, et l’emblème alchimique de la
substance passive, chaotique, aqueuse et froide, matrice et véhicule de
l’esprit incarné. Sozomène, auteur du IVe siècle, affirme que l’arbre
d’Hermopolis, qui s’inclina devant l’Enfant Jésus, s’appelle Persea (Hist.
Eccl., lib. V, cap. XXI). C’est le nom du Balanus (Balanites Ægyptiaca),
arbrisseau d’Égypte et d’Arabie, sorte de chêne appelé des Grecs βάλανος,
gland, mot par lequel ils désignaient aussi le myrobolan, fruit du
myrobalanier. Ces divers éléments se rapportent parfaitement au sujet des sages
et à la technique de l’art bref, que Jacques Cœur paraît avoir pratiquée.
En effet, lorsque l’artiste, témoin du combat que se livrent
le rémora et la salamandre, dérobe au monstre igné, vaincu, ses deux yeux, il
doit ensuite s’appliquer à les réunir en un seul. Cette opération mystérieuse,
facile toutefois pour qui sait utiliser le cadavre de la salamandre, fournit
une petite masse assez semblable au gland de chêne, parfois à la châtaigne,
selon qu’elle est plus ou moins revêtue de la gangue rugueuse dont elle ne se
montre jamais entièrement libérée. Cela nous fournit l’explication du gland et
du chêne, que l’on rencontre presque toujours dans l’iconographie hermétique ;
des châtaignes, particulières au style de Jean Lallemant ; du cœur, des figues,
du figuier de Jacques Cœur ; du grelot, accessoire des marottes de fous ; des
grenades, poires et pommes, fréquentes dans les œuvres symboliques de Dampierre
et de Coulonges, etc. D’autre part, si l’on tient compte du caractère magique
et quasi surnaturel de cette production, on comprendra pourquoi certains
auteurs ont désigné le fruit hermétique sous l’épithète de myrobolan, et
pourquoi aussi ce terme est resté dans l’esprit populaire comme synonyme de
chose merveilleuse, surprenante ou rarissime. [On écrit aujourd’hui mirobolant,
mais l’étymologie et la prononciation n’ont pas varié.]
Les prêtres d’Égypte, directeurs des collèges initiatiques,
avaient coutume de poser au profane, sollicitant l’accès aux sublimes
conaissances, cette question d’apparence saugrenue : « Sème-t-on, dans votre
pays, de la graine d’Halalidge et du Myrobolan ? » Interrogation qui ne
laissait pas d’embarrasser l’ignorant néophyte, mais à laquelle savait répondre
l’investigateur averti. La graine d’Halalidge et le Myrobolan sont identiques à
la figue, au fruit du palmier dattier, à l’œuf du phénix qui est notre œuf
philosophique. C’est lui qui reproduit l’aigle fabuleux d’Hermès, au plumage teint
de toutes les couleurs de l’Œuvre, mais parmi lesquelles domine le rouge, ainsi
que le veut son nom grec : φοίνιξ, rouge pourpre. De Cyrano Bergerac n’omet
point d’en parler, au cours d’un récit allégorique où se mêle ce langage des
oiseaux que le grand philosophe possédait admirablement. « Je commençois de
m’endormir à l’ombre, dit-il, lorsque j’aperçus en l’air un oiseau merveilleux
qui planoit sur ma tête ; il se soutenoit d’un mouvement si léger et si
imperceptible, que je doutai plusieurs fois si ce n’étoit point encore un petit
univers balancé par son propre centre. Il descendit pourtant peu à peu, et
arriva enfin si proche de moi, que mes yeux soulagés furent tout pleins de son
image. Sa queue paroissoit verte, son estomac d’azur émaillé, ses ailes incarnates,
et sa tête pourpre faisoit briller, en s’agitant, une couronne d’or dont les
rayons jaillissoient de ses yeux. Il fut longtemps à voler dans la nue ; et je
me tenois tellement à tout ce qu’il devenoit, que mon âme s’étant repliée et
comme raccourcie à la seule opération de voir, elle n’atteignit presque pas
jusqu’à celle d’ouïr, pour me faire entendre que l’oiseau parloit en chantant.
Ainsi, peu à peu débandé de mon extase, je remarquai distinctement les
syllabes, les mots et le discours qu’il articula. Voici donc, au mieux qu’il me
souvient, les termes dont il arrangea le tissu de sa chanson :
« Vous êtes étranger, siffla l’oiseau fort agréablement, et
naquîtes dans un Monde dont je suis originaire. Or, cette propension secrète
dont nous sommes émus pour nos compatriotes, est l’instinct qui me pousse à
vouloir que vous sachiez ma vie…
« Je vois bien que vous êtes gros d’apprendre qui je suis.
C’est moi que parmi vous on appelle Phénix. Dans chaque Monde, il n’y en a
qu’un à la fois, lequel y habite durant l’espace de cent ans ; car, au bout
d’un siècle, quand sur quelque montagne d’Arabie il s’est déchargé d’un gros
œuf au milieu des charbons de son bûcher, dont il a trié la matière de rameaux
d’aloès, de cannelle et d’encens, il prend son essor et dresse sa volée au
Soleil, comme la patrie où son cœur a longtemps aspiré. Il a bien fait
auparavant tous ses efforts pour ce voyage ; mais la pesanteur de son œuf, dont
les coques sont si épaisses qu’il faut un siècle à le couver, retardoit
toujours l’entreprise.
« Je me doute bien que vous aurez de la peine à concevoir
cette miraculeuse production ; c’est pourquoi je veux vous l’expliquer. Le
Phénix est hermaphrodite ; mais entre les hermaphrodites, c’est encore un autre
Phénix tout extraordinaire car… [L’auteur interrompt ainsi, brusquement, sa
révélation.]
« Il resta un demi-quart d’heure sans parler, et puis il
ajouta : « Je vois bien que vous soupçonnez de fausseté ce que je vous viens
d’apprendre ; mais, si je ne dis vrai, je veux jamais n’aborder votre globe,
qu’un aigle ne fonde sur moi. » [De Cyrano Bergerac. L’Autre Monde. Histoire des Oiseaux. Paris, Bauche, 1910.]
Un autre auteur s’étend davantage sur l’oiseau
mytho-hermétique et en signale quelques particularités qu’il serait difficile
de trouver ailleurs. « Le Cesar des Oyseaux, dit-il, est le miracle de la
nature [Expression hermétique consacrée à la pierre philosophale.], qui a voulu
monstrer en iceluy ce qu’elle sçait faire, se monstrant un Phœnix en formant le
Phœnix. Car elle l’a enrichi à merveille, luy faisant une teste tymbrée d’un
pennache royal et d’aigrettes impériales, d’une touffe de plumes et d’une
creste si esclatante qu’il semble qu’il porte ou le croissant d’argent, ou une
estoille dorée sur sa teste. La chemise et le duvet est d’un changeant surdoré
qui monstre toutes les couleurs du monde ; les grosses plumes sont d’incarnat
et d’azur, d’or, d’argent et de flamme ; le col est un carquan de toutes
pierreries, et non un arc-en-ciel, mais un arc en phœnix. La queüe est de couleur
céleste avec un eclat d’or qui represente les estoilles. Ses pennes, et tout
son manteau, est comme une prime-vere, riche de toutes couleurs ; il a deux
yeux en teste, brillans et flamboyans, qui semblent deux estoilles, les jambes
d’or et les ongles d’ecarlate ; tout son corsage et son port monstre qu’il a
quelque sentiment de gloire, qu’il sçait tenir son rang et faire valoir sa
majesté imperiale. Sa viande mesme a je ne sçay quoy de royal, car il ne fait
son past que de larmes d’encens et de chresme de baume. Estant au berceau, le
ciel, dit Lactance, luy distile du nectar et de l’ambroisie. Luy seul est
temoin de tous les ages du monde, et a veu metamorphoser les ames dorées du
siecle d’or en argent, d’argent en airain, d’airain en fer. Luy seul n’a jamais
faussé compagnie au ciel et au monde ; luy seul se jouë de la mort, et la fait
sa nourrice et sa mere, luy faisant enfanter la vie. Luy a privilege du temps,
de la vie et de la mort ensemble. Car, quand il se sent chargé d’ans, appesanty
d’une longue vieillesse, et abbatu par si longue suitte d’années qu’il a veu se
glisser les unes apres les autres, il se laisse emporter à un desir et juste
envie de se renouveller par un trespas miraculeux. Lors, il fait un amas qui
seul au monde n’a point de nom, car ce n’est pas un nid, ou un berceau, ou lieu
de sa naissance, puisqu’il y laisse la vie ; aussi n’est-ce pas un tombeau, un
cercueil ou une urne funeste, car de là il reprend sa vie ; de façon que je ne
sçay quoy est un autre phœnix inanimé, estant nid et tombeau, matrice et
sepulcre, l’hostel de la vie et de la mort tout ensemble, qui, en faveur du
Phœnix, s’accordent pour ce coup. Or, quoy que c’en soit, là, sur les bras
tremblants d’une palme, il fait un amas de brins de cannelle et d’encens ; sur
l’encens de la casse, sur la casse du nard ; puis, avec une piteuse œillade, se
recommandant au Soleil, son meurtrier et son père, se perche ou se couche sur
ce bûcher de baume, pour se despouiller de ses fascheuses années.
[Nous retrouvons ici le palmier symbolique de Délos, contre
lequel Latone s’était appuyée lorsqu’elle mit au monde Apollon, suivant ce que
rapporte Callimaque dans l’Hymne à Délos :
« Pour fêter, ô Délos ! ces fortunés moments,
Un or pur reluisait jusqu’en tes fondements ;
L’or couvrait ton palmier d’une feuille éclatante ;
L’or colorait ton lac d’une onde éblouissante ;
Et, durant tout un jour, de ses gouffres profonds,
L’Inopus vomissait l’or pur à gros bouillons. »]
« Le Soleil, favorisant les justes desirs de cest
Oyseau, allume le bûcher, et, reduisant tout en cendre, avec un souffle musqué,
luy fait rendre la vie. Lors, la pauvre nature se void en transe, et, avec des
horribles eslancemens, craignant de perdre l’honneur de ce grand monde, aussi
commande elle que tout demeure coy au monde ; les nuées n’oseroient verser sur
la cendre ny sur la terre une goutte d’eau ; les vents, pour enragez qu’ils
soient, n’oseroient courir la campagne ; le seul Zephire est maistre, et le
printems tient le dessus, tandis que la cendre est inanimée, et la nature tient
la main que tout favorise le retour de son Phœnix. O grand miracle de la divine
providence ! quasi en mesme temps ceste cendre froide ne voulant laisser
longtemps la pauvre nature en dueil et luy donner l’epouvante, je ne sçay
comment eschauffée par la fecondité des raiz dorez du Soleil, se change en un
petit ver, puis en un œuf, enfin en un Oyseau dix fois plus beau que l’autre.
Vous diriez que toute la nature est ressuscitée, car de fait, selon qu’écrit
Pline, le ciel de nouveau recommence ses revolutions et sa douce musique, et
diriez proprement que les quatre Elemens, sans dire mot, chantent un motet à
quatre avec leur gayeté fleurissante, en loüange de la nature, et pour bien
veigner le retour du miracle des Oyseaux et du monde. » [René François.
Essay des Merveilles de Nature et des plus
nobles artifices. Lyon, J. Huguetan, 1642, ch. V, p. 69.] (pl. XXXIV)
 |
| Planche XXXIV |
Ainsi que les caissons de Dampierre, le panneau aux trois
arbres sculptés du palais de Bourges porte une devise. Sur la bordure d’encadrement
décorée de rameaux florifères, l’observateur attentif découvre, en effet, des
lettres isolées, fort habilement dissimulées. Leur réunion compose une des
maximes favorites du grand artiste que fut Jacques Cœur :
DE . MA . JOIE . DIRE . FAIRE . TAIRE .
Or, la joie de l’Adepte réside dans son occupation. Le
travail, qui lui rend sensible et familière cette merveille de nature, – que
tant d’ignorants qualifient de chimérique, – constitue sa meilleure
distraction, sa plus noble jouissance. En grec, le mot χαρά,
joie, dérivé de χαίρω, se réjouir, se plaire à, se complaire dans, signifie
encore aimer. Le célèbre philosophe fait donc nettement allusion au labeur de
l’Œuvre, sa plus chère besogne, dont tant de symboles, d’ailleurs, viennent
rehausser l’éclat du somptueux logis. Mais que dire, qu’avouer de cette joie
unique, satisfaction pure et complète, allégresse intime du succès ? Le moins
possible, si l’on ne veut point se parjurer, attiser l’envie des uns, la
cupidité des autres, la jalousie de tous, et risquer de devenir la proie des
puissants. Que faire ensuite du résultat, dont l’artiste, selon les règles de
notre discipline, s’engage pour lui-même à modestement user ? L’employer sans
cesse au bien, en consacrer les fruits à l’exercice de la charité, conformément
aux préceptes philosophiques et à la morale chrétienne. Que taire enfin ?
Absolument tout de ce qui regarde le secret alchimique et concerne sa mise en
pratique ; car la révélation, demeurant le privilège exclusif de Dieu, la
divulgation des procédés reste interdite, non communicable en langage clair,
permise seulement sous le voile de la parabole, de l’allégorie, de l’image ou
de la métaphore.
La devise de Jacques Cœur, malgré sa brièveté et ses
sous-entendus, se montre en concordance parfaite avec les enseignements
traditionnels de l’éternelle sagesse. Aucun philosophe, vraiment digne de ce
nom, ne refuserait de souscrire aux règles de conduite qu’elle exprime et que
l’on peut traduire ainsi :
Du Grand-Œuvre dire
peu, faire beaucoup, taire toujours.
LES GARDES DU CORPS DE FRANÇOIS II
Lorsque, vers l’année 1502, Anne, duchesse de Bretagne et
deux fois reine de France, forma le projet de réunir, dans un mausolée digne de
la vénération qu’elle leur portait, les corps de ses parents défunts, elle en
confia l’exécution à un artiste breton, de grand talent, mais sur qui on ne
possède que peu de renseignements, Michel Colombe. Elle avait alors vingt-cinq
ans. Son père, le duc François II, était décédé à Couëron quatorze années plus
tôt, le 9 septembre 1488, ne survivant à sa seconde femme, Marguerite de Foix,
mère de la reine Anne, que de seize mois. Elle s’était éteinte, en effet, le 15
mai 1487.
Ce mausolée, commencé en 1502, ne fut achevé qu’en 1507. Le
plan est l’œuvre de Jean Perréal. Quant aux sculptures, qui en font l’un des
plus purs chefs-d’œuvres de la Renaissance, elles sont de Michel Colombe,
lequel fut aidé dans ce travail par deux de ses élèves : Guillaume Regnauld,
son neveu, et Jehan de Chartres, « son disciple et serviteur », quoique la
collaboration de ce dernier ne soit pas absolument certaine. Une lettre, écrite
le 4 janvier 1511, par Jean Perréal au secrétaire de Marguerite de Bourgogne, à
l’occasion des travaux que cette princesse faisait exécuter dans la chapelle de
Brou, nous apprend que « Michel Coulombe besongnoit au moiz et avoit pour moiz
XX. escus, l’espace de sinc ans ». Le travail de sculpture lui fut payé 1.200
écus, et le tombeau coûta au total 560 livres. [Cf. Abbé G. Durville, Études sur le vieux Nantes. tome II.
Vannes, Lafolye Frères, 1915.]
Selon le désir qu’avaient manifesté Marguerite de Bretagne
et François II, d’être inhumés dans l’église des Carmes de Nantes, Anne y fit
édifier le mausolée, qui prit le nom de Tombeau des Carmes, sous lequel il est
généralement connu et désigné. Il demeura en place jusqu’à la Révolution,
époque à laquelle l’église des Carmes, ayant été vendue comme bien national, il
fut enlevé et gardé secrètement par un amateur d’art soucieux de soustraire le
chef-d’œuvre au vandalisme révolutionnaire. La tourmente passée, on le
réédifia, en 1819, dans la cathédrale Saint-Pierre, de Nantes, où nous pouvons
l’admirer aujourd’hui. Le sépulcre voûté, construit sous le mausolée d’apparat,
contenait, lors de son ouverture sur l’ordre du roi, par Mellier, maire de
Nantes, les 16 et 17 octobre 1727, les trois cercueils de François II, de
Marguerite de Bretagne, sa première femme, décédée le 25 septembre 1449, et de
Marguerite de Foix, seconde épouse du duc et mère de la reine Anne. Une petite
caisse s’y trouvait également ; elle renfermait un reliquaire « d’or pur et
munde », en forme d’œuf, surmonté de la couronne royale, couvert d’inscriptions
aux lettres finement émaillées, et contenant le cœur d’Anne de Bretagne, dont
le corps repose à la basilique Saint-Denis.
[M. le chanoine G. Durville, à l’ouvrage de qui nous
empruntons ces détails, a bien voulu nous adresser une image de cette curieuse
pièce, vide, hélas ! de son contenu, laquelle fait partie des collections du
musée Th. Dobrée, à Nantes, dont il est le conservateur. « Je vous envoie, nous
écrit-il, une petite photographie de ce précieux reliquaire. Je l’ai placée un
instant à l’endroit même où était le cœur de la reine Anne, dans la pensée que
cette circonstance vous ferait attacher plus d’intérêt à ce petit souvenir. »
Nous prions M. le chanoine Durville de bien vouloir agréer ici l’expression de
nos vifs remerciements pour sa pieuse sollicitude et sa délicate attention.]
Parmi les relations descriptives que divers auteurs ont
laissées du tombeau des Carmes, il en est de très minutieuses. Nous choisirons
de préférence, pour donner un aperçu de l’œuvre, celle de frère Mathias de
Saint-Jean, carme de Nantes, qui la publia au XVIIe siècle.
« Mais ce qui me semble de plus rare et digne d’admiration,
dit cet écrivain, c’est le Tombeau élevé dans le cœur de l’eglise des Peres
Carmes, qui, à l’aveu de tout le monde, est un des plus beaux et des plus
magnifiques qui se puisse voir, ce qui m’oblige d’en faire une description particuliere
pour la satisfaction des curieux.
« La devotion que les anciens Ducs de Bretagne avoient eu de
lontems à la très Sainte Vierge mère de Dieu, patronne de l’Ordre et de cette
Église des P. P. Carmes, et l’affection qu’ils avoient aux Religieux de cette
Maison, les porta à y choisir le lieu de leur Sepulture. Et la reine Anne, par
un unique temoignage de sa pitié et affection à ce lieu, voulut y faire elever
ce beau Monument en memoire de son père François Second et de sa mère
Marguerite de Foye.
« Il est bâti en quarré, de huit pieds de large sur quatorze
de long : sa matiere est toute de marbre fin d’Italie, blanc et noir, de
porphire et d’albâtre. Le cors est elevé sur le plan (le sol) de l’Église, de
six pieds de haut. Les deux côtez sont ornez de six niches, châcune de deux
pieds de haut, dont le fond est de porphire bien ouvragé, orné à l’entour de
pilastres de marbre blanc, dans toutes les justes proportions et regles
d’architecture, enrichis de moresque (arabesques) fort delicatement travaillées
: et toutes ces douze niches sont remplies de figures des douze Apôtres, de
marbre blanc, chacun ayant sa posture differente, et les instrumens de sa
passion. Les deux bouts de ce cors sont ornez de pareille architecture, et
châcun divisé en deux niches pareilles aux autres. Au bout vers le maistre
Autel de l’Eglise sont posées dans ces niches les figures de Saint-François
d’Assise et de Saincte Marguerite, patrons du dernier Duc et de la Duchesse qui
y sont enterrez : et à l’autre bout se voient pareillement dans des niches les
figures de S. Charlemagne et de S. Louis Roi de France. Au-dessous des dites
seize niches qui entourent le cors du Tombeau, il y a autant de concavitez
faites en rond de quatorze pouces de diamètre, dont le fond est de marbre blanc
taillé en forme de coquille, et toutes sont remplies de figures de pleureurs
avec leurs habits de dueil, tous en diverses postures, dont l’ouvrage est
consideré de peu de personnes, mais il est admiré de tous ceux qui l’entendent.
« Ce cors est couvert d’une grande table de marbre noir
toute d’une piece, et qui excede le solide (la masse du tombeau) d’environ huit
pouces, à l’entour en forme de corniche, pour servir d’entablement et
d’ornement à ce cors. Dessus cette pierre sont couchées deux grandes figures de
marbre blanc, châcune de huit pieds de long, dont l’une represente le Duc, et
l’autre la Duchesse avec leurs habits et Couronnes Ducalles. Trois figures
d’Anges de marbre blanc, de trois pieds châcune, tiennent des carreaux
(coussins) sous les testes de ces figures, qui semblent mollir sous le faix, et
les Anges pleurer. Aux pieds de la figure du Duc, il y a une figure de Lyon
couché représenté au naturel, qui porte sur sa jube (crinière) l’écu des armes
de Bretagne : et aux pieds de la figure de la Duchesse, il y a la figure d’un
Levrier, qui porte aussi au col les armes de la maison de Foïe que l’art anime
merveilleusement bien.
« Mais ce qu’il y a de plus merveilleux en cette piece, sont
les quatre figures des Vertus Cardinales, posées aux quatre coins de cette
sepulture, faites en marbre blanc, de la hauteur de six pieds : elles sont si
bien taillées, si bien plantées, et ont tant de rapport au naturel, que les
originaires et les etrangers avoüent qu’on ne voit rien de mieux, ni dans les
antiques de Rome, ni dans les modernes d’Italie, de France et d’Allemagne. La
figure de la Justice est posée au coin droit en entrant, qui porte une espée
levée dans la main droite, et un livre avec une balance dans la gauche, la
couronne en teste, habillée de panne et de fourrure qui sont les marques de la
science, de l’equité, de la sévérité et majesté qui accompagnent cette vertu.
« À l’opposite, du côté gauche, est la figure de la
Prudence, qui a deux faces opposées l’une à l’autre en une mesme teste : l’une
d’un vieillard à longue barbe, l’autre d’un jeune jouvenceau ; dans la main
droite (gauche) elle tient un miroüer convexe qu’elle regarde fixement, et de
l’autre un compas : à ses pieds parêt un serpent, et ces choses sont symboles
de la consideration et de la sagesse avec laquelle cette vertu procede dans ses
actions.
« À l’angle droit, du côté d’en haut, est la figure de la
Force, habillée d’une cotte de mailles (armure) et le heaume en teste ; de sa
main gauche elle suporte une tour, des crevasses de laquelle sort un serpent
(un dragon) qu’elle étouffe avec la main droite, qui marque la vigueur dont
cette vertu se sert dans les adversitez du monde pour en empêcher la violence
ou en supporter le poids.
« Au coing opposite est la figure de la Temperance revestüe
d’une longue robe, ceinte d’un cordon : de la main droite, elle supporte la
machine d’une horloge, et de l’autre un mors de bride, hieroglifique du
reglement et de la moderation que cette vertu met dans les passions humaines. »
[Le Commerce honorable, etc., composé par
un habitant de Nantes. Nantes, Guillaume Le Monnier, 1646, p. 308-312.]
Les éloges que frère Mathias de Saint-Jean fait de ces
gardes du corps de François II, représentés par les Vertus cardinales de Michel
Colombe, nous semblent parfaitement mérités. [Michel Colombe, né à
Saint-Pol-de-Léon en 1460, avait environ quarante-cinq ans lorsqu’il les
exécuta.] « Ces quatre statues, dit de Caumont, sont admirables de grâce et de
simplicité. Les draperies sont rendues avec une rare perfection et, dans chaque
figure, on observe une individualité très frappante, bien que toutes les quatre
soient également nobles et belles. » [De Caumont, Cours d’Antiquités monumentales, 1841 ; 6e partie, p. 445.]
Ce sont ces statues, empreintes du plus pur symbolisme,
gardiennes de la tradition et de la science anciennes, que nous allons
particulièrement étudier.
II (Les gardes du corps de François II, duc de Bretagne)
À l’exception de la Justice, les Vertus cardinales ne sont
plus représentées avec les attributs singuliers qui donnent aux figures
anciennes leur caractère énigmatique et mystérieux. Sous la pression de
conceptions plus réalistes, le symbolisme s’est transformé. Les artistes,
abandonnant toute idéalisation de la pensée, obéissent de préférence au
naturalisme ; ils serrent de près l’expression des attributs et facilitent
l’identification des personnages allégoriques. Mais, en perfectionnant leurs
procédés et en se rapprochant davantage des formules modernes, ils ont,
inconsciemment, porté un coup mortel à la vérité traditionnelle. Car les
sciences antiques, transmises sous le voile d’emblèmes divers, relèvent de la
Diplomatique et se présentent pourvues d’une double
signification, l’une, apparente, compréhensible à tous (exotérisme), l’autre,
cachée, accessible seulement aux initiés (ésotérisme). En précisant le symbole,
limité à sa fonction positive, normale et définie ; en l’individualisant au
point d’exclure toute idée connexe ou relative, on le dépouille de ce double
sens, de l’expression seconde qui en fait précisément la valeur didactique et
l’essentielle portée. Les anciens figuraient la Justice, la Fortune et l’Amour,
avec les yeux bandés. Prétendaient-ils exprimer uniquement la cécité de l’une,
l’aveuglement des autres ? Ne pourrait-on découvrir, dans l’attribut du bandeau
oculaire, une raison spéciale de cette obscurité artificielle et sans doute
nécessaire ? Il suffirait de savoir que ces figures, assujetties communément
aux vicissitudes humaines, appartiennent aussi à la tradition scientifique,
pour aisément la reconnaître. Et l’on s’apercevrait même que le sens occulte
s’avère avec une clarté supérieure à celle qui est obtenue par l’analyse
directe et la lecture superficielle. Quand les poètes racontent que Saturne,
père des dieux, dévorait ses enfants, on croit, avec l’Encyclopédie, qu’« une
telle métaphore sert à caractériser une époque, une institution, etc., dont les
circonstances ou les résultats deviennent fatals à ceux mêmes qui auraient dû
n’en recueillir que les bienfaits ». Mais si nous substituons à cette
interprétation générale la raison positive et scientifique qui constitue le
fond des légendes et des mythes, la vérité se dégage aussitôt, lumineuse et
patente. L’Hermétisme enseigne que Saturne, représentant symbolique du premier
métal terrestre, générateur des autres, est aussi leur unique et naturel
dissolvant ; or, comme tout métal dissous s’assimile au dissolvant et perd ses
caractéristiques, il est exact et logique de prétendre que le dissolvant «
mange » le métal, et qu’ainsi le vieillard fabuleux dévore sa progéniture.
Nous pourrions donner quantité d’exemples de cette dualité
de sens qu’exprime le symbolisme traditionnel. Celui-là seul suffit à démontrer
que, conjointement à l’interprétation morale et chrétienne des Vertus
cardinales, il existe un second enseignement, secret, profane, ordinairement
méconnu, qui appartient au domaine matériel des acquisitions, des connaissances
ancestrales. Ainsi retrouvons-nous, scellée dans la forme des mêmes emblèmes,
l’harmonieuse alliance de la Science et de la Religion, si féconde en résultats
merveilleux, mais que le scepticisme de nos jours refuse de vouloir reconnaître
et conspire à toujours écarter.
« Le thème des Vertus, remarque fort justement M. Paul
Vitry, s’était constitué au XIIIe siècle dans l’art gothique. Mais, ajoute
l’auteur, tandis que la série en était restée assez variable chez nous comme
nombre, comme ordre et comme attributs, elle s’était fixée de bonne heure en
Italie, et s’était limitée soit aux trois Vertus théologales : Foi, Espérance,
Charité, soit plus souvent peut-être encore aux quatre Vertus cardinales :
Prudence, Justice, Force, Tempérance. Elle s’était de plus appliquée de bonne
heure à l’ornementation des monuments funéraires.
« Quant à la façon de caractériser ces Vertus, elle paraît à
peu près arrêtée avec Orcagna et son tabernacle d’Or San Michele dès le milieu
du XIVe siècle. La Justice porte l’épée et la balance et ne variera jamais.
L’attribut essentiel de la Prudence est le serpent ; il s’y ajoute parfois un
ou plusieurs livres, plus tard un miroir. Presque dès l’origine également, par
une idée analogue à celle de Dante, qui avait donné trois yeux à sa Prudence,
les imagiers donnèrent deux visages à cette Vertu. La Tempérance remet quelques
fois son épée au fourreau, mais le plus souvent elle tient deux vases et paraît
mélanger l’eau et le vin : c’est l’élémentaire symbole de la sobriété. Enfin,
la Force a les attributs de Samson ; elle est armée du bouclier et de la
massue ; parfois elle a la peau de lion sur la tête et un disque figurant le
monde dans les mains ; d’autres fois enfin, et ce sera son attribut définitif,
en Italie du moins, elle porte la colonne entière ou brisée…
« À défaut du reste des grands monuments, les manuscrits,
les livres, les gravures se chargeaient de répandre le type des Vertus à
l’italienne et pouvaient même le faire connaître à ceux qui, comme Colombe,
n’avaient sans doute pas fait le voyage d’Italie. Une série de gravures
italiennes de la fin du XVe siècle, qui est connue sous le nom de Jeu de cartes d’Italie, nous montre, au
milieu de représentations des différentes conditions sociales, des Muses, des
dieux de l’antiquité, des Arts libéraux, etc., une série de figures de Vertus ;
elles ont exactement les attributs que nous venons de décrire… Nous avons là un
spécimen très curieux de ces documents qui purent être rapportés par les gens
tels que Perréal, qui avaient suivi les expéditions, documents qui purent
circuler dans les ateliers et fournir des thèmes en attendant qu’ils
imposassent un style nouveau.
« Ce langage symbolique, du reste, n’avait pas de peine à
être compris chez nous ; il était tout à fait conforme à l’esprit allégorique
du XVe siècle. Il suffit de songer, pour s’en rendre compte, au Roman de la
Rose et à toute la littérature qui en était issue. Les miniaturistes avaient
abondamment illustré ces ouvrages et, en dehors même de ces allégories de
Nature, de Déduit et de Faux Semblant, l’art français n’ignorait certainement
pas la série des Vertus, quoique ce ne fût pas un thème aussi fréquemment
employé qu’en Italie. » [Paul Vitry. Michel
Colombe et la sculpture française de son temps. Paris, E. Lévy, 1901, p.
395 et suiv.]
Toutefois, sans nier absolument, dans les splendides figures
du Tombeau des Carmes, quelque influence italienne, Paul Vitry relève le
caractère nouveau, essentiellement français, que Michel Colombe allait donner
aux éléments ultramontains rapportés par Jean Perréal. « En admettant même,
poursuit l’auteur, qu’ils en aient emprunté l’idée première aux tombeaux
italiens, Perréal et Colombe n’allaient pas accepter, sans modification, ce
thème des Vertus cardinales. » En effet, « la Tempérance portera dans ses mains
une horloge et un mors avec sa bride au lieu des deux vases que lui avaient couramment
donnés les Italiens. Quant à la Force, armée et casquée, au lieu de sa colonne,
elle tiendra une tour, sorte de donjon crénelé, d’où elle arrache violemment un
dragon qui se débat. Ni à Rome, ni à Florence, ni à Milan, ni à Côme (porte sud
de la cathédrale), nous ne connaissons rien de semblable ».
Mais si l’on peut aisément discerner, dans le cénotaphe de
Nantes, la part respective qui appartient aux maîtres Perréal et Colombe, il
est plus malaisé de découvrir jusqu’où put s’étendre l’influence personnelle,
la volonté propre de la fondatrice. Car nous ne pouvons croire qu’elle soit,
durant cinq années, désintéressée d’une œuvre qui lui tenait particulièrement à
cœur. La reine Anne, cette gracieuse souveraine que le peuple, en sa naïve
affection, nommait familièrement « la bonne duchesse en sabots de bois »,
a-t-elle connu la portée ésotérique des gardiennes du mausolée élevé en mémoire
de ses parents ? Nous résoudrions volontiers cette question par l’affirmative.
Ses biographes nous assurent qu’elle était fort instruite, douée d’une vive
intelligence et d’une clairvoyance remarquable. Sa bibliothèque paraît déjà
importante pour l’époque. « D’après le seul document, nous dit Le Roux de
Lincy, que j’ai pu découvrir relatif à l’ensemble de la bibliothèque formée par
Anne de Bretagne (Index des Comptes de
Dépenses de 1498), on y trouvait des livres manuscrits et imprimés en
latin, en français, en italien, en grec et en hébreu. Onze cent quarante
volumes, pris à Naples par Charles VIII, avaient été donnés à la reine… On
s’étonnera peut-être de voir figurer dans la collection de la reine duchesse,
des ouvrages en grec et en hébreu ; mais il ne faut pas oublier qu’elle avait
étudié les deux langues savantes et que le caractère de son esprit était par
dessus tout sérieux. » [Le Roux de Lincy, Vie
de la Reine Anne de Bretagne, femme des Rois de France Charles VIII et Louis
XII. Paris, L. Curmer, 1860, t. II, p. 34.] On nous la dépeint recherchant
la conversation des diplomates, auxquels elle se plaisait à répondre dans leur
propre langue, ce qui justifierait une éducation polyglotte très soignée et
sans doute aussi la possession de la cabale hermétique, du gay-sçavoir ou de la
double science. Aurait-elle fréquenté les savants réputés de son temps et,
parmi eux, des alchimistes contemporains ? Nous manquons de renseignements à
cet égard, bien qu’il semble difficile d’expliquer pourquoi la grande cheminée
du salon de l’hôtel Lallemant porte l’hermine d’Anne de Bretagne et le
porc-épic de Louis XII, si l’on ne veut y voir un témoignage de leur présence
dans la demeure philosophale de Bourges. Quoiqu’il en soit, sa fortune
personnelle était considérable. Les pièces d’orfèvrerie, l’or en lingots, les
gemmes précieuses formaient la masse d’un trésor quasi inépuisable. L’abondance
de telles richesses facilitait singulièrement l’exercice d’une générosité
devenue vite populaire. Les chroniqueurs nous apprennent qu’elle rétribuait
volontiers, par le don d’un diamant, le pauvre ménestrel qui l’avait distraite
pendant quelques instants. Quant à sa livrée, elle offrait les couleurs
hermétiques choisies par elle : noire, jaune et rouge, avant la mort de Charles
VIII, et seulement les deux extrêmes de l’Œuvre, noire et rouge, depuis cette
époque. Enfin, ce fut elle la première reine de France qui, brisant résolument
avec la coutume établie jusque-là, porta le deuil de son premier mari en noir,
tandis que l’usage obligeait les souveraines à toujours le porter en blanc.
III (Les gardes du corps de François II, duc de Bretagne)
La première des quatre statues que nos allons étudier est
celle qui nous offre les divers attributs chargés de préciser l’expression
allégorique de la Justice : lion, balance, épée. Mais, outre la signification
ésotérique, nettement différente du sens moral qu’on affecte à ces attributs,
la figure de Michel Colombe présente d’autres signes révélateurs de sa
personnalité occulte. Il n’est détail, si infime soit-il, qui puisse être
négligé dans toute l’analyse de ce genre, sans avoir, au préalable, été
sérieusement examiné. Or, le surcot d’hermine que porte la Justice est bordé de
roses et de perles. Notre Vertu a le front ceint d’une couronne ducale, ce qui
a pu laisser croire qu’elle reproduisait les traits d’Anne de Bretagne ; l’épée
qu’elle tient de la dextre a son pommeau orné d’un soleil rayonnant ; enfin, et
c’est là ce qui la caractérise au premier chef, elle apparaît ici dévoilée. Le
péplum qui la recouvrait toute entière a glissé le long du corps ; retenu par
la saillie des bras, il vient doubler le manteau dans sa partie inférieure. Le
glaive même a quitté son fourreau de brocard, que l’on voit maintenant suspendu
à la pointe du fer (pl. XXXV).
 |
| Planche XXXV |
Comme l’essence même de la justice et sa raison d’être
exigent qu’elle n’ait rien de caché, que la recherche et la manifestation de la
vérité l’obligent de se montrer à tous dans la pleine lumière de l’équité, le
voile, retiré à demi, doit nécessairement révéler l’individualité secrète d’une
seconde figure, adroitement dissimulée sous la forme et les attributs de la première.
Cette seconde figure n’est autre que la Philosophie.
Dans l’antiquité romaine, on appelait peplum (en grec πέπλος ou πέπλα) un voile orné de broderie dont on
habillait la statue de Minerve, fille de Jupiter, la seule déesse dont la
naissance fût merveilleuse. La fable dit, en effet, qu’elle sortit tout armée
du cerveau de son père, auquel Vulcain, sur l’ordre du maître de l’Olympe,
avait fendu la tête. De là son nom hellénique d’Athèné, – Ἀθηνά, formé de ἀ,
privatif, et τιθήνη, nourrice, mère, signifiant née sans mère. Personnification
de la Sagesse, ou Connaissance des choses, Minerve doit être regardée comme la
pensée divine et créatrice, matérialisée dans toute la nature, latente en nous
ainsi qu’en tout ce qui nous entoure. Mais c’est d’un vêtement féminin, d’un
voile de femme (κάλυμμα), qu’il est ici question, et ce mot nous fournit une
autre raison du péplum symbolique. Κάλυμμα, vient de καλύπτω couvrir,
envelopper, cacher, qui a formé κάλυξ, bouton de rose, fleur, et aussi Καλυψώ,
nom grec de la nymphe Calypso, reine de l’île mythique d’Ogyrie, que les
Hellènes nommaient Ὠγύγιος, terme voisin de Ὠγυγία, lequel a le sens d’antique
et de grand. Nous retrouvons ainsi la rose mystique, fleur du Grand-Œuvre, plus
connue sous le vocable de pierre philosophale. De sorte qu’il est facile de
saisir le rapport existant entre l’expression du voile et celle des roses et
des perles ornant le surcot de fourrure, puisque cette pierre est encore
appelée perle précieuse (Margarita
pretiosa). « Alciat, nous apprend Fr. Noël, représente la Justice sous les
traits d’une vierge dont la couronne est d’or et la tunique blanche, recouverte
d’une ample draperie de pourpre. Son regard est doux et son maintien modeste.
Elle porte sur la poitrine un riche joyau, symbole de son prix inestimable, et
pose le pied gauche sur une pierre carrée. » On ne saurait mieux décrire la
double nature du Magistère, ses couleurs, la haute valeur de cette pierre
cubique, qui porte la Philosophie toute entière, masquée, pour le vulgaire, sous
les traits de la Justice.
La Philosophie confère à l’épouse une grande puissance
d’investigation. Elle permet de pénétrer l’intime complexion des choses,
qu’elle tranche comme avec l’épée, y découvrant la présence du spiritus mundi dont parlent les maîtres
classiques, lequel a son centre dans le soleil et tire ses vertus et son
mouvement du rayonnement de l’astre. Elle donne encore la connaissance des lois
générales, des règles, du rythme et des mesures que la nature observe dans
l’élaboration, l’évolution et la perfection des choses créées (balance). Elle
établit, enfin, la possibilité d’acquisition des sciences sur la base de
l’observation, de la méditation, de la foi et de l’enseignement écrit (livre).
Par les mêmes attributs, cette image de la Philosophie nous renseigne, en
second lieu, sur les points essentiels du labeur des Adeptes, et proclame la
nécessité du travail manuel imposé aux chercheurs désirant acquérir la notion
positive, la preuve indiscutable de sa réalité. Sans recherches techniques, sans
essais fréquents ni expériences réitérées, on ne peut que s’égarer dans une
science dont les meilleurs traités cachent avec soin les principes physiques,
leur application, les matériaux et le temps. Celui donc qui ose se prétendre
philosophe et ne veut labourer par crainte du charbon, de la fatigue ou de la
dépense, celui-là doit être regardé comme le plus vaniteux des ignorants ou le
plus effronté des imposteurs. « Je puis rendre ce témoignage, a dit Augustin
Thierry, qui de ma part ne sera pas suspect : il y a au monde quelque chose qui
vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que la
santé elle-même, c’est le dévouement à la science. » L’activité du sage ne se
mesure pas aux résultats de propagande spéculative ; elle se contrôle auprès du
fourneau, dans la solitude et le silence du laboratoire, non ailleurs ; elle se
manifeste sans réclame ni verbiage, par l’étude attentive, l’observation
précise, persévérante, des réactions et des phénomènes. Qui agit autrement
vérifiera, tôt ou tard, la maxime de Salomon (Prov., XXI, 25), disant que « le
désir du paresseux le fera périr, parce que ses mains refusent de travailler ».
Le véritable savant ne recule devant aucun effort ; il ne craint pas la
souffrance, parce qu’il sait quelle est la rançon de la science, et qu’elle
seule lui fournit le moyen « d’entendre les sentences et leur interprétation,
les paroles des sages et leurs discours profonds » (Prov., I, 6).
En ce qui concerne la valeur pratique des attributs affectés
à la Justice, lesquels regardent le travail hermétique, l’étudiant trouvera par
expérience que l’énergie de l’esprit universel a sa signature dans le glaive,
et que le glaive a sa correspondance dans le soleil, comme étant l’animateur et
le modificateur perpétuel de toutes les substances corporelles. C’est lui
l’unique agent des métamorphoses successives de la matière originelle, sujet et
fondement du Magistère. C’est par lui que le mercure se change en soufre, le
soufre en Élixir et l’Élixir en Médecine, recevant alors le nom de Couronne du
sage, parce que cette triple mutation confirme la vérité de l’enseignement
secret et consacre la gloire de son heureux artisan. La possession du soufre
ardent et multiplié, masqué sous le terme de pierre philosophale, est pour l’Adepte
ce qu’est la trirègne pour le pape et la couronne pour le monarque : l’emblème
majeur de la souveraineté et de la sagesse.
Nous avons eu, maintes fois déjà, l’occasion d’expliquer le
sens du livre ouvert, caractérisé par la solution radicale du corps métallique,
lequel, ayant abandonné ses impuretés et cédé son soufre, est alors dit ouvert. Mais ici une remarque s’impose.
Sous le nom de liber et sous l’image
du livre, adoptés pour qualifier la matière détentrice du dissolvant, les sages
ont entendu désigner le livre fermé, symbole général de tous les corps bruts,
minéraux ou métaux, tels que la nature nous les fournit ou que l’industrie
humaine les livre au commerce. Ainsi, les minerais extraits du gîte, les métaux
sortis de la fonte, sont exprimés hermétiquement par un livre fermé ou scellé.
De même, ces corps, soumis au travail alchimique, modifiés par application de
procédés occultes, se traduisent en iconographie à l’aide du livre ouvert. Il
est donc nécessaire, dans la pratique, d’extraire le mercure du livre fermé
qu’est notre primitif sujet, afin de l’obtenir vivant et ouvert, si nous
voulons qu’il puisse à son tour ouvrir le métal et rendre vif le soufre inerte
qu’il renferme. L’ouverture du premier livre prépare celle du second. Car il y
a, cachés sous le même emblème, deux livres fermés (le sujet brut et le métal)
et deux livres ouverts (le mercure et le soufre), bien que ces livres
hiéroglyphiques n’en fassent réellement qu’un seul, puisque le métal provient
de la matière initiale et que le soufre prend son origine du mercure.
Quant à la balance, appliquée contre le livre, il suffirait
de noter qu’elle traduit la nécessité des poids et des proportions pour se
croire dispensé d’en parler davantage. Or, cette image fidèle de l’ustensile
servant aux pesées, et auquel les chimistes assignent une place honorable dans
leurs laboratoires, recèle cependant un arcane de haute importance. C’est la
raison qui nous oblige d’en rendre compte et d’indiquer brièvement ce que la
balance dissimule sous l’aspect anguleux et symétrique de sa forme.
Lorsque les philosophes envisagent les rapports pondéraux
des matières entre elles, ils entendent parler de l’une ou de l’autre partie
d’une double connaissance ésotérique : celle du poids de nature et celle des
poids de l’art. [Jusqu’au moment où l’amant, pour la troisième fois ayant
renouvelé les poids, Atalante accorda la récompense à son vainqueur. (Michaelis Maieri Atalante Fugiens.
Oppenheimii, 1618. Epigramma authoris.)] Malheureusement, les sages, dit
Salomon, cachent la science ; tenus de rester dans les limites étroites de leur
vœu, et respectueux de la discipline acceptée, ils se gardent bien de jamais
établir nettement en quoi diffèrent ces deux secrets. Nous ferons en sorte
d’aller plus loin qu’eux et dirons, en toute sincérité, que les poids de l’art
son applicables exclusivement aux corps distincts, susceptibles d’être pesés,
tandis que le poids de nature se réfère aux proportions relatives des
composants d’un corps donné. De sorte que, décrivant les quantités réciproques
de matières diverses, en vue de leur mélange régulier et convenable, les
auteurs parlent véritablement des poids de l’art ; au contraire, s’il est
question de valeurs quantitatives au sein d’une combinaison synthétique et
radicale, – comme celle du soufre et du mercure principes unis dans le mercure
philosophique, – c’est le poids de nature qui est alors considéré. Et nous
ajouterons, afin d’ôter toute confusion dans l’esprit du lecteur, que si les
poids de l’art sont connus de l’artiste et rigoureusement déterminés par lui,
en revanche le poids de nature est toujours ignoré, même des plus grands
maîtres. C’est là un mystère qui relève de Dieu seul et dont l’intelligence
demeure inaccessible à l’homme.
L’Œuvre débute et s’achève par les poids de l’art ; ainsi
l’alchimiste, préparant la voie, incite la nature à commencer et à parfaire ce
grand labeur. Mais, entre ces extrémités, l’artiste n’a point à se servir de la
balance, le poids de nature intervenant seul. À telle enseigne que la fabrication
du mercure commun, celle du mercure philosophique, les opérations connues sous
le terme d’imbibitions, etc., se font sans qu’il soit possible de savoir, –
même approximativement, – quelles sont les quantités retenues ou décomposées,
quel est le coefficient d’assimilation de la base, de même que la proportion
des esprits. C’est ce que le Cosmopolite laisse entendre lorsqu’il dit que le
mercure ne prend pas plus de soufre qu’il n’en peut absorber et retenir. En
d’autres termes, la proportion de matière assimilable, dépendant directement de
l’énergie métallique propre, reste toujours variable et ne saurait s’évaluer.
Tout l’ouvrage est donc soumis aux qualités, naturelles ou acquises, tant de
l’agent que du sujet initial. Or, en supposant même l’agent obtenu avec un
maximum de vertu, – ce qui est rarement atteint, – la matière basique, telle
que nous l’offre la nature, est fort éloignée d’être constamment égale et
semblable à elle-même. Nous dirons à ce propos, pour en avoir souvent contrôlé
l’effet, que l’assertion des auteurs fondée sur certaines particularités
externes, – taches jaunes, efflorescences, plaques ou points rouges, – ne
mérite guère d’être prise en considération. La région minière pourrait plutôt
fournir quelques indications sur la qualité recherchée, quoique plusieurs
échantillons, prélevés dans la masse du même gîte, révèlent parfois entre eux
de notables différences.
Ainsi s’expliquera-t-on, sans recourir aux influences
abstraites ni aux interventions mystiques, que la pierre philosophale, en dépit
d’un travail régulier, conforme aux nécessités naturelles, ne laisse jamais
entre les mains de l’ouvrier un corps de puissance égale, d’énergie
transmutatoire en rapport direct et constant avec la quantité des matières
mises en œuvre.
IV (Les gardes du corps de François II, duc de Bretagne)
Voici, à notre avis, le chef-d’œuvre de Michel Colombe et la
pièce capitale du tombeau des Carmes. « À elle seule, écrit Léon Palustre,
cette statue de la Force suffirait à la gloire d’un homme, et l’on ne peut se
défendre, en la contemplant, d’une vive et profonde émotion. » [Léon Palustre. Les Sculpteurs français de la Renaissance :
Michel Colombe. Gazette des Beaux-Arts, 2e période, t. XXIX, mai-juin
1884.] La majesté de l’attitude, la noblesse de l’expression, la grâce du
geste, – que l’on souhaiterait plus vigoureux, – sont autant de caractères
révélateurs d’une maîtrise consommée, d’une incomparable habileté de facture.
Le chef couvert d’un morion plat, au mufle de lion en tête,
le buste revêtu du halecret finement ciselé, la Force soutient une tour de la
main gauche et, de la droite, en arrache, – non un serpent comme le portent la
plupart des descriptions, – mais un dragon ailé, qu’elle étrangle en lui
serrant le col. Une ample draperie aux longues franges, dont les replis portent
sur les avant-bras, forme une boucle dans laquelle passe l’une de ses
extrémités. Cette draperie, qui, dans l’esprit du statuaire, devait recouvrir
l’emblématique Vertu, vient confirmer ce que nous avons dit précédemment. De même
que la Justice, la Force apparaît dévoilée (pl. XXXVI).
 |
| Planche XXXVI |
Fille de Jupiter et de Thémis, sœur de la Justice et de la
Tempérance, les anciens l’honoraient comme une divinité, sans toutefois
agrémenter ses images des attributs singuliers que nous lui voyons présenter
aujourd’hui. Dans l’antiquité grecque, les statues d’Hercule, avec la massue du
héros et la peau de lion de Némée, personnifiaient à la fois la force physique
et la force morale. Les Égyptiens, eux, la représentaient par une femme de
complexion puissante, ayant deux cornes de taureau sur la tête et un éléphant à
son côté. Les modernes l’expriment de façons très diverses. Botticelli la voit
comme une femme robuste, simplement assise sur un trône ; Rubens lui adjoint un
écu à figure de lion, ou la fait suivre d’un lion. Gravelot la montre écrasant
des vipères, une peau de lion jetée sur les épaules, le front ceint d’une
branche de laurier et tenant un faisceau de flèches, tandis qu’à ses pieds sont
des couronnes et des sceptres. Anguier, dans un bas-relief du tombeau de Henri
de Longueville (Louvre), se sert, pour définir la Force, d’un lion dévorant un
sanglier. Coysevox (balustrade de la cour de marbre, à Versailles) la revêt
d’une peau de lion et lui fait porter un rameau de chêne d’une main, et la base
d’une colonne de l’autre. Enfin, parmi les bas-reliefs qui décorent le
péristyle de l’église Saint-Sulpice, la Force est figurée armée de l’épée
flamboyante et du bouclier de la Foi.
En toutes ces figures et en quantité d’autres dont
l’énumération serait fastidieuse, on ne trouve point d’analogie, sous le
rapport des attributs, avec celles de Michel Colombe et des sculpteurs de son
temps. La belle statue du tombeau des Carmes prend, de ce fait, une valeur
spéciale et devient pour nous la meilleure traduction du symbolisme ésotérique.
On ne peut raisonnablement nier que la tour, si importante
dans la fortification médiévale, renferme un sens nettement défini, quoique
nous n’ayons pu en découvrir nulle part d’interprétation. Quant au dragon, on
connaît mieux sa double expression ; au point de vue moral et religieux, c’est
la traduction de l’esprit du mal, démon, diable ou Satan ; pour le philosophe
et l’alchimiste, il a toujours servi à représenter la matière première,
volatile et dissolvante, autrement appelée mercure commun. Hermétiquement, on
peut donc considérer la tour comme l’enveloppe, le refuge, l’asile protecteur,
– les minéralogistes diraient la gangue ou la minière, – du dragon mercuriel.
C’est d’ailleurs la signification du mot grec πύργος, tour, asile, refuge.
L’interprétation serait encore plus complète si l’on assimilait à l’artiste la
femme qui extirpe le monstre de son repaire, et son geste mortel au but qu’il
doit se proposer dans cette pénible et dangereuse opération. Ainsi, du moins,
pourrions-nous trouver une explication satisfaisante et pratiquement vraie, du
sujet allégorique servant à révéler le côté ésotérique de la Force. Mais il
nous faudrait supposer connue la science secrète à laquelle se réfèrent ces
attributs. Or, notre statue se charge elle-même de nous renseigner à la fois
sur sa portée symbolique et sur les branches connexes de ce tout qu’est la
sagesse, figurée par l’ensemble des Vertus cardinales. Si l’on avait demandé au
grand initié que fut François Rabelais quelle était son opinion, celui-ci eût
certainement répondu, par la voix d’Epistémon [Le mot grec Ἐπιστήμων signifie
savant, qui est instruit de, habile à ; racine ἐπίσταμαι, savoir, connaître,
examiner, penser.], que tour de fortification ou de chasteau fort c’est autant
dire que tour de force ; et tour de force réclame « couraige, sapience et
puissance : couraige, pource que dangier y a ; sapience, car deuë connoissance
y est nécessairement requise ; puissance, car cil qui oncques ne peult, rien
entreprendre ne doibt. » D’autre part, la cabale phonétique, qui fait du mot
français tour l’équivalent de
l’attique τοὐρος, vient compléter la signification pantagruélique du tour de force.
[L’ouvrage capital de Rabelais, intitulé Pantagruel, est
entièrement consacré à l’exposition burlesque et cabalistique des secrets
alchimiques, dont le pantagruélisme embrasse l’ensemble et constitue la
doctrine scientifique. Pantagruel est formé d’un assemblage de trois mots grecs
: παντᾷ, mis pour πάντῃ, complètement, de manière absolue ; γύη, chemin ; ἕλη,
la lumière solaire. Le héros gigantesque de Rabelais exprime donc la
connaissance parfaite du chemin solaire, c’est-à-dire de la voie universelle.]
En effet, τοὐρος est mis et employé pour τὀ ὄρος ; τὀ
(lequel, ce qui), ὄρος (but, terme, objet que l’on se propose) marquant ainsi
la chose qu’il faut atteindre, ce qui est le but proposé. Rien, on le voit, ne
saurait mieux convenir à l’expression figurée de la pierre des philosophes,
dragon enclos en sa forteresse, dont l’extraction fut toujours tenue pour un
véritable tour de force. L’image, d’ailleurs, est parlante ; car si l’on
éprouve quelque peine à comprendre comment le dragon, robuste et volumineux,
ait pu résister à la compression exercée entre les parois de son étroite prison,
on ne saisit pas davantage par quel miracle il passe tout entier à travers une
simple lézarde de la maçonnerie. Là encore se reconnaît la version du prodige,
du surnaturel et du merveilleux.
Signalons enfin que la Force porte encore d’autres
empreintes de l’ésotérisme qu’elle reflète. Les tresses de sa chevelure,
hiéroglyphes du rayonnement solaire, indiquent que l’Œuvre, soumis à
l’influence de l’astre, ne peut s’exécuter sans la collaboration dynamique du
Soleil. La tresse, nommée en grec σειρά, est adoptée pour figurer l’énergie
vibratoire, parce que, chez les anciens peuples helléniques, le soleil
s’appelait σείρ. Les écailles imbriquées sur la gorgerette du halecret sont
celles du serpent, autre emblème du sujet mercuriel et réplique du dragon, écailleux
lui aussi. Des écailles de poisson, disposées en demi-cercle, décorent
l’abdomen et évoquent la soudure, au corps humain, d’une queue de sirène. Or,
la sirène, monstre fabuleux et symbole hermétique, sert à caractériser l’union
du soufre naissant, qui est notre poisson, et du mercure commun, appelé vierge,
dans le mercure philosophique ou sel de sagesse. Le même sens nous est fourni
par la galette des rois, à laquelle les Grecs donnaient le même nom qu’à la
lune : σελήνη ; ce mot, formé des racines σέλας, éclat, et ἕλη, lumière
solaire, avait été choisi par les initiés pour montrer que le mercure
philosophique tire son éclat du soufre, comme la lune reçoit sa lumière du
soleil. Une raison analogue fit attribuer le nom de σειρήν, sirène, au monstre
mythique résultant de l’assemblage d’une femme et d’un poisson ; σειρήν, terme
contracté de σείρ, soleil, et de μήνη, lune, indique également la matière
mercurielle lunaire combinée à la substance sulfureuse solaire. C’est donc une
traduction identique à celle du gâteau des rois, revêtu du signe de la lumière
et de la spiritualité, – la croix, – témoignage de l’incarnation réelle du
rayon solaire, émané du père universel, dans la matière grave, matrice de
toutes choses, et terra inanis et vacua
de l’Écriture.
V (Les gardes du corps de François II, duc de Bretagne)
« Coiffée en matrone avec le gorgial », – ainsi s’exprime
Dubuisson-Aubenay dans son Itinéraire en
Bretagne, en 1636, – la Tempérance de Michel Colombe est pourvue
d’attributs semblables à ceux qui lui sont assignés par Cochin. Suivant ce
dernier, elle est « habillée de vêtements simples, un mors avec sa bride dans
une main, et, dans l’autre, le pendule d’une horloge ou le balancier d’une
montre ». D’autres figures la présentent tenant un frein ou une coupe. « Assez
souvent, dit Noël, elle paraît appuyée sur un vase renversé, avec un mors dans
sa main, ou mélangeant du vin avec de l’eau.
L’éléphant, qui passe pour l’animal le plus sobre, est son
symbole. Ripa en donne deux emblèmes : l’un, d’une femme avec une tortue sur la
tête, qui tient un frein et de l’argent ; l’autre, d’une femme dans l’action de
tremper, avec des tenailles, un fer rouge dans un vase plein d’eau. »
De la main gauche, notre statue supporte la boîte ouvragée
d’une petite horloge à poids, du modèle usité au XVIe siècle. On sait que les
cadrans de ces appareils ne possédaient qu’une seule aiguille, ainsi qu’en
témoigne cette belle figure de l’époque. L’horloge, qui sert à mesurer le
temps, est prise pour l’hiéroglyphe du temps lui-même et regardée, ainsi que le
sablier, comme l’emblème principal du vieux Saturne (pl. XXXVII).
 |
| Planche XXXVII |
Certains observateurs un peu superficiels ont cru
reconnaître une lanterne dans l’horloge, aisément identifiable pourtant, de la
Tempérance. L’erreur ne modifierait guère la signification profonde du symbole,
car le sens de la lanterne complète celui de l’horloge. En effet, si la
lanterne éclaire parce qu’elle porte la lumière, l’horloge apparaît comme la
dispensatrice de cette lumière, laquelle n’est point reçue d’un jet, mais peu à
peu, progressivement, au cours des ans et avec l’aide du temps. Expérience,
lumière, vérité sont des synonymes philosophiques ; or, rien, sinon l’âge, ne
peut permettre d’acquérir l’expérience, la lumière et la vérité. Aussi, figure-t-on
le Temps, seul maître de la sagesse, sous l’aspect d’un vieillard, et les
philosophes dans l’attitude sénile et lasse d’hommes
ayant longtemps travaillé à l’obtenir. C’est cette nécessité du temps ou de
l’expérience que souligne François Rabelais, dans son Addition au dernier chapitre du cinquième livre de Pantagruel, lorsqu’il écrit : « Quand
donc vos philosophes, Dieu guidant, accompagnant à quelque claire lanterne, se
adonneront à soigneusement rechercher et investiguer, comme est le naturel des
humains (et de ceste qualité sont Herodote et Homere appelés Alphestes,
c’est-à-dire rechercheurs et inventeurs) [En grec, ἀλφηστήρ ou ἀλφηστής,
signifie inventeur, industrieux, de ἀλφή découverte, qui a donné le verbe ἀλφάνω
imaginer, trouver en cherchant.], trouveront vraye estre la response faicte par
le sage Thales à Amasis, roy des Ægyptiens, quand, par luy interrogé en quelle
chose plus estoit de prudence, respondit : On temps ; car par temps ont esté et
par temps seront toutes choses latentes inventées ; et c’est la cause pourquoy
les anciens ont appelé Saturne le Temps, pere de Verité, et Verité fille du
Temps. Infailliblement aussi trouveront tout le sçavoir, et d’eux et de leurs
prédécesseurs, à peine estre la minime partie de ce qui est et ne le sçavent. »
Mais la portée ésotérique de la Tempérance gît tout entière
dans la bride qu’elle tient de la main droite. C’est avec la bride que l’on
dirige le cheval ; par le moyen de cette pièce, le cavalier impose à sa monture
l’orientation qui lui plaît. On peut aussi considérer la bride comme
l’instrument indispensable, le médiateur placé entre la volonté du cavalier et
la marche du cheval vers l’objectif proposé. Ce moyen, dont on a choisi l’image
parmi les parties constituantes du harnais, est désigné en hermétisme par le
nom de cabale. De sorte que les expressions spéciales de la bride, celle de
frein et celle de direction, permettent d’identifier et de reconnaître, sous
une seule forme symbolique, la Tempérance et la Science cabalistique.
À propos de cette science, une remarque s’impose, et nous la
croyons d’autant plus fondée que l’étudiant non prévenu assimile volontiers la
cabale hermétique au système d’interprétation allégorique que les Juifs
prétendent avoir reçu par tradition, et qu’ils dénomment Kabbale. En fait, il
n’y a rien de commun entre les deux termes, sinon leur prononciation. La
kabbale hébraïque ne s’occupe que de la Bible ; elle est donc strictement
limitée à l’exégèse et à l’herméneutique sacrées. La cabale hermétique
s’applique aux livres, textes et documents des sciences ésotériques de
l’antiquité, du moyen âge et des temps modernes. Tandis que la kabbale
hébraïque n’est qu’un procédé basé sur la décomposition et l’explication de
chaque mot ou de chaque lettre, la cabale hermétique, au contraire, est une
véritable langue. Et, comme la grande majorité des traités didactiques de
sciences anciennes sont rédigés en cabale, ou qu’ils utilisent cette langue
dans leurs passages essentiels ; que le grand Art lui-même, selon le propre
aveu d’Artephius, est entièrement cabalistique, le lecteur n’en peut rien
saisir s’il ne possède au moins les premiers éléments de l’idiome secret. Dans
la kabbale hébraïque, trois sens peuvent être découverts en chaque mot sacré ;
d’où trois interprétations ou kabbales différentes. La première, dite Gématria,
comporte l’analyse de la valeur numérale ou arithmétique des lettres composant
le mot ; la seconde, nommée Notarikon, établit la signification de chaque
lettre considérée séparément ; la troisième, ou Thémurah (c’est-à-dire
changement, permutation), emploie certaines transpositions de lettres. Ce
dernier système, qui paraît avoir été le plus ancien, date de l’époque où
florissait l’école d’Alexandrie, et fut créé par quelques philosophes juifs
soucieux d’accommoder les spéculations des philosophies grecque et orientale
avec le texte des livres saints. Nous ne serions pas autrement surpris que la
paternité de cette méthode pût revenir au juif Philon, dont la réputation fut
grande au commencement de notre ère, parce que c’est lui le premier philosophe
cité comme ayant tenté d’identifier une religion véritable avec la philosophie.
On sait qu’il essaya de concilier les écrits de Platon et les textes hébreux,
en interprétant ceux-ci allégoriquement, ce qui concorde parfaitement avec le
but poursuivi par la kabbale hébraïque. Quoi qu’il en soit, d’après les travaux
d’auteurs fort sérieux, on ne saurait assigner au système juif une date très
antérieure à l’ère chrétienne, en reculant même le point de départ de cette interprétation
jusqu’à la version grecque des Septante (238 av. J.C.). Or, la cabale
hermétique était employée, longtemps avant cette époque, par les pythagoriciens
et les disciples de Thalès de Milet (640-560), fondateur de l’école ionienne :
Anaximandre, Phérécyde de Syros, Anaximène de Milet, Héraclite d’Éphèse,
Anaxagore de Clazomène, etc., en un mot, par tous les philosophes et les
savants grecs, ainsi qu’en témoigne le papyrus de Leyde.
Ce que l’on ignore généralement aussi, c’est que la cabale
contient et conserve l’essentiel de la langue maternelle des Pélasges, langue
déformée, mais non détruite, dans le grec primitif ; langue mère des idiomes
occidentaux, et particulièrement du français, dont l’origine pélasgique s’avère
de manière incontestable ; langue admirable, qu’il suffit de connaître quelque
peu pour aisément retrouver, dans les divers dialectes européens, le sens réel
dévié, par le temps et les migrations des peuples, du langage originel.
À l’inverse de la kabbale juive, créée de toute pièce afin
de voiler, sans aucun doute, ce que le texte sacré avait de trop clair, la
cabale hermétique est une précieuse clef, permettant à qui la possède d’ouvrir
les portes des sanctuaires, de ces livres fermés que sont les ouvrages de
science traditionnelle, d’en extraire l’esprit, d’en saisir la signification
secrète. Connue de Jésus et de ses Apôtres (elle devait malencontreusement
provoquer le premier reniement de saint Pierre), la cabale était employée au
moyen âge par les philosophes, les savants, les littérateurs, les diplomates.
Chevaliers d’ordre et chevaliers errants, troubadours, trouvères et ménestrels,
étudiants-touristes de la fameuse école de magie de Salamanque, que nous
appelons Vénusbergs parce qu’ils disaient venir de la montagne de Vénus, discutaient
entre eux dans la langue des dieux, dite encore gaye-science ou gay-scavoir,
notre cabale hermétique. [Ces étudiants voyageurs portaient autour du cou, en
signe de reconnaissance et d’affiliation, un filet jaune, de laine ou de soie
tricotée, ainsi qu’en font foi le Liber
Vagaborum, paru vers 1510, attribué à Thomas Murner ou à Sébastien Brant,
et le Schimpf und Ernst, daté de
1519.] Elle porte, d’ailleurs, le nom et l’esprit de la Chevalerie, dont les
ouvrages mystiques de Dante nous ont révélé le véritable caractère. Le latin caballus et le grec καβάλλης signifient
tous deux cheval de somme ; or, notre
cabale soutient réellement le poids considérable, la somme des connaissances
antiques et de la chevalerie ou cabalerie médiévale, lourd bagage de vérités
ésotériques transmis par elle à travers les âges. C’était la langue secrète des
cabaliers, cavaliers ou chevaliers. Initiés et intellectuels de l’antiquité en
avaient tous la connaissance. Les uns et les autres, afin d’accéder à la
plénitude du savoir, enfourchaient métaphoriquement la cavale, véhicule
spirituel dont l’image type est le Pégase ailé des poètes helléniques. Lui seul
facilitait aux élus l’accès des régions inconnues ; il leur offrait la
possibilité de tout voir et de tout comprendre, à travers l’espace et le temps,
l’éther et la lumière… Pégase, en grec Πήγασος, tire son nom du mot πηγή,
source, parce qu’il fit, dit-on, jaillir d’un coup de pied la fontaine
Hippocrène ; mais la vérité est d’un autre ordre. C’est parce que la cabale
fournit la cause, donne le principe, révèle la source des sciences, que son
hiéroglyphe animal a reçu le nom spécial et caractéristique qu’il porte.
Connaître la cabale, c’est parler la langue de Pégase, la langue du cheval,
dont Swift indique expressément, dans l’un de ses Voyages allégoriques, la
valeur effective et la puissance ésotérique.
Langue mystérieuse des philosophes et disciples d’Hermès, la
cabale domine toute la didactique de l’Ars
magna, comme le symbolisme en embrasse toute l’iconographie. Art et littérature
offrent ainsi à la science cachée l’appoint de leurs propres ressources et de
leurs facultés d’expression. En fait, et malgré leur caractère particulier,
leur technique distincte, la cabale et le symbolisme empruntent des voies
différentes pour arriver au même but et pour se confondre dans le même
enseignement. Ce sont les deux colonnes maîtresses, dressées sur les pierres
d’angle des fondations philosophiques, qui supportent le fronton alchimique du
temple de la sagesse.
Tous les idiomes peuvent donner asile au sens traditionnel
des mots cabalistiques, parce que la cabale, dépourvue de texture et de
syntaxe, s’adapte facilement à n’importe quel langage, sans en altérer le génie
spécial. Elle apporte aux dialectes constitués la substance de sa pensée, avec
la signification originelle des noms et des qualités. De sorte qu’une langue
quelconque reste toujours susceptible de la véhiculer, de l’incorporer et,
conséquemment, de devenir cabalistique par la double acceptation qu’elle prend
de ce chef.
En dehors de son rôle alchimique pur, la cabale a servi de
truchement dans l’élaboration de plusieurs chefs-d’œuvre littéraires, que
beaucoup de dilettantes savent apprécier, sans toutefois soupçonner quels
trésors ils dissimulent sous l’agrément, le charme ou la noblesse du style.
C’est que les auteurs, – qu’ils aient nom Homère, Virgile, Ovide, Platon, Dante
ou Gœthe, – furent tous de grands initiés. Ils écrivirent leurs immortels
ouvrages non pas tant pour laisser à la postérité d’impérissables monuments du
génie humain, que pour l’instruire des sublimes connaissances dont ils étaient
les dépositaires et qu’ils se devaient de transmettre dans leur intégrité.
C’est ainsi que nous devons juger, en dehors des maîtres déjà cités, les
artisans merveilleux des poèmes de chevalerie, chansons de geste, etc.,
appartenant au cycle de la Table ronde et
du Graal ; les œuvres de François Rabelais et celles de Cyrano Bergerac ;
le Don Quichotte de Michel
Cervantès ; les Voyages de Gulliver,
de Swift ; le Songe de Poliphile, de
Francisco Colonna ; les Contes de ma mère
l’Oie, de Perrault ; les Chansons du
Roy de Navarre, de Thibault de Champagne ; le Diable prédicateur, curieux ouvrage espagnol dont nous ne
connaissons point l’auteur, et quantité d’autres œuvres qui, pour être moins
célèbres, ne leur sont inférieures ni en intérêt ni en science.
Nous bornerons là cet exposé de la cabale solaire, n’ayant
pas reçu licence d’en faire un traité complet ni d’enseigner quelles en sont
les règles. Il nous suffit d’avoir signalé la place importante occupée par elle
dans l’étude des « secrets de nature » et la nécessité pour le débutant d’en
retrouver la clef. Mais, afin de lui être utile dans la mesure du possible,
nous donnerons, à titre d’exemple, la version en langage clair d’un texte
cabalistique original de Naxagoras. Souhaitons que le fils de science y
découvre la manière d’interpréter les livres scellés, et sache tirer parti d’un
enseignement aussi peu voilé. Dans son allégorie, l’Adepte s’est efforcé de
décrire la voie ancienne et simple, la seule que suivaient, autrefois, les
vieux maîtres alchimistes.
Cet opuscule se trouve inséré à la fin du traité de
Naxagoras, intitulé Alchymia denudata.
Nous en avons fait la version d’après une traduction française manuscrite
exécutée sur l’ouvrage original écrit en langue allemande.
du texte original allemand
bien détaillée du Sable d’Or qu’on trouve auprès de Zwickau, en
Misnie aux environs de Niederhihendorff, et d’autres lieux voisins,
|
bien détaillée de la manière d’extraire, de libérer l’Esprit de l’Or,
enclos dans la matière minérale vile, à dessein d’en édifier le Temple sacré
de la Lumière [C’est ainsi que l’on nomme la pierre philosophale, notre
microcosme, par rapport au temple de Jérusalem, figure de l’univers ou
macrocosme.] et de découvrir d’autres secrets analogues,
|
Il y aura bientôt deux ans qu’un homme de ces mines eut,
d’une tierce personne, un petit extrait d’un manuscrit in-quarto, épais d’un
pouce, et qui venoit d’ailleurs de deux autres voyageurs italiens qui s’y
nommoient ainsy.
|
Il y aura bientôt deux ans qu’un ouvrier, habile dans
l’art métallique, obtint, par un troisième agent [le feu secret], un extrait
des quatre éléments, manuellement obtenu en assemblant deux mercures de même
origine, que leur excellence a fait qualifier de romains, et qui se sont
toujours nommés ainsi.
|
Il y avoit déjà longtemps que cet extrait avoit été bien
examiné par M. N. N., parce que le dernier comptoit faire beaucoup par la
baguette divinatoire. Enfin, il parvint à toucher des mains ce qu’il
cherchoit. Voicy l’extrait de ce manuscrit.
|
Par cet extrait, connu de l’antiquité et bien étudié des
Modernes, on peut réaliser de grandes choses, pourvu que l’on ait reçu
l’illumination de l’Esprit-Saint. C’est alors qu’on parvient à toucher des
mains ce que l’on cherche. Voici la technique manuelle de cet extrait.
|
I. Un bourg, nommé Hartsmanngrünn, près de Zwickau. Sous
le bourg, il y a beaucoup de bons grains. La mine y est en veines.
|
I. Une scorie surnage l’assemblage formé par le feu, des
parties pures de la Matière minérale vile. Sous la scorie, on trouve une eau
friable granuleuse. C’est la veine ou la matrice métallique.
|
II. Kohl-Stein, proche de Zwickau. Il y a une bonne veine
de graviers et de marcassites de plomb. Derrière, à Gabel, il y a un forgeron
appelé Morgen-Stern, qui sçait où il y a une bonne mine, et un conduit
souterrain, où il y a des crevasses que l’on y a faites. Il y a dedans des
congellations jaunes et le métal est malléable.
|
II. Telle est la Pierre Kohl [Dite encore Alcohol, Eau de
vie des sages : c’est la pierre de feu de Basile Valentin.], concrétion des
parties pures du fumier ou Matière minérale vile. Veine friable et
granuleuse, elle naît du fer, de l’étain et du plomb. Elle seule porte
l’empreinte du Rayon solaire. C’est elle l’artisan expert dans l’art de
travailler l’acier. Les sages l’appellent Etoile du Matin. Elle sait ce que
cherche l’artiste. C’est le chemin souterrain qui mène à l’or jaune,
malléable et pur. Chemin rude et coupé de crevasses, d’obstacles.
|
III. En allant de Schneeberg au château nommé Wissembourg,
il y a un peu d’eau qui en coule, vers la montagne ; elle tombe dans le
Mulde, vis-à-vis de cette eau, on trouve un vivier près de la rivière, et
au-delà de ce vivier, il y a un peu d’eau où l’on trouve une marcassite qui
peut bien dédommager de la peine qu’on aura prise d’y aller.
|
III. Ayant cette pierre, dite Montagne de la Tenaille [À
cause de sa signature. Tenaille, en grec, se dit λαβίς, de λαμβάνω, prendre,
obtenir, recueillir, et aussi concevoir, devenir grosse.], montez vers la
Forteresse blanche. C’est l’eau vive, qui tombe du corps désagrégé, en poudre
impalpable, sous l’effet d’une trituration naturelle comparable à celle de la
Meule. Cette eau vive et blanche s’agglomère au centre, en une pierre
cristalline, de couleur semblable au fer étamé, et qui peut grandement
dédommager de la peine qu’exige l’opération.
|
IV. A Kauner-Zehl, sur la montagne de Gott, à deux lieues
de Schoneck, il y a un excellent sable de cuivre.
|
IV. Ce sel lumineux et cristallin, premier être du Corps
divin, se formera, dans un second lieu, en verre cuivré. C’est notre cuivre
ou laiton, et le lion vert.
|
V. A Grals, dans Voigtland, au-dessous de Schlossberg, il
y a un jardin où se trouve une riche mine d’or, ainsy que j’en ay averti
depuis peu. Remarqués bien.
|
V. Ce sable, calciné, donnera sa teinture au rameau d’or.
La jeune pousse du soleil naîtra dans la Terre de feu. C’est la substance
brûlée de la pierre, roche fermée du jardin [Le Jardin des Hespérides] où
mûrissent nos fruits d’or, ainsi que je m’en suis assuré depuis peu.
Remarquez bien ceci.
|
VI. Entre Werda et Laugenberndorff, il y a un vivier que
l’on appelle Mansteich. Au-dessous de ce vivier se voit une ancienne
fontaine, au bas de la prairie. Dans cette fontaine, l’on trouve des grains
d’or qui sont très bons.
|
VI. Entre ce produit et le second, plus fort et meilleur,
il est utile de retourner à l’Etang de la Lumière morte [Seconde
putréfaction, caractérisée par la coloration violette, indigo ou noire.], par
l’extrait remis dans sa matière originelle. Vous retrouverez l’eau vive,
dilatée, sans consistance. Ce qui en proviendra est l’antique Fontaine [La
Fontaine de Jouvence, d’abord Médecine universelle puis Poudre de
projection.], génératrice de vigueur, capable de changer en grains d’or les
métaux vils.
|
VII. Dans le bois de Werda, il y a un fossé, qu’on appelle
le Langgrab. En allant au haut de ce fossé, l’on trouve, dans le fossé même,
une fosse. Avancés dans cette fosse la longueur d’une aulne vers la montagne,
vous trouverés une veine d’or de la longueur d’un empan.
|
VII. Dans la Forêt verte se cache le fort, le robuste et
le meilleur de tous [Cf. Cosmopolite. Le roi de l’art se trouve caché « dans
la forêt verte de la nymphe Vénus ».]. Là aussi se trouve l’Etang de
l’Ecrevisse [Constellation du Zodiaque des philosophes, signe de
l’augmentation du feu.]. Poursuivez : la substance se séparera d’elle-même.
Laissez le fossé : sa source est au fond d’une grotte où se développe la
pierre incluse dans sa minière.
|
VIII. A Hundes-Hubel se trouve une fosse où il y a des
grains d’or en masse. Cette fosse est dans le bourg, près d’une fontaine où
le peuple va chercher de l’eau pour boire.
|
VIII. Dans l’augmentation, en réitérant, vous verrez la
source remplie de granulations brillantes et d ‘or pur. Elle est en scorie ou
gangue enfermant la Fontaine d’eau sèche, génératrice d’or, que le peuple
métallique boit avidement.
|
IX. Après avoir fait différents voyages à Zwickau, à la
petite ville de Schlott, à Saume, à Crouzoll, nous nous arrêtâmes à
Brethmullen, où ce lieu étoit autrefois situé. Au chemin qui conduisoit
autrefois à Weinburg, qu’on appelle Barenstein, vis-à-vis ou vers la
montagne, en allant à Barenstein, par derrière, vis-à-vis le couchant, à la fibula,…
qui y étoit autrefois, il y a un vieux puits dans lequel il y a une veine qui
le traverse. Elle est forte et bien riche en bon or de Hongrie et quelquefois
même en or d’Arabie. La marque de la veine est sur quatre de sépareurs de
métaux Auff-seigers vier, et il est écrit auprès Auff-seigers eins. C’est une
vraye teste de veine.
|
IX. Après différents essais sur la matière vile, jusqu’à
la couleur jaune, ou fixation du corps, puis de là au Soleil couronné, il
nous fallut attendre que la matière se fût entièrement cuite dans l’eau,
selon la méthode de jadis. Cette longue coction, suivie autrefois, conduisait
au Château lumineux ou Forteresse brillante, qui est cette pierre lourde,
occident qu’atteint, sans le dépasser, notre manière propre,… [symbole graphique
du Vitriol philosophique. Les points de suspension figurent dans l’original.]
car la vérité sort du puits antique de cette teinture puissante, riche en
semence d’or, aussi pur que l’or de Hongrie et quelque fois même que l’or
d’Arabie. Le signe, formé de quatre rayons, désigne et scelle le réducteur
minéral. C’est la plus grande de toutes les teintures.
|
Mais afin de clore, sur une note moins austère, cette étude
du langage secret désigné sous le nom de cabale hermétique ou solaire, nous
montrerons jusqu’où peut aller la crédulité historique, lorsqu’une ignorance
aveugle permet d’attribuer à certains personnages ce qui n’a jamais appartenu
qu’à l’allégorie et à la légende. Les faits historiques que nous offrons à la
méditation du lecteur sont ceux d’un monarque de l’antiquité romaine. Nous
n’aurons guère besoin d’en relever les particularités saugrenues, ni d’en
souligner toutes les relations cabalistiques, tant celles-ci s’avèrent
évidentes et expressives.
Le fameux empereur romain Varius Avitus Bassianus, salué par
les soldats, – on ne sait trop pourquoi, – sous les noms de Marcus Aurelius
Antoninus [Cabalistiquement, l’assemblage de la matière première, de l’or
olympique ou divin, et du mercure. Ce dernier, dans les récits allégoriques,
porte toujours le nom d’Antoine, Antonin, Antolin, etc., avec l’épithète de
pèlerin, messager ou voyageur.], fut surnommé, – on ne le sait pas davantage, –
Élagable ou Héliogabale [Le Cheval du Soleil, celui qui porte la science, la
Cabale solaire.]. « Né en 204, nous dit l’Encyclopédie, mort à Rome en 222, il
descendait d’une famille syrienne [Συρία ou σισύρα, peau grossière revêtue de
son poil : la future toison d’or.], vouée au culte du Soleil, à Émèse [Ἔμεσις,
vomissement : c’est la scorie du texte précédent.]. Lui-même fut, tout jeune,
grand-prêtre de ce dieu, qui était adoré sous la forme d’une pierre noire [La
pierre des philosophes, matière première, sujet de l’art tiré du chaos
originel, de couleur noire, mais primum
ens, formé par la nature, de la pierre philosophale.] et sous le nom
d’Élagabale. On le prétendait fils de Caracalla. Sa mère, Sæmias…
[Quelques historiens la nomment Semiamira, – à demi
merveilleuse. À la fois vile et précieuse, abjecte et recherchée, c’est la
prostituée de l’Œuvre. La sagesse lui fait dire d’elle-même Nigra sum sed
formosa, je suis noire, mais je suis belle.]
…fréquentait la cour et était au-dessous de la calomnie.
Quoiqu’il en soit, la beauté du jeune grand-prêtre séduisit la légion d’Émèse,
qui le proclama Auguste à l’âge de quatorze ans. L’empereur Macrin marcha
contre lui, mais fut battu et tué.
« Le règne d’Héliogabale ne fut que le triomphe des
superstitions et des débauches orientales. Il n’est infamie ou cruauté que
n’ait inventées ce singulier empereur aux joues fardées, à la robe traînante.
Il avait amené à Rome sa pierre noire, et forçait le Sénat et tout le peuple à
lui rendre un culte public. Ayant enlevé à Carthage la statue de Cælestis, qui
représentait la Lune, il en célébra en grande pompe les noces avec sa pierre
noire, qui figurait le Soleil. Il créa un sénat de femmes, épousa
successivement quatre femmes, dont une vestale, et rassembla un jour dans son
palais toutes les prostituées de Rome, auxquelles il adressa un discours sur
les devoirs de leur état. Les prétoriens massacrèrent Héliogabale et jetèrent
son corps au Tibre. Il avait dix-huit ans et en avait régné quatre. »
Si ce n’est là de l’Histoire, c’est du moins une belle
histoire, toute pleine de « pantagruélisme ». Sans faillir à sa mission
ésotérique, elle eût certainement, sous la plume alerte, le style chaud et
coloré de Rabelais, énormément gagné en saveur, en pittoresque et en
truculence.
VI (Les gardes du corps de François II, duc de Bretagne)
Avant d’être élevée à la dignité de Vertu cardinale, la
Prudence fut longtemps une divinité allégorique à laquelle les anciens
donnaient une tête à deux visages, – formule que notre statue reproduit
exactement et de la façon la plus heureuse. Sa face antérieure offre la
physionomie d’une jeune femme au galbe très pur, et sa face postérieure celle
d’un vieillard dont le facies, plein de noblesse et de gravité, se prolonge
dans les ondes soyeuses d’une barbe de fleuve. Réplique de Janus, fils d’Apollon
et de la nymphe Créuse, cette admirable figure ne le cède aux trois autres ni
en majesté, ni en intérêt.
Debout, elle est représentée les épaules couvertes de
l’ample manteau du philosophe, qui s’ouvre largement sur le corsage au chevron
gaufré. Un simple fichu lui protège la nuque ; formé en coiffe autour du visage
sénile, il vient se nouer sur le devant, dégageant ainsi le cou agrémenté d’un
collier de perles. La jupe, aux plis larges, est maintenue par une cordelière à
gland, d’aspect lourd, mais de caractère monacal. Sa main gauche embrasse le
pied d’un miroir convexe, dans lequel elle semble éprouver quelque plaisir à
voir son image, tandis que la main droite tient écartées les branches d’un
compas à pointes sèches. Un serpent, dont le corps apparaît ramassé sur
lui-même, expire à ses pieds (pl. XXXVIII).
 |
| Planche XXXVIII |
Cette noble figure est pour nous une émouvante et suggestive
personnification de la Nature, simple, féconde, multiple et variée sous les
dehors harmonieux, l’élégance et la perfection des formes dont elle pare
jusqu’à ses plus humbles productions. Son miroir, qui est celui de la Vérité,
fut toujours considéré par les auteurs classiques comme l’hiéroglyphe de la
matière universelle, et particulièrement reconnu entre eux pour le signe de la
substance propre du Grand-Œuvre. Sujet des sages, Miroir de l’Art sont des
synonymes hermétiques qui dérobent au vulgaire le nom véritable du minéral
secret. C’est dans ce miroir, disent les maîtres, que l’homme voit la nature à
découvert. C’est grâce à lui qu’il peut connaître l’antique vérité en son
réalisme traditionnel. Car la nature ne se montre jamais d’elle-même au
chercheur, mais seulement par l’intermédiaire de ce miroir qui en garde l’image
réfléchie. Et pour montrer expressément que c’est bien là notre microcosme et
le petit monde de sapience, le sculpteur a façonné le miroir en lentille plan
convexe, laquelle possède la propriété de réduire les formes en conservant
leurs proportions respectives. L’indication du sujet hermétique, contenant en
son minuscule volume tout ce que renferme l’immense univers, apparaît donc
voulue, préméditée, imposée par une nécessité ésotérique impérieuse, et dont
l’interprétation n’est pas douteuse. De sorte qu’en étudiant avec patience
cette unique et primitive substance, parcelle chaotique et reflet du grand
monde, l’artiste peut acquérir les notions élémentaires d’une science inconnue,
pénétrer dans un domaine inexploré, fertile en découvertes, abondant en
révélations, prodigue de merveilles, et recevoir enfin l’inestimable don que
Dieu réserve aux âmes d’élite : la lumière de sagesse.
Ainsi apparaît, sous le voile extérieur de la Prudence,
l’image mystérieuse de la vieille alchimie, et sommes-nous, par les attributs
de la première, initiés aux secrets de la seconde. D’ailleurs, le symbolisme
pratique de notre science tient dans l’exposé d’une formule comportant deux
termes, deux vertus essentiellement philosophiques : la prudence et la
simplicité. Prudentia et Simplicitas,
telle est la devise favorite des maîtres Basile Valentin et Senior Zadith. L’un
des bois du traité de l’Azoth représente, en effet, aux pieds d’Atlas,
supportant la sphère cosmique, un buste de Janus, – Prudentia, – et un jeune enfant épelant l’alphabet, – Simplicitas. Mais, tandis que la
simplicité appartient surtout à la nature, comme le premier et le plus
important de ses apanages, l’homme, au contraire, semble doué des qualités
groupées sous la dénomination globale de prudence : prévoyance, circonspection,
intelligence, sagacité, expérience, etc. Et quoique toutes réclament, pour
atteindre leur perfection, le secours et l’appui du temps, les unes étant
innées, les autres acquises, il serait possible de fournir dans ce sens une
raison vraisemblable du double masque de la Prudence.
La vérité, moins abstraite, semble liée davantage au
positivisme alchimique des attributs de notre Vertu cardinale. Il est
généralement recommandé d’unir « un vieillard sain et vigoureux avec une jeune
et belle vierge ». Dans ces noces chimiques, un enfant métallique doit naître
et recevoir l’épithète d’androgyne, parce qu’il tient à la fois de la nature du
soufre, son père, et de celle du mercure, sa mère. Mais en ce lieu gît un
secret que nous n’avons point découvert chez les meilleurs et les plus sincères
auteurs. L’opération, ainsi présentée, paraît simple et fort naturelle. Nous
nous sommes pourtant trouvé arrêté pendant plusieurs années par l’impossibilité
d’en rien obtenir. C’est que les philosophes ont habilement soudé deux ouvrages
successifs en un seul, avec d’autant plus d’aisance qu’il s’agit d’opérations
semblables, conduisant à des résultats parallèles. Quand les sages parlent de
leur androgyne, ils entendent désigner sous ce vocable le composé
artificiellement formé de soufre et de mercure, mis en étroit contact, ou, suivant
l’expression chimique consacrée, simplement combinés. Cela indique donc la
possession préalable d’un soufre et d’un mercure précédemment isolés ou
extraits, et non d’un corps généré directement par la nature, à l’issue de la
conjonction du vieillard et de la jeune vierge. En alchimie pratique, ce que
l’on sait le moins c’est le commencement. Aussi, est-ce la raison pour laquelle
nous saisissons toutes les occasions qui nous sont offertes de parler du début,
préférablement à la fin de l’Œuvre. Nous suivons en cela le conseil autorisé de
Basile Valentin, lorsqu’il dit que « celui qui a la matière trouvera toujours
un pot pour la cuire, et qui a de la farine ne doit guère se soucier de pouvoir
faire du pain ». Or, la logique élémentaire nous conduit à rechercher des
géniteurs du soufre et du mercure, si nous désirons obtenir, par leur union,
l’androgyne philosophique, autrement appelé Rebis, Compositum de compositis,
Mercure animé, etc., propre matière de l’Élixir. De ces parents chimiques du
soufre et du mercure principes, l’un reste toujours le même, et c’est la vierge
mère ; quant au vieillard, il doit, son rôle achevé, céder la place à plus
jeune que lui. Ainsi, ces deux conjonctions engendreront chacune un rejeton de
sexe différent : le soufre, de complexion sèche et ignée, et le mercure, de
tempérament « lymphatique et mélancolique ». C’est ce que veulent enseigner
Philalèthe et d’Espagnet en disant que « notre vierge peut être mariée deux
fois sans rien perdre de sa virginité ». D’autres s’expriment de manière plus
obscure, et se contentent d’assurer que « le soleil et la lune du ciel ne sont
pas les astres des philosophes ». On doit comprendre par là que l’artiste ne
trouvera jamais les parents de la pierre, directement préparés dans la nature,
et qu’il devra former d’abord le soleil et la lune hermétiques, s’il ne veut
être frustré du fruit précieux de leur alliance. Nous croyons en avoir assez
dit sur ce sujet. Peu de paroles suffisent au sage, et ceux qui ont longtemps
travaillé sauront profiter de nos avis. Nous écrivons pour tous, mais tous
peuvent ne pas être appelés à nous entendre, parce qu’il nous est refusé de
parler plus ouvertement.
Replié sur lui-même, la tête renversée dans les spasmes de
l’agonie, le serpent, que nous voyons figurer au pied de notre statue, passe
pour être l’un des attributs de la Prudence ; il est, dit-on, de naturel fort
circonspect. Nous ne le contestons pas ; mais on conviendra que ce reptile,
représenté mourant, doit l’être pour la nécessité du symbolisme, car son inertie
ne lui permet point d’exercer une telle faculté. Il est donc raisonnable de
penser que l’emblème comporte un autre sens, très distinct de celui qu’on lui
affecte. En hermétisme, sa signification est analogue à celle du dragon, que
les sages ont adopté comme l’un des représentants du mercure. Rappelons le
serpent crucifié de Flamel, celui de Notre-Dame de Paris, ceux du caducée, des
crucifix de méditation (qui sortent d’un crâne humain servant de base à la
croix divine), le serpent d’Esculape, l’Ouroboros grec, – serpens qui caudam devoravit, – chargé de traduire le circuit fermé
du petit univers qu’est l’Œuvre, etc. Or, tous ces reptiles sont morts ou
moribonds, depuis l’Ouroboros qui se dévore lui-même, jusqu’à ceux du caducée,
tués d’un coup de baguette, en passant par le tentateur d’Ève, auquel la
postérité de la femme écrasera la tête (Genèse, III, 15). Tous expriment la
même idée, renferment la même doctrine, obéissent à la même tradition. Et le
serpent, hiéroglyphe du principe alchimique primordial, peut justifier
l’assertion des sages, lesquels assurent que tout ce qu’ils cherchent se trouve
contenu dans le mercure. C’est lui, véritablement, le moteur, l’animateur du
grand ouvrage, car il le commence, l’entretient, le perfectionne et l’achève.
C’est lui le cercle mystique dont le soufre, embryon du mercure, marque le
point central autour duquel il accomplit sa rotation, traçant ainsi le signe
graphique du soleil, père de la lumière, de l’esprit et de l’or, dispensateur
de tous les biens terrestres.
Mais, tandis que le dragon figure le mercure écailleux et
volatil, produit de la purification superficielle du sujet, le serpent,
dépourvu d’ailes, demeure l’hiéroglyphe du mercure commun, pur et mondé,
extrait du corps de la Magnésie ou matière première. C’est la raison pour
laquelle certaines statues allégoriques de la Prudence ont pour attribut le
serpent fixé sur un miroir. Et ce miroir, signature du minéral brut fourni par
la nature, devient lumineux en réfléchissant la lumière, c’est-à-dire en
manifestant sa vitalité dans le serpent, ou mercure, qu’il tenait caché sous
son enveloppe grossière. Ainsi, grâce à ce primitif agent vivant et vivifiant,
il devient possible de rendre la vie au soufre des métaux morts. En exécutant
l’opération, le mercure, dissolvant le métal, s’empare du soufre, l’anime et
meurt en lui cédant sa vitalité propre. C’est ce que les maîtres veulent
enseigner lorsqu’ils ordonnent de tuer le vif pour ressusciter le mort, de
corporifier les esprits et de réanimer les corporifications. Possédant ce
soufre vivant et actif, qualifié de philosophique, afin de marquer sa
régénération, il suffira de l’unir, en proportion convenable, au même mercure
vivant, pour obtenir, par l’interpénétration de ces principes vivants, le
mercure philosophique ou animé, matière de la pierre philosophale. Si l’on a
bien compris ce que nous nous sommes efforcés de traduire plus haut, et que
l’on en rapproche ce qui est dit ici, les deux premières portes de l’Œuvre
seront facilement ouvertes.
En résumé, celui qui possède une connaissance assez étendue
de la pratique remarquera que le secret principal de l’ouvrage réside dans
l’artifice de la dissolution. Et comme il est nécessaire d’exécuter plusieurs
de ces opérations, – différentes quant à leur but, semblables quant à leur
technique, – il existe autant de secrets secondaires, lesquels, à proprement
parler, n’en forment réellement qu’un seul. Tout l’art se réduit donc à la
dissolution, tout dépend d’elle et de la manière de l’effectuer. C’est là le secretum secretorum, la clef du
Magistère cachée sous l’axiome énigmatique solve
et coagula : dissous (le corps) et coagule (l’esprit). Et cela se fait en
une seule opération comprenant deux dissolutions, l’une violente, dangereuse,
inconnue, l’autre aisée, commode, d’un usage courant au laboratoire.
Ayant décrit ailleurs la première de ces dissolutions et
donné, en style allégorique peu voilé, les détails indispensables, nous n’y
reviendrons pas.
[Afin d’illustrer ces indications précieuses du Maître, nous
ajoutons, au second tome des
Demeures
philosophales, la belle et si parlante composition du
Tres Precieux Don de Dieu, « escript par Georges Aurach et peinct
de sa propre main, l’an du Salut de l’Humanité rachetée, 1415 » (pl. XXXIX).]
 |
| Planche XXXIX |
Mais afin d’en préciser le caractère, nous attirerons
l’attention du laborieux sur ce qui la distingue des opérations chimiques
comprises sous le même vocable. Cette indication pourra ne pas être inutile.
Nous avons dit, et le répétons, que l’objet de la
dissolution philosophique est l’obtention du soufre qui, dans le Magistère,
joue le rôle de formateur en coagulant le mercure qui lui est adjoint,
propriété qu’il tient de sa nature ardente, ignée et desséchante. « Toute chose
sèche boit avidement son humide », dit un vieil axiome alchimique. Mais ce
soufre, lors de sa première extraction, n’est jamais dépouillé du mercure
métallique avec lequel il constitue le noyau central du métal, appelé essence
ou semence. D’où il résulte que le soufre, conservant les qualités spécifiques
du corps dissous, n’est en réalité que la portion la plus pure et la plus
subtile de ce corps même. En conséquence, nous sommes en droit de considérer,
avec la pluralité des maîtres, que la dissolution philosophique réalise la
purification absolue des métaux imparfaits. Or, il n’est pas d’exemple,
spagyrique ou chimique, d’une opération susceptible de donner un tel résultat.
Toutes les purifications de métaux traités par les méthodes modernes ne servent
qu’à les débarrasser des impuretés superficielles les moins tenaces. Et
celles-ci, apportées de la mine ou entraînées à la réduction du minerai, sont
généralement peu importantes. Au contraire, le procédé alchimique, dissociant
et détruisant la masse de matières hétérogènes fixées sur le noyau, constitué
de soufre et de mercure très purs, ruine la majeure partie du corps et la rend
réfractaire à toute réduction ultérieure. C’est ainsi, par exemple, qu’un
kilogramme d’excellent fer de Suède, ou de fer électrolytique, fournit une
proportion de métal radical, d’homogénéité et de pureté parfaites, variant
entre 7 grammes 24 et 7 grammes 32. Ce corps, très brillant, est doué d’une
magnifique coloration violette, – qui est la couleur du fer pur, – analogue,
pour l’éclat et l’intensité, à celle des vapeurs d’iode. On remarquera que le
soufre du fer, isolé, étant rouge incarnat, et son mercure coloré en bleu
clair, le violet provenant de leur combinaison révèle le métal dans son
intégralité. Soumis à la dissolution philosophique, l’argent abandonne peu
d’impuretés, par rapport à son volume, et donne un corps de couleur jaune
presque aussi belle que celle de l’or, dont il n’a pas la forte densité. Déjà,
et nous l’avons enseigné au début de ce livre, la simple dissolution chimique
de l’argent dans l’acide azotique détache du métal une minime fraction d’argent
pur, de couleur d’or, laquelle suffit à prouver la possibilité d’une action
plus énergique et la certitude du résultat qu’on en peut attendre.
Nul ne saurait contester l’importance et la prépondérance de
la dissolution, tant en chimie qu’en alchimie. Elle se place au premier rang
des opérations de laboratoire, et l’on peut dire que la plupart des travaux
chimiques sont sous sa dépendance. En alchimie, l’Œuvre entier ne comporte
qu’une suite de diverses solutions. On ne peut donc s’étonner de la réponse que
fait « l’Esprit de Mercure » à « Frère Albert » dans le dialogue que Basile
Valentin nous donne au livre des Douze
Clefs. « Comment pourrai-je avoir ce corps ? demande Albert ; et l’Esprit
de répliquer : Par la dissolution. » Quelle que soit la voie employée, humide
ou sèche, elle est absolument indispensable. Qu’est-ce que la fusion, sinon une
solution du métal dans son eau propre ? De même, l’inquartation, ainsi que
l’obtention des alliages métalliques, sont de véritables solutions chimiques de
métaux les uns par les autres. Le mercure, liquide à la température ordinaire,
n’est autre chose qu’un métal fondu ou dissous. Toutes les distillations,
extractions, purifications réclament une solution préalable et ne s’effectuent
qu’après achèvement de celle-ci. Et la réduction ? N’est-elle point aussi le
résultat de deux solutions successives, celle du corps et celle du réducteur ?
Si, dans une solution première de trichlorure d’or, on plonge une lame de zinc,
une seconde solution, celle du zinc, s’engage aussitôt, et l’or, réduit, se
précipite à l’état de poudre amorphe. La coupellation démontre également la
nécessité d’une solution première, – celle du métal précieux allié ou impur,
par le plomb, tandis qu’une seconde, la fusion des oxydes superficiels formés,
élimine ceux-ci et parfait l’opération. Quant aux manipulations spéciales,
nettement alchimiques, – imbibitions, digestions, maturations, circulations,
putréfactions, etc., – elles dépendent d’une solution antérieure et représentent
autant d’effets différents d’une seule et même cause.
Mais ce qui distingue la solution philosophique de toutes
les autres, et lui assure pour le moins une réelle originalité, c’est que le
dissolvant ne s’assimile pas au métal basique qui lui est offert ; il en écarte
seulement les molécules, par rupture de cohésion, s’empare des parcelles de
soufre pur qu’elles peuvent retenir et laissent le résidu, formé de la majeure
partie du corps, inerte, désagrégé, stérile et complètement irréductible. On ne
saurait donc obtenir avec lui un sel métallique, ainsi qu’on le fait à l’aide
des acides chimiques. Au reste, connu depuis l’antiquité, le dissolvant
philosophique n’a jamais été utilisé qu’en alchimie, par des manipulateurs
experts dans la pratique du tour de main spécial qu’exige son emploi. C’est lui
que les sages envisagent lorsqu’ils disent que l’Œuvre se fait d’une chose
unique. Contrairement aux chimistes et spagyristes, lesquels disposent d’une
collection d’acides variés, les alchimistes ne possèdent qu’un seul agent, qui
a reçu quantité de noms divers, dont le dernier en date est celui d’Alkaest.
Relever la composition des liqueurs, simples ou complexes, qualifiées alkaests,
nous entraînerait trop loin, car les chimistes des XVIIe et XVIIIe siècles ont
eu chacun leur formule particulière. Parmi les meilleurs artistes qui ont
longuement étudié le mystérieux dissolvant de Jean-Baptiste Van Helmont et de
Paracelse, nous nous bornerons à signaler : Thomson (Epilogismi chimici, Leyde, 1673) ; Welling (Opera cabalistica, Hambourg, 1735) ; Tackenius (Hippocrates chimicus, Venise, 1666) ;
Digby (Secreta medica, Francfort,
1676) ; Starckey (Pyrotechnia, Rouen
1706) ; Vigani (Medulla chemiæ,
Dantzig, 1682) ; Christian Langius (Opera
omnia, Francfort, 1688) ; Langelot (Salamander,
vid. Tillemann, Hambourg, 1673) ; Helbigius (Introïtus ad Physican inauditam, Hambourg, 1680) ; Frédéric
Hoffmann (De acido et viscido,
Francfort, 1689) ; baron Schrœder (Pharmacopæa,
Lyon, 1649) ; Blanckard (Theatrum
chimicum, Leipzig, 1700) ; Quercetanus (Hermes
medicinalis, Paris, 1604) ; Beguin (Elemens
de Chymie, Paris, 1615) ; J.-F. Henckel (Flora Saturnisans, Paris, 1760).
Pott, élève de Stahl, signale aussi un dissolvant qui, à en
juger par ses propriétés, laisserait croire à sa réalité alchimique, si nous
n’étions mieux informé de sa nature véritable. La manière dont notre chimiste
le décrit ; le soin qu’il apporte à tenir secrète sa composition ; la
généralisation voulue de qualités qu’il s’attache d’ordinaire à préciser
davantage, tendraient à le prouver. « Il nous reste à parler, dit-il, d’un
dissolvant huileux et anonyme dont aucun chymiste que je sache n’a fait
clairement mention. C’est une liqueur limpide, volatile, pure, huileuse,
inflammable comme l’esprit de vin, acide comme du bon vinaigre, et qui passe
dans la distillation en forme de flocons nébuleux. Cette liqueur, digérée et
cohobée sur les métaux, surtout après qu’ils ont été calcinés, les dissout
presque tous ; elle retire de l’or une teinture très rouge, et lorsqu’on l’enlève
de dessus l’or, il reste une matière résineuse, entièrement soluble dans
l’esprit de vin, qui acquiert, par ce moyen, une belle couleur rouge. Le résidu
en est totalement irréductible, et je suis assuré qu’on en pourroit préparer le
sel de l’or. Ce dissolvant se mêle indifféremment avec les liqueurs aqueuses ou
grasses ; elle convertit les coraux en une liqueur d’un vert de mer qui paroit
être leur premier état. C’est une liqueur saturée de sel ammoniac et grasse en
même temps, et pour en dire ce que j’en pense, c’est le véritable menstrue de
Weidenfeld, ou l’esprit de vin philosophique, puisqu’on retire de la même
matière les vins blanc et rouge de Raymond Lulle. C’est ce qui fait que Henry
Khunrath donne, dans son Amphithéatre,
à sa Lunaire le nom de son Feu-eau et de son Eau-feu, car il est certain que
Juncken s’est lourdement trompé lorsqu’il tâche de persuader que c’est dans
l’esprit de vin qu’il faut chercher le dissolvant anonyme dont nous parlons. Ce
dissolvant fournit un esprit urineux d’une nature singulière, qui paroît en
quelques points différer entièrement des esprits urineux ordinaires ; il
fournit encore une espèce de beurre qui a la consistance et la blancheur du
beurre d’antimoine ; il est extrêmement amer et d’une moyenne volatilité ; ces
deux produits sont très propres, l’un et l’autre, à extraire les métaux. La
préparation de notre dissolvant, quoique obscure et cachée, est cependant très
facile à faire ; on me dispensera d’en dire davantage sur cette matière parce
que, comme il y a très peu de temps que je la connois et que j’y travaille, il
me reste encore un grand nombre d’expériences à faire pour m’assurer de toutes
ses propriétés. Au reste, sans parler du livre De Secretis Adeptorum de Weidenfeld, Dickenson paroît avoir
découvert ce menstrue dans son traité de Chrysopoeia.
» [J.-H. Pott. Dissertation sur le Soufre
des Métaux, soutenue à Halle, en 1716. Paris, Th. Hérissant, 1759, t. I, p.
61.]
Sans contester la probité de Pott, ni mettre en doute la
véracité de sa description, et moins encore celle que Weidenfeld donne sous des
termes cabalistiques, il est indubitable que le dissolvant dont parle Pott
n’est pas celui des sages. En effet, le caractère chimique de ses réactions et
l’état liquide sous lequel il se présente, en témoignent surabondamment. Ceux
qui sont instruits des qualités du sujet savent que le dissolvant universel est
un véritable minéral, d’aspect sec et fibreux, de consistance solide, dure, de
texture cristalline. C’est donc un sel, et non pas un liquide, ni un mercure
coulant, mais une pierre ou sel pierreux, d’où ses qualificatifs hermétiques de
Salpêtre (sal petri, sel de pierre),
de sel de sagesse ou sel alembroth, – que certains chimistes croient être le
produit de la sublimation simultanée du deutochlorure de mercure et du chlorure
d’ammonium. Et cela suffit à écarter le dissolvant de Pott, comme étant trop
éloigné de la nature métallique pour être avantageusement employé dans le
travail du Magistère. D’ailleurs, si notre auteur avait eu présent à l’esprit
le principe fondamental de l’art, il se serait gardé d’assimiler au dissolvant
universel sa liqueur particulière. Ce principe veut, en effet, que : Dans les métaux, par les métaux, avec les
métaux, les métaux peuvent être perfectionnés. Quiconque s’écarte de cette
vérité première ne découvrira jamais rien d’utile pour la transmutation. En
conséquence, si le métal, selon l’enseignement philosophique et la doctrine
traditionnelle, doit tout d’abord être dissous, on ne le devra faire qu’à
l’aide d’un solvant métallique, qui lui sera approprié et très voisin par la
nature. Les semblables seuls agissent sur leurs semblables. Or, le meilleur
agent, extrait de notre Magnésie ou sujet, prend l’aspect d’un corps
métallique, chargé d’esprits métalliques, bien qu’à proprement parler il ne
soit pas un métal. C’est ce qui a engagé les Adeptes, pour mieux le soustraire
à l’avidité des cupides, à lui donner tous les noms possibles de métaux, de
minéraux, de pétrifications et de sels. Parmi ces dénominations, la plus
familière est certainement celle de Saturne, considéré comme l’Adam métallique.
Aussi, ne pouvons-nous mieux compléter notre instruction qu’en laissant la
parole aux philosophes ayant traité spécialement de cette matière. Voici donc
la traduction d’un chapitre fort suggestif de Daniel Mylius, consacré à l’étude
de Saturne, et qui reproduit les enseignements de deux célèbres Adeptes : Isaac
le Hollandais et Théophraste Paracelse.
« Aucun philosophe versé dans les écrits hermétiques
n’ignore combien Saturne est élevé, à tel point qu’il doit être préféré à l’or
commun et naturel, et il est appelé l’Or vrai et la Matière Sujet des
philosophes. Nous transcrirons sur ce point le témoignage approuvé des
philosophes les plus remarquables.
« Isaac Hollandais dit dans son Œuvre végétable : Sache, mon fils, que la pierre des philosophes
doit être faite au moyen de Saturne, et lorsqu’on l’a obtenue à l’état parfait,
elle fait la projection tant dans le corps humain, – à l’extérieur comme à
l’intérieur, – que dans les métaux. Sache aussi que dans tous les œuvres
végétables, il n’y a pas de plus grand secret que dans Saturne, car nous ne
trouvons la putréfaction de l’or qu’en Saturne où elle est cachée. Saturne
contient dans son intérieur l’or probe, ce dont conviennent tous les philosophes,
à condition qu’on lui retire toutes ses superfluités, c’est-à-dire les fèces,
et alors il est purgé. L’extérieur est amené à l’intérieur, l’intérieur
manifesté à l’extérieur, et c’est là sa rougeur, et c’est alors l’Or probe.
« Saturne, du reste, entre facilement en solution et se
coagule de même ; il se prête de bonne grâce à laisser extraire son mercure. Il
peut être sublimé aisément, à tel point qu’il devient le mercure du soleil. Car
Saturne contient en son intérieur l’or dont Mercure a besoin, et son mercure
est aussi pur que celui de l’or. C’est pour ces raisons que je dis que Saturne
est, pour notre Œuvre, de beaucoup préférable à l’or ; car si tu veux extraire
le mercure de l’or, il te faudra plus d’un an pour tirer ce corps du soleil, tandis
que tu peux extraire le mercure de Saturne en vingt-sept jours. Les deux métaux
sont bons, mais tu peux affirmer avec plus de certitude encore, que Saturne est
la pierre que les philosophes ne veulent pas nommer et dont le nom a,
jusqu’aujourd’hui, été caché. Car si l’on connaissait son nom, beaucoup
auraient trouvé, qui courent après sa recherche, et cet Art serait devenu
commun et vulgaire. Ce travail deviendrait bref et sans grande dépense. Aussi,
pour éviter ces inconvénients, les philosophes en ont caché le nom avec un
grand soin. Certains l’ont enveloppé dans des paraboles merveilleuses, disant
que Saturne est le vase auquel il ne faut rien ajouter d’étranger, excepté ce
qui vient de lui ; de telle manière qu’il n’y a pas d’homme, si pauvre soit-il,
qui ne puisse vaquer à cet Œuvre, puisqu’il ne nécessite pas de grands frais,
et qu’il faut peu de travail et peu de jours pour en obtenir la Lune et, peu
après, le Soleil. Nous trouvons donc dans Saturne tout ce qui nous est
nécessaire pour l’Œuvre. En lui est le mercure parfait ; en lui sont toutes les
couleurs du monde qui peuvent se manifester ; en lui est la véritable noirceur,
la blancheur, la rougeur, et en lui aussi est le poids.
« Je vous confie donc qu’on peut comprendre, après cela, que
Saturne est notre pierre philosophique et le Laiton, d’où le mercure et notre
pierre peuvent être extraits, en peu de temps et sans grands débours, au moyen
de notre Art bref. Et la pierre qu’on en reçoit est notre Laiton, et l’eau
aiguë qui est en elle est notre pierre. Et c’est là la Pierre et l’Eau sur
laquelle les philosophes ont écrit des montagnes de livres.
« Théophraste Paracelse, dans le Canon cinquième de Saturne, dit :
« « Saturne parle ainsi de sa nature : les six (métaux) se
sont joints à moi et infusèrent leur esprit dans mon corps caduc ; ils y
ajoutèrent ce qu’ils ne voulurent point et me l’attribuèrent. Mais mes frères
sont spirituels et pénètrent mon corps, qui est feu, de telle sorte que je suis
consumé par le feu. De manière qu’eux (les métaux), excepté les deux, Soleil et
Lune, sont purgés par mon eau. Mon esprit est l’eau qui ramollit tous les corps
congelés et endormis de mes frères. Mais mon corps conspire avec la terre,
tellement que ce qui s’attache à cette terre est rendu semblable à elle et
ramené dans son corps. Et je ne connais rien dans le monde qui puisse produire
cela comme je le peux. Les chimistes doivent donc abandonner tout autre procédé
et s’attacher aux ressources que l’on peut tirer de moi.
« La pierre, qui en moi est froide, est mon Eau, au moyen de
laquelle on peut coaguler l’esprit des sept métaux et l’essence du septième, du
Soleil ou de la Lune, et, avec la grâce de Dieu, profite tant qu’au bout de
trois semaines on peut préparer le menstrue de Saturne qui dissoudra immédiatement
les perles. Si les esprits de Saturne sont fondus en solution, ils se coagulent
aussitôt en masse et arrachent à l’or l’huile animée ; alors, par ce moyen,
tous les métaux et les gemmes peuvent être dissous en un instant, ce que le
philosophe réservera pour lui autant qu’il le jugera convenable. Mais je veux
demeurer aussi obscur sur ce point que j’ai été clair jusqu’ici. » » [Daniel
Mylius. Basilica Philosophica.
Francofurti, apud Lucam Jennis, 1618. Conseil dixième. Théorie de la pierre des philosophes, tome III, livre I, p. 67.]
Pour achever l’étude de la Prudence et des attributs
symboliques de notre science, il nous reste à parler du compas que la belle
statue de Michel Colombe tient de la main droite. Nous le ferons brièvement.
Déjà, le miroir nous a renseigné sur le sujet de l’art ;
la double figure, sur l’alliance nécessaire du sujet avec le métal choisi ; le
serpent, sur la mort fatale et la glorieuse résurrection du corps issu de cette
union. À son tour, le compas nous fournira les indications complémentaires
indispensables, qui sont celles des proportions. Sans leur connaissance, il
serait impossible de conduire et parfaire l’Œuvre de façon normale, régulière
et précise. C’est ce qu’exprime le compas, dont les branches servent non seulement
à la mesure proportionnelle des distances entre elles ainsi qu’à leur
comparaison, mais encore au tracé géométrique parfait de la circonférence,
image du cycle hermétique et de l’Œuvre accompli. Nous avons exposé, en un
autre endroit de cet ouvrage, ce qu’il faut entendre par ces termes de
proportions ou de poids, – secret voilé sous la forme du compas, – et avons
montré qu’ils renfermaient une double notion, celle du poids de nature et
celles des poids de l’art. Nous n’y reviendront pas et dirons simplement que
l’harmonie résultant des proportions naturelles, et à jamais mystérieuses, se
traduit par cet adage de Linthaut : La
vertu du soufre ne s’étend que jusqu’à certaine proportion d’un terme. Au
contraire, les rapports entre les poids de l’art, restant soumis à la volonté
de l’artiste, s’expriment par l’aphorisme du
Cosmopolite : Le poids du corps est
singulier et celui de l’eau pluriel. Mais, comme les philosophes enseignent
que le soufre est susceptible d’absorber jusqu’à dix et douze fois son poids de
mercure, on voit naître aussitôt la nécessité d’opérations supplémentaires,
dont les auteurs se préoccupent médiocrement : les imbibitions et les
réitérations. Nous agirons dans le même sens et soumettrons ces détails de
pratique à la propre sagacité du débutant, parce qu’ils sont d’exécution facile
et de recherche secondaire.
VII (Les gardes du corps de François II, duc de Bretagne)
Dans la cathédrale nantaise, le crépuscule, peu à peu,
décroît.
L’ombre envahit les voûtes ogivales, comble les nefs, baigne
l’humanité pétrifiée du majestueux édifice. À nos côtés, les colonnes,
puissantes et graves, montent vers les arcs enchevêtrés, les croisillons, les
pendentifs que l’obscurité grandissante dérobe maintenant à nos yeux. Une
cloche tinte. Un prêtre invisible récite à mi-voix l’oraison du soir, et le
glas d’en haut répond à la prière d’en bas. Seules, les flammes tranquilles des
cierges piquent d’éclats d’or les ténèbres du sanctuaire. Puis, l’office
achevé, un silence sépulcral pèse sur toutes ces choses inertes et froides,
témoins d’un passé lointain, lourd de mystère et d’inconnu…
Les quatre gardiennes de pierre, en leur attitude figée,
semblent émerger, imprécises et floues, du sein de cette pénombre. Sentinelles
muettes de l’antique Tradition, ces femmes symboliques, veillant, aux angles du
mausolée vide, les images rigides, marmoréennes, de corps dispersés, enfouis on
ne sait où, émeuvent et mènent à penser. O vanité des choses terrestres !
Fragilité des richesses humaines ! Que reste-t-il à présent de ceux dont vous
deviez commémorer la gloire et rappeler la grandeur ? Un cénotaphe. Moins
encore : un prétexte d’art, un support de science, chef-d’œuvre dépourvu
d’utilité et de destination, simple souvenir historique, mais dont la portée
philosophique et l’enseignement moral dépassent de beaucoup la banalité
somptueuse de sa première affectation.
Et, devant ces nobles figures des Vertus cardinales, voilant
les quatre connaissances de l’éternelle Sapience, les paroles de Salomon
(Prov., III, 13 à 19) nous viennent tout naturellement à l’esprit :
« Heureux l’homme qui a trouvé la Sagesse ; heureux celui
qui progresse dans l’intelligence ! Car le trafic qu’on peut faire d’elle est
meilleur que celui de l’argent, et le revenu qu’on en peut tirer vaut mieux que
l’or le plus fin. Elle est plus précieuse que les perles, et toutes choses
désirables ne la valent point. Elle a de longs jours dans sa main droite et de
la gloire dans sa gauche. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses
sentiers sont remplis de prospérité. Elle est l’arbre de vie pour ceux qui
l’embrassent, et tous ceux qui la conservent sont rendus bienheureux. L’Éternel
a fondé la terre par la Sagesse et agencé les cieux par l’Intelligence. »
LE CADRAN SOLAIRE DU PALAIS HOLYROOD D’ÉDIMBOURG
C’est un petit édifice d’une extrême singularité. Vainement
interrogeons-nous nos souvenirs : nous n’y trouvons pas d’image analogue à
cette œuvre originale et si fortement caractérisée. C’est plutôt un cristal
érigé, une gemme élevée sur un support, qu’un véritable monument. Et cet
échantillon gigantesque des productions minières, serait mieux à sa place dans
un musée de minéralogie qu’au milieu d’un parc où le public n’est point admis à
pénétrer.
Exécuté en 1633, sur l’ordre de Charles Ier, par John Milne,
son maître maçon, avec la collaboration de John Bartoun, il se compose
essentiellement d’un bloc géométrique, taillé en icosaèdre régulier, aux faces
creusées d’hémisphères et de cavités à parois rectilignes, lequel est supporté
par un piédestal dressé sur une base pentagonale formée de trois degrés plans.
Cette base seule, ayant souffert des intempéries, a dû être restaurée. Tel est
le
Sundial du Palais Holyrood (pl.
XL).
 |
| Planche XL |
L’antiquité, que l’on peut toujours consulter avec fruit,
nous a laissé un certain nombre de cadrans solaires aux formes variées,
retrouvés dans les ruines de Castel-Nuovo, de Pompéi, Tusculum, etc. D’autres
nous sont connus par les descriptions d’écrivains scientifiques, Vitruve et
Pline en particulier. C’est ainsi que le cadran dit Hemicyclium, attribué à
Bérose (vers 280 av. J.-C.), comprenait une surface semi-circulaire « sur
laquelle un style marquait les heures, les jours et même les mois ». Celui
qu’on appelait Scaphe se composait
d’un bloc creux, pourvu au centre d’une aiguille dont l’ombre se projetait sur
les parois. Il aurait été fabriqué par Aristarque de Samos (IIIe siècle av.
J.-C.), ainsi que le cadran Discus, fait d’une table ronde, horizontale, à
bords légèrement relevés. Parmi les formes inconnues dont il ne nous est
parvenu, pour la plupart, que les noms, on citait les cadrans : Arachne, où les
heures étaient, dit-on, gravées à l’extrémité de fils ténus, ce qui lui donnait
l’aspect d’une araignée (l’invention en serait due à Eudoxe de Cnide, vers 330
av. J.-C.) ; Plinthium, disque horizontal tracé sur une base de colonne carrée,
aurait eu pour auteur Scopus de Syracuse ; Pelecinon, cadran également
horizontal de Patrocle ; Conum, système conique de Dionysidore d’Amisus, etc.
Aucune de ces formes ni de ces relations ne correspond à
celle du curieux édifice d’Édimbourg ; aucune ne peut lui servir de prototype.
Et cependant, sa dénomination, celle qui justifie sa raison d’être, est
doublement exacte. C’est à la fois un cadran solaire multiple et une véritable
horloge hermétique. Ainsi cet icosaèdre étrange représente pour nous une œuvre
de double gnomonique. Le mot grec γνώμων, qui s’est intégralement transmis aux
langues latine et française (gnomon), possède un autre sens que celui de
l’aiguille chargée d’indiquer, par l’ombre projetée sur un plan, la marche du
soleil. Γνώµων désigne aussi celui qui prend connaissance, qui s’instruit ; il
définit le prudent, le sensé, l’éclairé. Ce mot a pour racine γιγνώσκω, que
l’on écrit encore γινώσκω, double forme orthographique dont le sens est
connaître, savoir, comprendre, penser, résoudre. De là provient Γνῶσις,
connaissance, érudition, doctrine, d’où notre mot français Gnose, doctrine des
Gnostiques et philosophie des Mages. On sait que la Gnose était l’ensemble des
connaissances sacrées dont les Mages gardaient soigneusement le secret et qui
faisait, pour les seuls initiés, l’objet de l’enseignement ésotérique. Mais la
racine grecque d’où proviennent γνώμων et γνῶσις, a également formé γνώμη, correspondant à notre mot gnome, avec la signification d’esprit, d’intelligence. Or, les
gnomes, génies souterrains préposés à la garde des trésors minéraux, veillant
sans cesse sur les mines d’or et d’argent, les gîtes de pierres précieuses,
apparaissent comme des représentations symboliques, des figures humanisées de
l’esprit vital métallique et de l’activité matérielle. La tradition nous les
dépeint comme étant fort laids et de très petite stature ; en revanche, leur
naturel est doux, leur caractère bienfaisant, leur commerce extrêmement
favorable. On comprend facilement alors la raison cachée des récits légendaires
où l’amitié d’un gnome ouvre toutes grandes les portes des richesses
terrestres…
L’icosaèdre gnomonique d’Édimbourg est donc bien, en dehors
de sa destination effective, une traduction cachée de l’Œuvre gnostique, ou
Grand-Œuvre des philosophes. Pour nous, ce petit monument n’a pas simplement et
uniquement pour objet d’indiquer l’heure diurne, mais encore la marche du
soleil des sages dans l’ouvrage philosophal. Et cette marche est réglée par
l’icosaèdre, qui est ce cristal inconnu, le Sel de Sapience, esprit ou feu
incarné, le gnome familier et serviable, ami des bons artistes, lequel assure à
l’homme l’accession aux suprêmes connaissances de la Gnose antique.
Au demeurant, la Chevalerie fut-elle complètement étrangère
à l’édification de ce curieux Sundial, ou, tout au moins, à sa décoration
spéciale ? Nous ne le pensons pas et croyons en trouver la preuve dans ce fait
que, sur plusieurs faces du solide, l’emblème du chardon s’y répète avec une
insistance significative. On compte, en effet, six capitules floraux et deux
tiges fleuries de l’espèce dite serratula
arvensis. Ne peut-on reconnaître, dans la prépondérance évidente du
symbole, avec l’insigne particulier aux Chevaliers de l’Ordre du Chardon,
l’affirmation d’un sens secret imposé à l’ouvrage et contresigné par eux ?
[L’Ordre du Chardon, créé par Jacques V, roi d’Écosse, en
1540, se composait originairement de douze chevaliers, comme toutes les
fraternités dérivées de la Table ronde. On le nomma aussi Ordre de Saint-André,
parce qu’une chapelle de la cathédrale, dédiée à l’apôtre, leur était
spécialement affectée ; que la décoration en portait l’effigie, et qu’enfin la
fête de l’Ordre se célébrait le 30 novembre, jour de la fête de Saint André.
Supprimé en 1587, il continua d’exister secrètement et fut rétabli en 1687.]
Édimbourg, au surplus, possédait-il, à côté de cet Ordre
royal dont l’ésotérisme hiéroglyphique ne laisse aucun doute, un centre
d’initiation hermétique placé sous sa dépendance ? Nous ne saurions l’affirmer.
Toutefois, trente ans environ avant la construction du cadran solaire, quatorze
après la suppression « officielle » de l’Ordre, devenu Fraternité secrète, nous
voyons apparaître, aux environs immédiats d’Édimbourg, l’un des plus savants
Adeptes et des plus fervents propagateurs de la vérité alchimique, Seton,
célèbre sous le pseudonyme du Cosmopolite. « Pendant l’été de l’année 1601,
écrit Louis Figuier, un pilote hollandais, nommé Jacques Haussen, fut assailli
par une tempête dans la mer du Nord et jeté sur la côte d’Écosse, non loin
d’Édimbourg, à une petite distance du village de Seton ou Seatoun. Les
naufragés furent secourus par un habitant de la contrée qui possédait une
maison et quelques terres sur ce rivage ; il réussit à sauver plusieurs de ces
malheureux, accueillit avec beaucoup d’humanité le pilote dans sa maison, et
lui procura les moyens de retourner en Hollande. » [Cf. Louis Figuier. L’Alchimie et les Alchimistes. Paris,
Hachette et Cie, 1856.]
Cet homme se nommait Sethon ou Sethonius Scotus.
[On trouve ce nom diversement orthographié selon les
auteurs. Seton ou Sethon est encore appelé Sitonius, Sidonius, Suthoneus,
Suehtonius et Seethonius. Toutes ces dénominations sont accompagnées de
l’épithète Scotus, ce qui désigne un Écossais de naissance. Quant au palais de
Sethon, dans l’ancienne paroisse de Haddingtonshire, annexée à Tranent en 1580,
il fut détruit une première fois par les Anglais en 1544. Réédifié, Marie
Stuart et Darnley s’y arrêtèrent, le 11 mars 1566, au lendemain de l’assassinat
de Rizzio ; la reine y revint, accompagnée de Bothwell, en 1567, après le
meurtre de Darnley. James VI (Jacques VI d’Écosse) y séjourna en avril 1603,
lorsqu’il vint prendre possession de la couronne d’Angleterre. Lors des
funérailles du premier comte de Winton, il assista au défilé du cortège, assis
sur un banc du parc. En 1617, ce même monarque passa sa seconde nuit à Seton,
après avoir traversé le Twed. Charles Ier et sa cour y furent reçus deux fois
en 1633. Actuellement, il n’existe plus aucun vestige de ce palais,
complètement détruit en 1790. Ajoutons que la famille de Seton avait reçu sa
charte de propriété des terres de Seton et de Winton au XIIe siècle.]
L’Anglais Campden, dans sa Britannia, signale, en effet, tout près de l’endroit du littoral où
le pilote Haussen fit naufrage, une habitation qu’il nomme Sethon House et nous dit être la résidence du comte de Winton. Il
est donc probable que notre Adepte appartenait à cette noble famille d’Écosse,
ce qui fournirait un argument d’une certaine valeur à l’hypothèse de rapports
possibles entre Sethon et les chevaliers de l’Ordre du Chardon. Peut-être
l’homme s’était-il formé dans le lieu même où nous le voyons pratiquer ces
œuvres de miséricorde et de haute morale, qui caractérisent les âmes élevées et
les vrais philosophes. Quoi qu’il en soit, ce fait marque le début d’une
existence nouvelle, consacrée à l’apostolat hermétique, existence errante,
mouvementée, brillante, parfois pleine de vicissitudes, vécue en totalité à
l’étranger, et que le martyre devait tragiquement couronner deux ans plus tard
(décembre 1603 ou janvier 1604). Il semble donc bien que le Cosmopolite,
uniquement préoccupé de sa mission, ne revint jamais dans son pays d’origine et
qu’il ne le quitta, en 1601, qu’après avoir acquis la maîtrise parfaite de
l’art. Ce sont ces raisons, ou plutôt ces conjectures, qui nous ont porté à
rapprocher les chevaliers du Chardon du célèbre alchimiste, en invoquant le
témoignage hermétique du Sundial d’Édimbourg.
À notre avis, le cadran solaire écossais est une réplique
moderne, à la fois plus concise et plus savante, de l’antique Table smaragdine. Celle-ci se composait
de deux colonnes de marbre vert, selon certains, ou d’une plaque d’émeraude
artificielle, selon d’autres, sur lesquelles l’Œuvre solaire était gravé en
termes cabalistiques. La tradition l’attribue au Père des philosophes, Hermès
Trismégiste, qui s’en déclare l’auteur, quoique sa personnalité, fort obscure,
ne permet pas de savoir si l’homme appartient à la fable ou à l’histoire.
D’aucuns prétendent que ce témoignage de la science sacrée, écrit primitivement
en grec, fut découvert après le Déluge dans une grotte rocheuse de la vallée
d’Hébron. Ce détail, dépourvu même d’authenticité, nous aide à mieux comprendre
la signification secrète de cette fameuse Table, qui pourrait bien n’avoir
jamais existé ailleurs que dans l’imagination, subtile et malicieuse, des vieux
maîtres. On nous dit qu’elle est verte, – ainsi que la rosée de printemps,
appelée pour cette raison Émeraude des
philosophes, – première analogie avec la matière saline des sages ; qu’elle
fut rédigée par Hermès, seconde analogie, puisque cette matière porte le nom de
Mercure, divinité romaine
correspondant à l’Hermès des Grecs. Enfin, troisième analogie, ce mercure vert
servant pour les trois Œuvres, on le qualifie de triple, d’où l’épithète
Trismégiste (Τρισμέγιστος, trois fois grand ou sublime) ajoutée au nom
d’Hermès. La Table d’Émeraude prend ainsi le caractère d’un discours prononcé
par le mercure des sages sur la manière dont s’élabore l’Œuvre philosophal. Ce
n’est pas Hermès, le Thot égyptien qui parle, mais bien l’Émeraude des
philosophes ou la Table isiaque elle-même.
Le texte de la Table d’Émeraude, très connu des disciples
d’Hermès, peut être ignoré de quelques lecteurs. Voici donc la version la plus
exacte de ces paroles célèbres :
« Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable :
« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui
est en haut est comme ce qui est en bas ; par ces choses se font les miracles
d’une seule chose. Et comme toutes les choses sont et proviennent d’UN, par la
médiation d’UN, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par
adaptation.
« Le Soleil en est le père, et la Lune la mère. Le vent l’a
porté dans son ventre. La Terre est sa nourrice et son réceptacle. Le Père de
tout, le Thélème du monde universel est ici. Sa force ou puissance reste
entière, si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le
subtil de l’épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre et
descend du ciel, et reçoit la force des choses supérieures et des choses
inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire du monde, et toute obscurité
s’enfuira de toi.
« C’est la force, forte de toute force, car elle vaincra
toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été
créé. De cela sortiront d’admirables adaptations, desquelles le moyen est ici
donné.
« C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant
les trois parties de la philosophie universelle.
« Ce que j’ai dit de l’Œuvre solaire est complet. »
On trouve la Table d’Émeraude reproduite sur un rocher, en
traduction latine, dans l’une des belles planches illustrant l’Amphitheatrum Sapientiæ Æternæ, de
Kunrath (1610). Joannes Grasseus, sous le pseudonyme d’Hortulanus, en a donné,
au XVe siècle, un Commentaire,
traduit par J. Girard de Tournus, dans le Miroir
d’Alquimie. Paris, Sevestre, 1613.
L’idée génératrice du cadran d’Édimbourg reflète une
préoccupation semblable. Toutefois, outre qu’il borne son enseignement à la
seule pratique alchimique, ce n’est plus la matière, dans ses qualités et dans
sa nature, qu’il exprime, mais seulement sa forme ou structure physique. C’est
un édifice cristallin dont la composition chimique demeure inconnue. Sa
configuration géométrique permet seulement d’y reconnaître les caractéristiques
minéralogiques des corps salins en général. Il nous apprend que le mercure est
un sel, – ce que nous savions déjà, – et que ce sel tire son origine du monde
minéral. C’est d’ailleurs ce qu’affirment et répètent à l’envi Claveus, le
Cosmopolite, Limojon de Saint-Didier, Basile Valentin, Huginus à Barma,
Batsdorff, etc., lorsqu’ils enseignent que le sel des métaux est la pierre des
philosophes. [« Tirez le sel des métaux, dit le Cosmopolite, sans aucune
corrosion ni violence, et ce sel vous produira la pierre blanche et la rouge.
Tout le secret consiste au sel, duquel se fait notre parfait Élixir. »]
Nous pouvons donc, raisonnablement, regarder ce cadran
solaire comme un monument élevé au Vitriol philosophique, sujet initial et
premier être de la pierre philosophale. Or, tous les métaux ne sont que des
sels, ce que prouve leur texture et ce que démontre la facilité avec laquelle
ils forment des composés cristallisés ; au feu, ces sels se fondent dans leur
eau de cristallisation et prennent l’aspect de l’huile ou du mercure. Notre
Vitriol obéit à la même loi, et, comme il conduit au succès l’artiste assez
heureux pour le découvrir et le préparer, il a reçu de nos prédécesseurs le nom
d’Huile de victoire. D’autres, considérant sa couleur, et jouant à dessein sur
l’assonance, l’ont dénommé Huile de verre (vitri oleum), ce qui marque son
aspect vitreux, sa fluidité grasse au feu et sa coloration verte (viridis). C’est cette couleur franche
qui a permis de lui donner toutes les épithètes qui dérobent au profane sa
véritable nature. On l’a doté, nous dit Arnaud de Villeneuve, du nom des
arbres, des feuilles, des herbes, de tout ce qui présente une coloration verte,
« afin de tromper les insensés ». Les composés métalliques, donnant des sels
verts, ont contribué dans une large mesure à l’extension de cette nomenclature.
Davantage, les philosophes, renversant l’ordre, se sont plu à désigner des
choses vertes par des qualificatifs hermétiques, pour rappeler sans doute
l’importance que prend cette couleur en alchimie. Le mercureau, par exemple, ou
petit mercure, qui est devenu notre maquereau, sert encore à déguiser, au
premier jour d’avril, la personnalité de l’expéditeur. C’est un poisson
mystique, objet de mystifications. Il doit son nom et sa réputation à sa
brillante coloration verte, coupée de bandes noires, semblable à celle du
mercure des sages. Bescherelle signale qu’en l’année 1430 le maquereau était le
seul poisson de mer qui parvînt jusqu’à Paris, où, selon une coutume fort
ancienne, on l’apprêtait avec des groseilles vertes. [Cabalistiquement : gros sel vert.] Sait-on pourquoi les
seiches ont reçu le nom qu’elles portent ? Tout simplement parce qu’elles
pondent des œufs verts, groupés en grappe de raisin. Notre mercure vert, agent
de putréfaction et de régénération, a fait appeler la seiche σηπία, dans la
langue primitive ; la racine de ce mot est σήπω, qui signifie putréfier,
réduire en pourriture. Grâce à ses œufs verts, la seiche porte un nom
cabalistique, au même titre que la Saturnie du poirier (Saturnia pyri), grand
papillon aux œufs d’émeraude.
Les alchimistes grecs avaient coutume, dans leurs formules,
de traduire le dissolvant hermétique par l’indication de sa couleur. Ils
assemblaient, pour réaliser leur symbole, deux consonnes du mot ΧΛΩΡΟΣ, vert,
le Χ et le Ρ juxtaposés. Or, ce chiffre typique reproduit exactement le
monogramme grec du Christ, extrait de son nom ΧΡΙΣΤΟΣ. Devons-nous voir, en
cette similitude, l’effet d’une simple coïncidence, ou celui d’une volonté
raisonnée ? Le mercure philosophique naît d’une substance pure, Jésus naît
d’une mère sans tache ; le Fils de l’Homme et l’enfant d’Hermès mènent tous
deux la vie des pèlerins ; tous deux meurent prématurément, en martyrs, l’un
sur la croix, l’autre dans le creuset ; ils ressuscitent de même, l’un et
l’autre, le troisième jour… Voilà de curieuses correspondances, certes, mais
nous ne saurions affirmer que les hermétistes grecs les aient connues ni qu’ils
les aient utilisées.
D’autre part, serait-ce pousser la hardiesse jusqu’à la
témérité que de rapporter à l’ésotérisme de notre science telle pratique de
l’Église chrétienne, qui avait lieu le 1er mai ? Ce jour-là, dans nombre de
villes, le clergé s’en allait en procession, – la Procession verte, – couper
les arbustes et les branches dont on décorait les églises, celles en
particulier qui étaient placées sous le vocable de Notre-Dame. Ces processions sont
abandonnées aujourd’hui ; seul, l’usage des mais, qui en provient, s’est
conservé et se perpétue encore dans nos villages. Les symbolistes découvriront
sans peine la raison de ces rites obscurs, s’ils se souviennent que Maia était
mère d’Hermès. On sait, de plus, que la rosée de mai, ou Émeraude des philosophes, est verte, et que l’Adepte Cyliani
déclare, métaphoriquement, ce véhicule indispensable pour le travail. Aussi, ne
prétendons-nous pas insinuer qu’il faille recueillir, à l’exemple de certains
spagyristes et des personnages du Mutus
Liber, la rosée nocturne du mois de Marie, en lui attribuant des qualités
dont nous la savons dépourvue. La rosée des sages est un sel, non une eau, mais
c’est la coloration propre de cette eau qui sert à désigner notre sujet.
Chez les anciens Hindous, la matière philosophale était
figurée par la déesse Moudévi (Μύδησις, humidité, pourriture ; rac. μυδάω,
pourrir). Née, dit-on, de la Mer de lait, on la représentait peinte de couleur
verte, montée sur un âne, et portant en main une bannière au milieu de laquelle
se voyait un corbeau.
Hermétique aussi, sans doute, l’origine de cette Fête du
Loup vert, réjouissance populaire dont l’usage s’est longtemps maintenu à
Jumièges, et qui se célébrait, le 24 juin, jour de l’exaltation solaire, en
l’honneur de sainte Austreberthe. Une légende nous raconte que la sainte
blanchissait le linge de la célèbre abbaye, où un âne la transportait. Un jour,
le loup étrangla l’âne. Sainte Austreberthe condamna le coupable à faire le
service de sa victime, et le loup s’en acquitta à merveille jusqu’à sa mort.
C’est le souvenir de cette légende que la fête perpétuait. On ne nous donne pas
cependant la raison pour laquelle la couleur verte fut attribuée au loup. Mais
nous pouvons dire, de manière très certaine, que c’est en étranglant et
dévorant l’âne que le loup devient vert, et celà suffit. Le « loup affamé et
ravisseur » est l’agent indiqué par Basile Valentin dans la première de ses Douze Clefs. Ce loup (λύκος) est d’abord
gris et ne laisse pas soupçonner le feu ardent, la vive lumière qu’il tient
cachés en son corps grossier. Sa rencontre avec l’âne rend manifeste cette
lumière : λύκος devient λύκη, la première lueur du matin, l’aurore. Le loup
gris s’est teint en loup vert, et c’est alors notre feu secret, l’Apollon
naissant, Λυκηγενής, le père de la lumière.
Puisque nous rassemblons en ce lieu tout ce qui peut aider
l’investigateur à découvrir le mystérieux agent du Grand-Œuvre, nous lui
donnerons encore la Légende des Cierges
verts. Celle-ci se rapporte à la célèbre Vierge noire marseillaise,
Notre-Dame-de-Confession, qu’abritent les cryptes de la vieille abbaye de
Saint-Victor. Cette légende contient, derrière le voile allégorique, la
description du travail que doit effectuer l’alchimiste pour extraire, du
minéral grossier, l’esprit vivant et lumineux, le feu secret qu’il renferme,
sous forme de cristal translucide, vert, fusible comme de la cire, et que les
sages nomment leur Vitriol.
Voici cette naïve et précieuse tradition hermétique :
Une jeune fille de l’antique Massilia, nommée Marthe, simple
petite ouvrière, et depuis longtemps orpheline, avait voué à la Vierge noire
des Cryptes un culte particulier. Elle lui offrait toutes les fleurs qu’elle
allait cueillir sur les coteaux, – thym, sauge, lavande, romarin, – et ne
manquait jamais, quelque temps qu’il fît, d’assister à la messe quotidienne.
La veille de la Chandeleur, fête de la Purification, Marthe
fut éveillée, au milieu de la nuit, par une voix secrète qui l’invitait à se
rendre au cloître pour y entendre l’office matinal. Craignant d’avoir dormi
plus qu’à l’ordinaire, elle se vêtit en hâte, sortit, et, comme la neige,
étendant son manteau sur le sol, réfléchissait une certaine clarté, crut l’aube
prochaine. Elle atteignit vite le seuil du monastère, dont la porte se trouvait
ouverte. Là, rencontrant un clerc, elle le pria de bien vouloir dire une messe
en son nom ; mais, dépourvue d’argent, elle fit glisser de son doigt un modeste
anneau d’or, – sa seule fortune, – et le plaça, en guise d’offrande, sous un
chandelier d’autel.
Aussitôt la messe commencée, quelle ne fut pas la surprise
de la jeune fille en voyant la cire blanche des cierges devenir verte, d’un
vert céleste, inconnu, vert diaphane et plus éclatant que les plus belles
émeraudes ou les plus rares malachites ! Elle n’en
pouvait croire ni détacher ses yeux…
Quand l’Ite missa est
vint enfin l’arracher à l’extase du prodige, quand elle retrouva, au dehors, le
sens des réalités familières, elle s’aperçut que la nuit n’était point achevée
: la première heure du jour sonnait seulement au beffroi de Saint-Victor.
Ne sachant que penser de l’aventure, elle regagna sa
demeure, mais revint de bon matin à l’abbaye. Il y avait déjà, dans le saint
lieu, un grand concours de peuple. Anxieuse et troublée, elle s’informa ; on
lui apprit qu’aucune messe n’avait été dite depuis la veille. Marthe, au risque
de passer pour visionnaire, raconta alors par le menu le miracle auquel elle
venait d’assister, quelques heures plus tôt, et les fidèles, en foule, la
suivirent jusqu’à la grotte. L’orpheline avait dit vrai ; la bague se trouvait
encore au même endroit, sous le chandelier, et les cierges brillaient toujours,
sur l’autel, de leur incomparable éclat vert… [Cf. la petite pièce versifiée intitulée
La Légende des Cierges verts, par
Hippolyte Matabon. Marseille, J. Cayer, 1889.]
Dans sa Notice sur
l’Antique Abbaye de Saint-Victor de Marseille, M. l’abbé Laurin parle de la
coutume, qu’observe encore le peuple, de porter des cierges verts aux processions
de la Vierge noire. Ces cierges sont bénits le 2 février, jour de la
Purification, appelée communément fête de la Chandeleur. L’auteur ajoute que «
les cierges de la Chandeleur doivent être verts, sans que la raison en soit
bien connue. Les documents nous indiquent que des cierges de couleur verte
étaient en usage en d’autres endroits, dans le monastère des religieuses de
Saint-Sauveur, à Marseille, en 1479, et dans la métropole de Saint-Sauveur, à
Aix-en-Provence, jusqu’en 1620. Ailleurs, cet usage s’est perdu, tandis qu’il
s’est conservé à Saint-Victor. »
Tels sont les points essentiels du symbolisme propre au
Sundial d’Édimbourg, que nous tenions à signaler.
Dans la décoration spéciale de l’icosaèdre emblématique, le
visiteur assez puissant pour pouvoir l’approcher, – car sans motif pertinent il
n’en obtiendra jamais l’autorisation, – remarquera, outre les chardons
hiéroglyphiques de l’Ordre, les monogrammes respectifs de Charles Ier, décapité
en 1649, et de sa femme, Marie-Henriette de France. Les lettres C R (Carolus
Rex) s’appliquent au premier ; M R (Maria Regina) désignent la seconde. Leur
fils, Charles II, né en 1630, – il était âgé de trois ans lors de l’édification du monument, – est caractérisé sur les faces du
cristal de pierre par les initiales C P (Carolus Princeps), surmontées chacune
d’une couronne, ainsi que celles de son père. Il y verra encore, à côté des
armes d’Angleterre, d’Écosse et de la harpe d’Irlande, cinq roses et autant de
fleurs de lys, détachées et indépendantes, emblèmes de sagesse et de
chevalerie, celle-ci soulignée par le panache, formé de trois plumes
d’autruche, qui ornait jadis le casque des chevaliers. Enfin, d’autres
symboles, que nous avons analysés au cours de ces études, achèveront de
préciser le caractère hermétique du curieux édifice : le lion couronné, tenant
d’une patte une épée et de l’autre un sceptre ; l’ange, représenté les ailes
éployées ; saint Georges terrassant le dragon et saint André offrant
l’instrument de son martyre, – la croix en X ; les deux rosiers de Nicolas
Flamel, voisinant avec la coquille Saint-Jacques et les trois cœurs du célèbre
alchimiste de Bourges, grand argentier de Charles VII.
Nous achèverons ici nos visites aux vieilles demeures
philosophales.
Certes, il nous serait facile de multiplier ces études, car
les exemples décoratifs du symbolisme hermétique appliqué aux constructions
civiles sont encore nombreux aujourd’hui ; nous avons préféré borner notre
enseignement aux problèmes les plus typiques et les mieux caractérisés.
Mais avant de prendre congé de notre lecteur, en le
remerciant pour sa bienveillante attention, nous jetterons un dernier regard
sur l’ensemble de la science secrète. Et, de même que le vieillard, évoquant
volontiers ses souvenirs, s’attarde aux heures saillantes du passé, de même
espérons-nous découvrir, en cet examen rétrospectif, le fait capital, objet des
préoccupations essentielles du véritable fils d’Hermès.
Ce point important, où se trouvent concentrés les éléments
et les principes des plus hautes connaissances, ne saurait être recherché ni
rencontré dans la vie, puisque la vie est en nous, qu’elle rayonne autour de
nous, qu’elle nous est familière et qu’il nous suffit de savoir observer pour
en saisir les manifestations variées. C’est dans la mort que nous pouvons le
reconnaître, dans ce domaine invisible de la spiritualité pure, où l’âme,
libérée de ses liens, se réfugie à la fin de son périple terrestre ; c’est dans le néant, ce rien mystérieux qui contient tout,
absence où règne toute présence, qu’il convient de retrouver les causes dont la
vie nous montre les multiples effets.
Aussi, est-ce au moment où se déclare l’inertie corporelle,
à l’heure même où la nature termine son labeur, que le sage commence le sien.
Penchons-nous donc sur l’abîme, scrutons-en la profondeur, fouillons les
ténèbres qui le comblent, et le néant nous instruira. La naissance apprend peu
de chose, mais la mort, d’où naît la vie, peut tout nous révéler. Elle seule
détient les clefs du laboratoire de la nature ; elle seule délivre l’esprit,
emprisonné au centre du corps matériel. Ombre dispensatrice de la lumière,
sanctuaire de la vérité, asile inviolé de la sagesse, elle cache et dérobe
jalousement ses trésors aux mortels timorés, aux indécis, aux sceptiques, à
tous ceux qui la méconnaissent ou n’osent point l’affronter.
Pour le philosophe, la mort est simplement la cheville
ouvrière qui joint le plan matériel au plan divin. C’est la porte terrestre
ouverte sur le ciel, le trait d’union entre la nature et la divinité ; c’est la
chaîne reliant ceux qui sont encore à ceux qui ne sont plus. Et, si l’évolution
humaine, en son activité physique, peut à son gré disposer du passé et du
présent, en revanche c’est à la mort seule qu’appartient l’avenir.
En conséquence, loin d’inspirer au sage un sentiment
d’horreur ou de répulsion, la mort, instrument de salut, lui apparaît-elle
désirable parce qu’utile et nécessaire. Et s’il ne nous est point permis
d’abréger nous-mêmes le temps fixé par notre destin propre, du moins avons-nous
reçu licence de l’Éternel de la provoquer dans la matière grave, soumise, selon
les ordres de Dieu, à la volonté de l’homme.
On comprend ainsi pourquoi les philosophes insistent tant
sur la nécessité absolue de la mort matérielle. C’est par elle que l’esprit,
impérissable et toujours agissant, brasse, crible, sépare, nettoie et purifie
le corps. C’est d’elle qu’il tient la possibilité d’en assembler les parties
mondées, de construire avec elles son nouveau logis, de transmettre enfin à la
forme régénérée une énergie qu’elle ne possédait pas.
Considérée au point de vue de son action chimique sur les
substances des trois règnes, la mort est nettement caractérisée par la
dissolution intime, profonde et radicale des corps. C’est pourquoi la
dissolution, appelée mort par les
vieux auteurs, s’affirme comme étant la première et la plus importante des
opérations de l’Œuvre, celle que l’artiste doit s’efforcer de réaliser avant
toute autre. Celui qui découvrira l’artifice de la véritable dissolution et
verra s’accomplir la putréfaction consécutive, aura en son pouvoir le plus
grand secret du monde. Il possédera également un moyen sûr d’accéder aux
sublimes connaissances. Tel est le point important, ce pivot de l’art, suivant
l’expression même de Philalèthe, que nous désirions signaler aux hommes de
bonne foi, aux chercheurs bénévoles et désintéressés.
Or, par le fait qu’ils sont voués à la dissolution finale,
tous les êtres doivent nécessairement en retirer un bénéfice semblable. Notre
globe lui-même ne saurait échapper à cette loi inexorable. Il a son temps
prévu, comme nous avons le nôtre. La durée de son évolution est ordonnée,
réglée d’avance et strictement limitée. La raison le démontre, le bon sens le
pressent, l’analogie l’enseigne, l’Écriture nous le certifie : Dans le bruit
d’une effroyable tempête, le ciel et la terre passeront…
Pendant un temps, des temps et la moitié d’un temps [Daniel,
ch. VII, 25, et XII, 7. Apocal., ch. XII, 14.], la Mort étendra sa domination
sur les ruines du monde, sur les vestiges des civilisations anéanties. Et notre
terre, après les convulsions d’une longue agonie, reprendra l’état confus du
chaos originel. Mais l’Esprit de Dieu flottera sur les eaux. Et toutes choses
seront couvertes de ténèbres et plongées dans le profond silence des sépulcres.
(Fin de la version originale
de 1930 des Demeures Philosophales.
Les chapitres qui suivent ont été introduits dans les éditions ultérieures de
cet ouvrage – Note de L.A.T.)
PARADOXE DU PROGRÈS ILLIMITÉ DES SCIENCES
A tous les philosophes, aux gens instruits quels qu’ils
soient, aux savants spécialisés comme aux simples observateurs, nous nous
permettons de poser cette question :
« Avez vous réfléchi aux conséquences fatales qui
résulteront d’un progrès illimité ? »
Déjà, à cause de la multiplicité des acquisitions scientifiques,
l’homme ne parvient à vivre qu’à force d’énergie et d’endurance, dans une
ambiance d’activité trépidante, enfiévrée et malsaine. Il a créé la machine qui
a centuplé ses moyens et sa puissance d’action, mais il en est devenu l’esclave
et la victime : esclave dans la paix, victime dans la guerre. La distance n’est
plus un obstacle pour lui ; il se transporte avec rapidité d’un point du globe
à l’autre par les voies aérienne, maritime et terrestre. Nous ne voyons pas
cependant que ces facilités de déplacement l’aient rendu meilleur ni plus
heureux ; car si l’adage veut que les voyages forment la jeunesse, ils ne
semblent guère contribuer à raffermir les liens de concorde et de fraternité
qui devraient unir les peuples. Jamais les frontières n’ont été mieux gardées qu’aujourd’hui.
L’homme possède la faculté merveilleuse d’exprimer sa pensée et de faire entendre
sa voix jusqu’aux contrées les plus lointaines, et pourtant ces moyens mêmes
lui imposent de nouveaux besoins. Il peut émettre et enregistrer les vibrations
lumineuses et sonores, sans y gagner autre chose qu’une vaine satisfaction de
curiosité, si ce n’est un assujettissement assez peu favorable à son élévation
intellectuelle. Les corps opaques sont devenus perméables à ses regards, et
s’il lui est possible de sonder la matière grave, en revanche que sait-il de
lui-même, c’est-à-dire de son origine, de son essence et de sa destinée ?
Aux désirs satisfaits succèdent d’autres désirs inassouvis.
Nous y insistons, l’homme veut aller vite, toujours plus vite, et cette
agitation rend insuffisantes les possibilités dont il dispose. Emporté par ses
passions, ses convoitises et ses phobies, l’horizon de ses espoirs recule indéfiniment.
C’est la course éperdue vers l’abîme, l’usure constante, l’activité impatiente,
forcenée, appliquée sans trêve ni repos. « Dans notre siècle, a dit fort
justement Jules Simon, il faut marcher ou courir : celui qui s’arrête est
perdu. » A cette cadence, à ce régime, la santé physique périclite. Malgré la
diffusion et l’observation des règles d’hygiène, des mesures de prophylaxie, en
dépit des innombrables procédés thérapeutiques et de l’amoncellement des
drogues chimiques, la maladie poursuit ses ravages avec une inlassable persévérance.
A telle enseigne que la lutte organisée contre les fléaux connus ne semble avoir
d’autre résultat que d’en faire naître de nouveaux, plus graves et plus
réfractaires.
La nature elle-même donne des signes non équivoque de
lassitude : elle devient paresseuse. C’est à force d’engrais chimiques que le
cultivateur obtient maintenant des récoltes de valeur moyenne. Interrogez un
paysan, il vous dira que « la terre se meurt », que les saisons sont troublées et
le climat modifié. Tout ce qui végète manque de sève et de résistance. Les
plantes dépérissent, — c’est un fait officiellement constaté, — et se montrent
incapables de réagir contre l’envahissement des insectes parasites ou l’attaque
des maladies à mycélium.
Enfin, nous n’apprendrons rien en disant que la plupart des
découvertes, orientées d’abord vers l’accroissement du bien-être humain, sont rapidement
détournées de leur but et spécialement appliquées à la destruction. Les
instruments de paix se changent en engins de guerre, et l’on connaît assez le
rôle prépondérant que la science joue dans les conflagrations modernes. Tel
est, hélas ! l’objectif final, l’aboutissement de l’investigation scientifique
; et telle est aussi la raison pour laquelle l’homme, qui la poursuit dans cette
intention criminelle, appelle sur lui la justice divine et se voit
nécessairement condamné par elle.
Afin d’éviter le reproche, qu’on n’eût pas manqué de leur
adresser, de pervertir les peuples, les Philosophes refusèrent toujours
d’enseigner clairement les vérités qu’ils avaient acquises ou reçues de
l’antiquité. Bernardin de Saint-Pierre montre qu’il connaissait cette règle de
sagesse lorsqu’il déclare, à la fin de sa Chaumière
Indienne : « On doit chercher la vérité avec un coeur simple ; on la
trouvera dans la nature ; on ne doit la dire qu’aux gens de bien. » Par
ignorance ou par mépris de cette condition première, l’exotérisme a jeté le
désordre au sein de l’humanité.
Le Règne de l’Homme, prélude du Jugement dernier et de
l’avènement du Cycle nouveau, est exprimé symboliquement en un curieux tableau
de bois sculpté, conservé à l’église Saint-Sauveur, autrement dite du Chapitre,
de Figeac (Lot). Sous la conception religieuse voilant à peine son évident ésotérisme,
il montre le Christ enfant endormi sur la croix et entouré des instruments de
la Passion (pl. XLI).
 |
| Planche XLI |
Parmi ces attributs du martyre divin, six ont été, à
dessein, réunis en X, de même que la croix où repose le petit Jésus et qui a
été inclinée pour qu’elle donnât cette forme par la perspective. Ainsi,
rappelant les quatre âges, avons-nous quatre X (khi) grecs dont la valeur
numérique de 600 nous fournit, en produit, les 2400 années du monde. On y voit
donc la lance de Longin (Jean, XIX, 34) assemblée au roseau (Matthieu, XXVII,
48 ; Marc, XV, 36) ou tige d’hysope supportant l’éponge imprégnée d’oxycrat
(Jean, XIX, 34) ; puis le faisceau et le flagellum entrecroisés (Jean, XIX, I ;
Matth., XXVII, 26 ; Marc, XV, 15) ; enfin, le marteau qui servit à enfoncer les
clous de la crucifixion et les tenailles utilisées pour les arracher après la
mort du Sauveur.
Triple image du dernier rayonnement, formule graphique du
spiritualisme déclinant, ces X marquent de leur empreint la seconde période cyclique,
à la fin de laquelle l’humanité se débat dans les ténèbres et la confusion,
jusqu’au jour de la grande révolution terrestre et de la mort libératrice. Si
nous réunissons ces trois croix en sautoir et si nous plaçons le point
d’intersection de leurs branches sur un axe commun, nous obtiendrons une figure
géométrique à douze rayons, symbolisant les douze siècles qui constituent le
Règne du Fils de l’Homme et qui succèdent aux douze précédents du Règne de
Dieu.
Quand le peuple parle de la fin du monde, il évoque et traduit généralement l’idée d’un cataclysme
universel, entraînant à la fois la ruine totale du globe et l’extermination de
ses habitants. Selon cette opinion, la terre, rayée du nombre des planètes,
cesserait d’exister. Ses débris, projetés dans l’espace sidéral, tomberaient en
pluie d’aérolithes sur les mondes proches du nôtre.
Certains penseurs, plus logiques, prennent l’expression dans
un sens moins étendu. A leur avis, la perturbation ne saurait atteindre que
l’humanité seule. Il leur semble impossible d’admettre que notre planète
disparaisse, bien que tout ce qui vit, se meut et gravite à se surface soit
condamné à périr. Thèse platonicienne qui pourrait être acceptable si elle ne
comportait l’introduction irrationnelle d’un facteur prodigieux : l’homme rénové
naissant directement du sol, à la façon d’un simple végétal et sans semence
préalable.
Ce n’est pas ainsi qu’il convient d’entendre la fin du
monde, telle qu’elle nous est annoncée par l’Ecriture et que nous la rapportent
les traditions primitives, à quelques races qu’elles appartiennent. Lorsque,
pour punir l’humanité de ses crimes, Dieu résolut de l’ensevelir sous les eaux du
déluge, non seulement la terre n’en fut affectée qu’à la surface, mais un
certain nombre d’hommes justes et d’élus, ayant trouvé grâce devant Lui, survécurent
à l’inondation.
Quoique présenté sous des dehors symboliques, cet
enseignement repose sur une base positive. Nous y reconnaissons la nécessité
physique d’une régénération animale et terrestre, qui ne peut donc entraîner
l’anéantissement total des créatures, ni supprimer aucune des conditions
indispensables à la vie du noyau sauvegardé. Dès lors, malgré le terrifiant et
long brassage des éléments déchaînés, nous sommes assurés que l’immense catastrophe
n’agira point également partout, ni sur toute l’étendue des continents et des
mers. Certaines contrées privilégiées, véritables arches rocheuses, abriteront
les hommes qui s’y seront réfugiés. Là, durant un jour, long de deux siècles, des
générations assisteront, — spectateurs angoissés des effets de la puissance
divine, — au duel gigantesque de l’eau et du feu ; là, dans un calme relatif,
sous une température uniforme, à la clarté pâle et constante d’un ciel bas, le
peuple élu attendra que la paix soit faite, que les dernières nuées, dispersées
au souffle de l’âge d’or, lui découvre la magie polychrome du double arc-en-ciel,
l’éclat de nouveaux cieux et le charme d’une
nouvelle terre…
Pour nous, qui n’avons jamais retenu les arguments du
rationalisme, nous estimons que le déluge mosaïque est incontestable et réel.
Nous savons, d’ailleurs, combien la Bible est supérieure aux autres livres,
combien elle demeure le Livre éternel, immuable, le Livre cyclique par excellence,
dans lequel, sous le voile parabolique, la révélation de l’histoire humaine est
scellée, en deçà et au-delà même des propres annales des peuples. C’est le
récit in-extenso du périple qu’accomplit chaque grande génération cyclique. Et
comme l’histoire est un perpétuel recommencement, la Bible, qui en décrit le processus
figuré, restera à jamais la source unique, le recueil véritable des événements
historiques et des révolutions humaines, tant pour les périodes révolues que
pour celles qui se succéderont dans l’avenir.
Notre intention n’est pas d’entreprendre ici une réfutation
des arguments par lesquels les adversaires de la tradition de Moïse ont
contesté l’exactitude de son témoignage, ni de donner ceux par lesquels les
défenseurs de la religion révélée ont établi l’authenticité et l’inspiration
divine de ses livres. Nous essaierons seulement de montrer que le fait du
déluge est attesté par les traditions particulières de tous les peuples, tant
de l’ancien que du nouveau continent.
Les livres sacrés des Hindous et des Iraniens font mention
du déluge. Dans l’Inde, Noé se nomme Vaivaswata ou Satyavrata. Les légendes
grecques parlent d’Ogygès et de Deucalion ; celles de la Chaldée, de Xixouthros
ou Sisouthros ; celles des Péruviens, de Bochica. Selon la cosmogonie
assyrochaldéenne, les hommes, créés par Mardouk, étant devenus méchants, le
conseil des dieux décide de les punir. Un seul homme est juste et, de ce fait,
il est aimé du dieu Ea : c’est Utmapishtim, roi de Babylone. Aussi, Ea
révèle-t-il en songe à Utmapishtim, la venue imminente du cataclysme et le
moyen d’échapper à la colère des dieux. Le Noé babylonien construit donc une
arche et s’y enferme avec tous les siens, sa famille, ses serviteurs, les artisans
constructeurs de la nef et tout un troupeau de bétail. Aussitôt, les ténèbres
envahissent le ciel. Les eaux de l’abîme tombent et recouvrent la terre.
L’arche d’Utmapishtim vogue pendant sept jours et s’arrête enfin sur le sommet
d’une montagne. Le juste sauvé lâche une colombe et une hirondelle, lesquelles
reviennent vers la barque, puis un corbeau qui ne revient pas. Alors il sort de
l’arche et offre un sacrifice aux dieux. Pour les Aztèques et autre tribus qui
habitaient le plateau du Mexique, c’est Coxcox ou Tezpi qui tient le rôle du
Noé biblique…
Le déluge mosaïque eut
la même importance, la même étendue, les mêmes répercussions que toutes les inondations
qui le précédèrent. C’est en quelque sorte, la description type des catastrophes
périodiques provoquées par le renversement des pôles. C’est donc
l’interprétation schématisée des déluges successifs dont Moïse avait sans doute
la connaissance, soit qu’il ait été le témoin oculaire de l’un d’eux, — ce qui
justifierait son propre nom, — soit qu’il l’ait obtenu par révélation divine. L’arche
salvatrice nous semble représenter le lieu géographique où se rassemblent les
élus à l’approche de la grande perturbation, plutôt qu’une nef fabriquée de
main d’homme. De par sa forme, l’arche se révèle déjà comme une figure cyclique
et non comme un vaisseau véritable. Dans un texte où nous devons surtout, selon
la parole de l’Ecriture, considérer l’esprit de préférence à la lettre, il nous
est impossible de prendre, au sens littéral, la construction du navire, la
recherche de « tous les animaux purs et impurs » et leur réunion par couples.
Une calamité qui impose pendant deux siècles, à des êtres vivants et libres, des
conditions si différentes d’habitat, si contraires à leurs besoins, dépasse les
limites de notre raison. Il ne faut pas oublier que, durant toute l’épreuve, l’hémisphère,
livré à l’afflux des eaux, est plongé dans l’obscurité la plus totale. Il
convient de savoir, en effet, que Moïse parle de jours cycliques, dont la
valeur secrète équivaut aux années courantes. Précisons : il est écrit que la pluie
diluvienne dure quarante jours et que les eaux recouvrent la terre l’espace de
cent cinquante jours, soit cent quatre vingt dix jours au total. Dieu fait
alors souffler un vent chaud, et le niveau de la nappe liquide s’abaisse.
L’arche atterrit sur le mont Ararat [En grec Arara
ou Arhra, parfait d’ ararjsci, signifie être attaché,
fixe, arrêté, ferme, immuable], en Arménie. Noé ouvre la fenêtre (le retour de
la lumière) et libère un corbeau qui, retenu par les cadavres, ne revient pas.
Il donne ensuite l’essor à la colombe qui rentre aussitôt dans l’arche, car à
ce moment les arbres étaient encore submergés. Le patriarche attend donc sept
jours et fait de nouveau sortir l’oiseau, lequel revient vers le soir en
rapportant un rameau vert d’olivier. Le déluge était fini. Il avait duré cent
quatre-vingt-dix-sept jours cycliques, ou, à trois années près, deux siècles réels.
Pouvons-nous admettre qu’un navire, exposé aussi longtemps à
la tourmente, soit capable de lui résister ? Et que penser, d’autre part, de sa
cargaison ? Ces invraisemblances ne sauraient malgré tout ébranler notre
conviction. Nous tenons donc le rapport mosaïque pour véritable et positif quant
au fond, c’est-à-dire au fait même du déluge ; mais la plupart des
circonstances qui l’accompagnent, celles surtout qui ont trait à Noé, à
l’arche, à l’entrée et à la sortie des animaux, sont nettement allégoriques. Le
texte renferme un enseignement ésotérique de portée considérable. Notons
simplement que Noé, qui a la valeur cabalistique de Noël (en grec Nie), est une contraction de Neow-Hljow, le nouveau soleil. L’arche, Arch, indique le commencement d’une ère nouvelle. L’arc-en-ciel marque
l’alliance que Dieu fait avec l’homme dans le cycle qui s’ouvre ; c’est la
symphonie renaissante ou renouvelée : Sυμφωνία, consentement, accord,
union, pacte. C’est aussi la Ceinture d’Iris (Zinh),
la zone privilégiée…
L’Apocalypse d’Esdras nous renseigne sur la valeur
symbolique des livres de Moïse : « Le troisième jour, tandis que j’étais sous
un arbre, une voix m’arriva du côté de cet arbre, me disant : Esdras, Esdras ! je répondis : Me voici ; je me levai et me dressai. La
voix reprit : J’ai apparu à Moïse et je lui ai parlé du buisson, alors que mon
peuple était esclave en égypte, je le conduisis au mont Sinaï et je l’établis
longtemps près de moi. Je lui raconté beaucoup de merveilles ; je lui enseignai
le mystère des jours ; je lui fis connaître les derniers temps, et je lui
donnai cet ordre : Raconte ceci, cache
cela. » [René Basset, Apocryphes
Ethiopiens. Paris, Bibliothèque de la Haute-Science, 1899, ch. XIV, v. 1 à
6.]
Mais, si nous envisageons seulement le fait du déluge, nous
serons amenés à reconnaître qu’un tel cataclysme a dû laisser des traces
profondes de son passage, et modifier quelque peu la topographie des continents
et des mers. Ce serait une grave erreur de croire que le profil géographique de
celles-ci et de ceux-là, leur situation réciproque, leur répartition à la
surface du globe, étaient semblables il y a tout au plus vingt-cinq siècles, à
ce qu’ils sont aujourd’hui. Aussi, malgré notre respect pour les travaux des
savants qui se sont occupés des temps préhistoriques, devons-nous n’accepter
qu’avec la plus grande réserve les cartes de l’époque quaternaire reproduisant
la configuration actuelle du globe. Il est évident, par exemple, que fut
longtemps submergée une partie du sol français, recouverte de sable marin, abondamment
pourvue de coquillages, de calcaires aux empreintes d’ammonites. Rappelons
également que l’île de Jersey se trouvait encore soudée au Cotentin en 709,
année où les eaux de la Manche envahirent la vaste forêt qui s’étendait jusqu’à
Ouessant et servait d’abri à de nombreux villages.
L’histoire rapporte que les Gaulois, interrogés à l’égard de
ce qui était capable de leur inspirer le plus de terreur, avaient coutume de
répondre : « Nous ne craignons qu’une chose, c’est que le ciel nous tombe sur
la tête. » Mais cette boutade, que l’on donne pour un gage de hardiesse et de bravoure,
ne cacherait-elle pas une tout autre raison ? Au lieu d’une simple forfanterie,
ne s’agirait-il plutôt du persistant souvenir d’un événement réel ? Qui oserait
affirmer que nos ancêtres ne furent pas les victimes horrifiées du ciel
s’écroulant en formidables cataractes, parmi les ténèbres d’une nuit longue de
plusieurs générations ?
Cette île mystérieuse dont Platon nous a laissé l’énigmatique
description, a-t-elle existé ? Question difficile à résoudre, vu la faiblesse
des moyens que possède la science pour pénétrer le secret des abysses.
Toutefois, certaines constatations paraissent donner raison aux partisans de la
réalité atlantéenne. En effet, des sondages, opérés dans l’océan atlantique,
ont permis de remonter à la surface des fragments de lave dont la structure
prouve irréfutablement qu’elle a cristallisé à l’air. Il semble donc que les volcans
éjecteurs de cette lave s’élevaient alors sur des terres non encore englouties.
On a cru découvrir aussi un argument propre à justifier l’assertion des prêtres
égyptiens et le récit de Platon, dans cette particularité que la flore de l’Amérique
centrale se montre semblable à celle du Portugal ; les mêmes espèces végétales,
transmises par le sol, indiqueraient une relation continentale étroite entre
l’ancien et le nouveau monde. Nous ne voyons rien d’impossible, quant à nous, à
ce que l’Atlantide ait pu tenir une place importante parmi les régions
habitées, ni que la civilisation s’y soit développée jusqu’à atteindre ce haut
degré que Dieu paraît avoir fixé comme terme au progrès humain : « Tu n’iras
pas plus loin ». Limite au-delà de laquelle les symptômes de la décadence se manifestent,
la chute s’accentue, lorsque la ruine n’est pas précipitée par l’irruption
soudaine d’un fléau imprévu.
La foi en la véracité des oeuvres de Platon entraîne la
croyance à la réalité des bouleversements périodiques dont le déluge mosaïque,
nous l’avons dit, demeure le symbole écrit et le prototype sacré. Aux négateurs
de la confidence que les prêtres d’Egypte firent à Solon, nous demanderons
seulement de bien vouloir nous expliquer ce qu’entend révéler le maître d’Aristote,
par cette fiction de caractère sinistre. Nous pensons, en effet, qu’il est hors
de doute que Platon s’est fait le propagateur de vérités anciennes, et que,
conséquemment, ses livres renferment tout un ensemble, un corps de connaissances
cachées. Son Nombre géométrique, sa Caverne ont leur signification ; pourquoi
le mythe de l’Atlantide n’aurait-il pas la sienne ?
L’Atlantide dut subir le sort commun, et la catastrophe qui
la submergea relève, évidemment, d’une cause identique à celle qui ensevelit, quarante-huit
siècles plus tard, sous une profonde nappe d’eau, l’Egypte, le Sahara et les
contrées de l’Afrique septentrionale. Mais plus favorisée que la terre des
Atlantes, l’Egypte bénéficia d’un relèvement du fond sous-marin et revint au
jour, après un certain temps d’immersion. Car l’Algérie et la Tunisie, avec
leurs chotts desséchés et tapissés d’une épaisse couche de sel ; le Sahara et l’Egypte,
avec leur sol constitué en majeure partie de sable marin, montrent que les
flots ont envahi et recouvert de vastes étendues du continent africain. Les colonnes
des temples pharaoniques portent des traces indéniables d’immersion ; dans les
salles hypostyles, les dalles, encore existantes, qui en forment les plafonds,
ont été soulevées et déplacées sous l’influence oscillatoire des vagues ; la
disparition du revêtement extérieur des pyramides et, en général, celle des joints
de pierres (colosses de Memnon, jadis chantants) ; les traces évidentes de
corrosion par les eaux qu’on remarque sur le sphinx de Gizeh, ainsi que sur
quantité d’autres oeuvres de la statuaire égyptienne, n’ont pas d’autre
origine. Il est probable, d’ailleurs, que la caste sacerdotale n’ignorait pas
le sort qui était réservée à leur patrie. C’est peut-être la raison pour
laquelle les hypogées royaux étaient profondément taillés dans le roc et leurs
ouvertures hermétiquement scellées. Ne pourrait-on même reconnaître l’effet de
cette croyance en un déluge futur, dans l’obligatoire traversée que l’âme du
défunt devait accomplir après la mort corporelle, et qui justifiait la présence,
parmi tant d’autres symboles, de ces petites barques gréées, flottilles en
réduction qui font partie du mobilier funéraire des momies dynastiques ?
Quoi qu’il en soit, le texte d’Ezéchiel [Ch. XXXII,
Lamentation sur l’Egypte (v. 7, 8, 9 et 15)], qui annonce la disparition de
l’Egypte, est formel et ne peut prêter à aucune équivoque :
« … je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera
plus sa lumière. Je ferai obscurcir sur toi tous les astres qui donnent la
lumière dans les cieux, et je mettrai les ténèbres sur ton pays, dit le
Seigneur, l’Eternel. Et je ferai que le cœur de plusieurs peuples frémira,
quand j’aurai fait venir la nouvelle de ta ruine parmi les nations, dans les
pays que tu n’as point connus… Quand j’aurai réduit le pays d’Egypte en
désolation, et que le pays aura été dénué de ce dont il était rempli, quand
j’aurai frappé tous ceux qui y habitent, alors ils sauront que je suis
l’Eternel. »
L’histoire cyclique s’ouvre, au VIe chapitre de la Genèse,
par le récit du Déluge ; elle s’achève, au XXe de l’Apocalypse, dans les
flammes ardentes du Jugement dernier. Moïse, sauvé des eaux, écrit le premier ;
saint Jean, figure sacrée de l’exaltation solaire, ferme le livre par les
sceaux du feu et du soufre.
On peut admirer à Melle (Deux-Sèvres), le chevalier mystique
dont parle le visionnaire de Pathmos, qui doit venir dans la plénitude de la
lumière et surgir du feu, à la manière d’un pur esprit (pl. XLII).
 |
| Planche XLII |
Sous une arcade en plein cintre, à l’église Saint-Hilaire, c’est
une grave et noble statue qui, au-dessus du porche nord, se trouvera
implacablement torréfiée, par le soleil arrêté dans sa course, durant les jours
interminables de la grande colère. L’arc et la couronne lui sont remis au
milieu de l’ineffable gloire divine, dont l’éclat fulgurant consume tout ce
qu’il illumine. Si notre cavalier ne montre point l’arme symbolique, il est
coiffé, néanmoins, du signe de toute royauté. Son attitude rigide, sa haute
stature annoncent la puissance, mais l’expression de sa physionomie semble empreinte
de quelque tristesse. Ses traits le rapprochent singulièrement du Christ, du
Roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de ce Fils de l’Homme que, jamais, au
rapport de Lentulus, on ne vit rire, bien qu’on l’eût vu souvent pleurer. Et nous
comprenons que ce n’est pas sans mélancolie qu’il revient ici-bas, aux lieux de
sa Passion, lui, l’éternel envoyé de son Père, pour imposer, au monde perverti,
l’ultime épreuve et pour « moissonner », impitoyablement, l’humanité honteuse.
Cette humanité, mûre pour le châtiment suprême, est figurée par le personnage
que le cheval renverse et piétine, sans que le conducteur en marque le plus
léger souci [La statue équestre, que dessina Julien Champagne, au début de
l’été 1919, est maintenant mutilée en partie. Le cavalier a perdu son pied
droit, tandis que le cheval, sans doute sous le même choc, s’est trouvé amputé,
à dextre également, de sa jambe antérieure qu’il levait en piaffant].
Chaque période de douze cents années commence et finit par
une catastrophe ; l’évolution humaine s’étend et se développe entre deux
fléaux. L’eau et le feu, agents de toutes les mutations matérielles, opèrent
ensemble, pendant le même temps et chacun sur une région terrestre opposée. Et,
comme le déplacement solaire, — c’est-à-dire l’ascension de l’astre au zénith
du pôle, — reste le grand moteur de cette conflagration élémentaire, il en
résulte que le même hémisphère est, alternativement, submergé à la fin d’un
cycle et calciné au terme du cycle suivant. Pendant que le sud est soumis aux
ardeurs conjuguées du soleil et du feu terrestre, le nord subit l’affusion
constant des eaux méridionales, vaporisées au sein de la fournaise, puis
condensées en nuages énormes, sans cesse refoulés. Or, au précédent cycle,
puisque les eaux du déluge noyèrent notre hémisphère septentrional, nous devons
penser que les flammes du Jugement dernier le consumeront, aux jours extrêmes
de celui-ci.
Il faut attendre avec sang-froid l’heure suprême ; celle du
châtiment pour beaucoup, du martyre pour quelques uns.
De manière succincte, mais fort claire, le grand initié
chrétien saint Pierre relève exactement la différence offerte par les deux
cataclysmes se succédant sur un même hémisphère, c’est-à-dire sur le nôtre,
pour le cas présent : « Sachez, avant toutes choses, qu’aux derniers jours il
viendra des moqueurs et des imposteurs, marchant selon leurs propres
convoitises, qui diront : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que
nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de
la création. Mais c’est par une ignorance volontaire qu’ils ne considèrent pas
que les cieux furent faits d’abord par la parole de Dieu, aussi bien que la
terre qui sortit du sein de l’eau, et qui subsiste au milieu de l’eau ; et que
ce fut par ces choses mêmes que le monde d’alors périt, étant submergé par le
déluge des eaux. Or, les cieux et la terre d’à présent sont gardés avec soin
par la même parole, et sont réservées pour être brûlées par le feu, au jour du
jugement et de la ruine des impies… Or, comme un larron vient durant la nuit,
aussi le jour du Seigneur viendra tout d’un coup ; et alors, dans le bruit
d’une effroyable tempête, les cieux passeront, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre sera brûlée avec tout ce qu’elle contient… Car nous attendons,
selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la
justice habitera [Second Epître, III.]. »
L’obélisque de Dammartin-sous-Tigeaux (Seine-et-Marne) est
l’image sensible, expressive, absolument conforme à la tradition, de la double calamité
terrestre, de l’embrasement et du déluge, au jour terrible du dernier Jugement
(pl. XLIII).
 |
| Planche XLIII |
Erigé sur un tertre, au point culminant de la forêt de Crécy
(altitude : 134 mètres), l’obélisque domine les environs, et, par la trouée des
voies forestières, s’aperçoit de très loin. Son emplacement fut d’ailleurs
admirablement choisi. Il occupe le centre d’un carrefour géométriquement
régulier, formé par l’intersection de trois routes qui lui donnent l’aspect
rayonnant d’une étoile à six branches [L’agréable décor qui ceinture
l’obélisque et qui est maintenant hérissé de poteaux et de plaques, s’offre en
exemple frappant des fantaisies d’un urbanisme trop souvent absurde et
tracassier].
Ainsi ce monument apparaît-il édifié sur le plan de
l’hexagramme antique ; figure composée du triangle de l’eau et de celui du feu,
laquelle sert de signature au Grand OEuvre physique et à son résultat, la
Pierre Philosophale.
L’ouvrage, de belle allure, se compose de trois parties
distinctes : un socle robuste, oblong, à section carrée et angles arrondis ; un
fût constitué par une pyramide quadrangulaire aux arêtes chanfreinées ; enfin,
un amortissement dans lequel se trouve concentré tout l’intérêt de la construction.
Il montre, en effet, le globe terrestre livré aux forces réunies de l’eau et du
feu. Reposant sur les vagues de la mer en furie, la sphère du monde, frappée au
pôle supérieur, par le soleil dans son retournement hélicoïdal, s’embrase et
projette des éclairs et des foudres. C’est là, nous l’avons dit, la figuration
saisissante de l’incendie et de l’inondation immenses, également purificateurs
et justiciers.
Deux faces de la pyramide sont orientées exactement selon
l’axe nord-sud de la route nationale. Sur le côté méridional, on remarque l’image
d’un vieux chêne sculpté en bas-relief. D’après M. Pignard-Péguet [Histoire générale illustrée des
Départements. Seine-et-Marne. Orléans, Auguste Goût et Cie, 1911, p. 249.],
ce chêne surmontait « une inscription latine » aujourd’hui martelée. Les autres
faces portaient, gravées en creux, un sceptre sur l’une, une main de justice
sur l’autre, un médaillon aux armes du roi sur la dernière.
Si nous interrogeons le chêne de pierre, il peut nous
répondre que les temps sont proches, parce qu’il en est le présage figuré.
C’est l’éloquent symbole de notre période de décadence et de perversion ; et
l’initié, à qui nous devons l’obélisque, eut soin de choisir le chêne pour frontispice
de son oeuvre, en manière de prologue cabalistique chargé de situer, dans le temps,
l’époque néfaste de la fin du monde. Cette époque, qui est la nôtre, a ses
caractéristiques clairement indiquées dans le vingt-quatrième chapitre de
l’Evangile selon saint Matthieu c’est-à-dire selon la Science : « On entendra
parler de guerres et de bruits de guerre… Il y aura des tremblements de terre,
des pestes, des famines… Mais ce ne sera que le commencement des douleurs. »
Ces secousses géologiques fréquentes, accompagnées de modifications
climatériques inexplicables, dont les conséquences se propagent dans les
peuples qu’elles émeuvent et parmi les sociétés qu’elles troublent, sont
symboliquement exprimées par le chêne. Ce mot, chuinté dans sa prononciation
française, correspond phonétiquement au grec Cen,
Khen, et désigne l’oie vulgaire. Le vieux chêne prend, de ce fait, la même
valeur que l’expression vieille oie et le sens secret de vieille loi,
annonciatrice du retour de l’ancienne Alliance ou du Règne de Dieu.
Les Contes de ma mère l’Oie (loi mère, loi première) sont
des récits hermétiques où la vérité ésotérique se mêle au décor merveilleux et légendaire
des Saturnales, du Paradis ou de l’Age d’or.
Dans la période de l’âge d’or, l’homme, rénové, ignore toute
religion. Il rend seulement grâces au Créateur, dont le soleil, sa plus sublime
création, lui semble refléter l’image ardente, lumineuse et bienfaisante. Il
respecte, honore et vénère Dieu dans ce globe radiant qui est le cœur et le
cerveau de la nature et le dispensateur des biens de la terre. Représentant
visible de l’Eternel, le soleil est aussi le témoignage sensible de sa puissance,
de sa grandeur et de sa bonté. Au sein du rayonnement de l’astre, sous le ciel
pur d’une terre rajeunie, l’homme admire les oeuvres divines, sans
manifestations extérieures, sans rites et sans voiles. Contemplatif, ignorant
le besoin, le désir et la souffrance, il garde au Maître de l’univers cette reconnaissance
émue et profonde que possèdent les âmes simples, et cette affection sans borne liant
le fils à son Père. L’âge d’or, âge solaire par excellence, a pour symbole
cyclique l’image même de l’astre, hiéroglyphe employé de tout temps par les
anciens alchimistes, afin d’exprimer l’or métallique ou soleil minéral. Sur le
plan spirituel, l’âge d’or est personnifié par l’évangéliste saint Luc. Le grec
Loucaw,
lumière, lampe, flambeau (latin lux, lucis), nous porte à considérer l’Evangile
selon saint Luc, comme l’Evangile selon la lumière. C’est l’Evangile solaire
qui traduit, ésotériquement, le trajet de l’astre et celui de ses rayons,
revenus à leur premier état de splendeur. Il marque le début d’une ère
nouvelle, l’exaltation du pouvoir radiant sur la terre régénérée et le recommencement
de l’orbe annuel et cyclique (Lucabaw, dans les inscriptions grecques, signifie année).
Saint Luc a pour attribut le taureau ou boeuf ailé, figure solaire
spiritualisée, emblème du mouvement vibratoire, lumineux et ramené aux conditions
possibles d’existence et de développement des êtres animés.
Ce temps heureux et béni de l’âge d’or, pendant lequel
vécurent Adam et Eve dans l’état de simplicité et d’innocence, est désigné sous
le nom de Paradis terrestre. Le mot
grec Paradejsow, paradis,
semble provenir de la racine persane ou chaldaïque Pardès, qui veut dire jardin délicieux. Du moins est-ce dans ce
sens que nous le trouvons employé par les auteurs grecs, — Xénophore et Diodore
de Sicile en particulier, — pour qualifier les magnifiques jardins que
possédaient les rois de Perse. La même signification est appliquée par les Septante,
dans leur traduction de la Genèse (ch. II, v. 8), au séjour merveilleux de nos
premiers parents. On a voulu rechercher sur quelle portion géographique du
globe, Dieu avait placé cet Eden au cadre enchanteur. Les hypothèses ne s’accordent
guère entre elles sur ce point ; aussi, certains écrivains, comme Philon le
Juif et Origène, tranchent-ils le débat en prétendant que le Paradis terrestre,
tel que le décrit Moïse, n’a jamais eu d’existence réelle. Selon eux, il
conviendrait d’entendre au sens allégorique tout ce qu’en rapporte l’Ecriture
sainte.
Au demeurant, nous considérons comme exactes toutes les
descriptions qui ont été faites du Paradis terrestre, ou, si l’on préfère, de
l’âge d’or ; mais nous ne nous arrêterons pas aux différentes thèses visant à
prouver que l’espace de refuge, habité par nos ancêtres, se trouvait localisé
en une contrée bien définie. Si, à dessein, nous ne précisons pas où elle se
situait, c’est uniquement pour la raison que, lors de chaque révolution
cyclique, il n’existe qu’une mince ceinture qui soit respectée et qui reste
habitable sur ses parties terrestres. Nous y insistons cependant, la zone de
salut et de miséricorde se trouve tantôt dans l’hémisphère boréal, au début
d’un cycle, tantôt dans l’hémisphère austral, au début du cycle suivant.
Résumons-nous. La terre, comme tout ce qui vit d’elle, en
elle et par elle, a son temps prévu et déterminé, ses époques évolutives
rigoureusement fixées, établies, séparées par autant de périodes inactives.
Elle est ainsi condamnée à mourir, afin de renaître, et ces existences
temporaires comprises entre sa régénération, ou naissance, et sa mutation, ou
mort, ont été appelées Cycles par la
pluralité des anciens philosophes. Le cycle est donc l’espace de temps qui
sépare deux convulsions terrestres de même ordre, lesquelles s’accomplissent à
l’issue d’une révolution complète de cette Grande Période circulaire, divisée
en quatre époques d’égale durée, qui sont les quatre âges du monde. Ces quatre
divisions de l’existence de la terre se succèdent selon le rythme de celles qui
composent l’année solaire : printemps, été, automne, hiver. Ainsi, les âges cycliques
correspondent aux saisons du mouvement solaire annuel, et leur ensemble a reçu
les dénominations de Grande Période,
Grande Année, et, plus fréquemment encore, de Cycle Solaire.
TABLE DES MATIERES DU TOME SECOND
LE MERVEILLEUX GRIMOIRE DU CHÂTEAU DE DAMPIERRE
I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII
LES GARDES DU CORPS DE FRANÇOIS II
I – II – III – IV – V – VI – VII
LE CADRAN SOLAIRE DU PALAIS HOLYROOD D’ÉDIMBOURG
PARADOXE DU PROGRÈS ILLIMITÉ DES SCIENCES
LE RÈGNE DE L’HOMME
LE DÉLUGE
L’ATLANTIDE
L’EMBRASEMENT
L’ÂGE D’OR