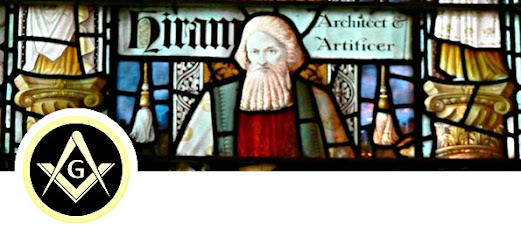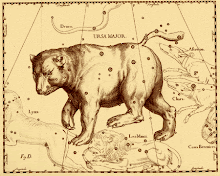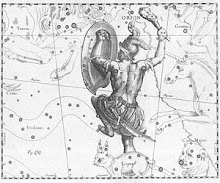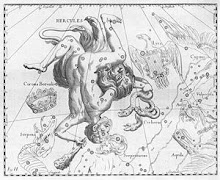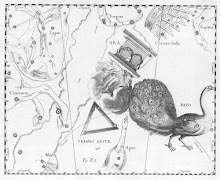FULCANELLI
LE MYSTÈRE DES CATHÉDRALES
ET INTERPRÉTATION ÉSOTÉRIQUE
DES SYMBOLES HERMÉTIQUES
DU GRAND-ŒUVRE
Planches originales de Julien Champagne
TABLE DES MATIÈRES
LE MYSTÈRE DES CATHÉDRALES (I - II - III -IV - V - VI - VII - VIII - IX)
PARIS (I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII)
AMIENS
BOURGES (I - II)
LA CROIX CYCLIQUE D'HENDAYE
CONCLUSION
LE MYSTÈRE DES CATHÉDRALES
La plus forte impression de notre prime jeunesse, – nous avions sept ans, – celle dont nous gardons encore un souvenir vivace, fut l’émotion que provoqua, en notre âme d’enfant, la vue d’une cathédrale gothique. Nous en fûmes, sur-le-champ, transporté, extasié, frappé d’admiration, incapable de nous arracher à l’attrait du merveilleux, à la magie du splendide, de l’immense, du vertigineux que dégageait cette œuvre plus divine qu’humaine.
Depuis, la vision s’est transformée, mais l’impression demeure. Et si l’accoutumance a modifié le caractère prime-sautier et pathétique du premier contact, nous n’avons jamais pu nous défendre d’une sorte de ravissement devant ces beaux livres d’images dressés sur nos parvis, et qui développent jusqu’au ciel leurs feuillets de pierre sculptés.
En quel langage, par quels moyens pourrions-nous leur exprimer notre admiration, leur témoigner notre reconnaissance, tous les sentiments de gratitude dont notre cœur est plein, pour tout ce qu’ils nous ont appris à goûter, à reconnaître, à découvrir même, ces chefs-d’œuvre muets, ces maîtres sans paroles et sans voix ?
Sans paroles et sans voix ? – Que disons-nous ! Si ces livres lapidaires ont leurs lettres sculptées, – phrases en bas-reliefs et pensées en ogives, – ils n’en parlent pas moins par l’esprit, impérissable, qui s’exhale de leurs pages. Plus clairs que leurs frères cadets, – manuscrits et imprimés, – ils possèdent sur eux l’avantage de ne traduire qu’un sens unique, absolu, d’expression simple, d’interprétation naïve et pittoresque, un sens purgé des finesses, des allusions, des équivoques littéraires.
« La langue de pierres que parle cet art nouveau, dit avec beaucoup de vérité J. F. Golfs, est à la fois claire et sublime. Aussi, elle parle à l’âme des plus humbles comme à celle des plus cultivés. Quelle langue pathétique que le gothique de pierres ! Une langue si pathétique, en effet, que les chants d’un Orlande de Lassus ou d’un Palestrina, les œuvres d’orgue d’un Haendel ou d’un Frescobaldi, l’orchestration d’un Beethoven ou d’un Cherubini, et, ce qui est plus grand que tout cela, le simple et sévère chant grégorien, le seul vrai chant peut-être, n’ajoutent que par surcroît aux émotions que la cathédrale cause par elle-même. Malheur à ceux qui n’aiment pas l’architecture gothique, ou, du moins, plaignons-les comme des déshérités du cœur. » [J. F. Golfs, La Filiation Généalogique de toutes les Écoles Gothiques. Paris, Baudry, 1884.]
Sanctuaire de la Tradition, de la Science et de l’Art, la cathédrale gothique ne doit pas être regardée comme un ouvrage uniquement dédié à la gloire du christianisme, mais plutôt comme une vaste concrétion d’idées, de tendances, de foi populaires, un tout parfait auquel on peut se référer sans crainte dès qu’il s’agit de pénétrer la pensée des ancêtres, dans quelque domaine que ce soit : religieux, laïque, philosophique ou social.
Les voûtes hardies, la noblesse des vaisseaux, l’ampleur des proportions et la beauté de l’exécution font de la cathédrale une œuvre originale, d’incomparable harmonie, mais que l’exercice du culte ne paraît pas devoir occuper en entier.
Si le recueillement, sous la lumière spectrale et polychrome des hautes verrières, si le silence invitent à la prière, prédisposent à la méditation, en revanche l’appareil, la structure, l’ornementation dégagent et reflètent, en leur extraordinaire puissance, des sensations moins édifiantes, un esprit plus laïque et, disons le mot, presque païen. On y peut discerner, outre l’inspiration ardente née d’une foi robuste, les mille préoccupations de la grande âme populaire, l’affirmation de sa conscience, de sa volonté propre, l’image de sa pensée dans ce qu’elle a de complexe, d’abstrait, d’essentiel, de souverain.
Si l’on vient à l’édifice pour assister aux offices divins, si l’on y pénètre à la suite des convois funèbres ou parmi le joyeux cortège des fêtes carillonnées, on s’y presse également en bien d’autres circonstances. On y tient des assemblées politiques sous la présidence de l’évêque ; on y discute le prix du grain et du bétail ; les drapiers y fixent le cours des étoffes ; on y accourt pour quérir le réconfort, solliciter le conseil, implorer le pardon. Et il n’est guère de corporations qui n’y fassent bénir le chef-d’œuvre du nouveau compagnon et ne s’y réunissent, une fois l’an, sous la protection de leur saint patron.
D’autres cérémonies, fort attrayantes pour la foule, s’y maintinrent pendant la belle période médiévale. Ce fut la Fête des Fous, – ou des Sages, – kermesse hermétique processionnelle, qui partait de l’église avec son pape, ses dignitaires, ses fervents, son peuple, – le peuple du moyen âge, bruyant, espiègle, facétieux, débordant de vitalité, d’enthousiasme et de fougue, – et se répandait dans la ville… Satire hilarante d’un clergé ignorant, soumis à l’autorité de la Science déguisée, écrasé sous le poids d’une indiscutable supériorité. Ah ! la Fête des Fous, avec son char du Triomphe de Bacchus, traîné par un centaure et une centauresse, nus comme le dieu lui-même, accompagné du grand Pan ; carnaval obscène prenant possession des nefs ogivales ! Nymphes et naïades sortant du bain ; divinités de l’Olympe, sans nuages et sans tutu : Junon, Diane, Vénus, Latone se donnant rendez-vous à la cathédrale pour y entendre la messe ! Et quelle messe ! Composée par l’initié Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, selon un rituel païen, et où les ouailles de l’an 1220 poussaient le cri de joie des bacchanales : Évohé ! Évohé ! – Et les escholiers en délire de répondre :
Hæc est clara dies clararum clara dierum !
Hæc est festa dies festarum festa dierum !
[Ce jour est célèbre parmi les jours célèbres !
Ce jour est jour de fête parmi les jours de fête !]
Ce fut encore la Fête de l’Ane, presque aussi fastueuse que la précédente, avec l’entrée triomphale, sous les arceaux sacrés, de maître Aliboron, dont le sabot foulait, jadis, le pavé juif de Jérusalem. Notre glorieux Christophore y était célébré dans un office spécial où l’on exaltait, après l’épître, cette puissance asine qui a valu à l’Église l’or de l’Arabie, l’encens et la myrrhe du pays de Saba. Parodie grotesque que le prêtre, incapable de comprendre, acceptait en silence, le front courbé sous le ridicule, versé à pleins bords, par ces mystificateurs du pays de Saba, ou Caba, les cabalistes en personne ! Et c’est le ciseau même des maîtres imaigiers du temps qui nous confirme ces curieuses réjouissances. En effet, dans la nef de Notre-Dame de Strasbourg, écrit Witkowski, « le bas-relief d’un des chapiteaux des grands piliers reproduit une procession satirique où l’on distingue un pourceau, porteur d’un bénitier, suivi d’ânes revêtus d’habits sacerdotaux et de singes munis de divers attributs de la religion, ainsi qu’un renard enfermé dans une châsse. C’est la Procession du Renard ou de la Fête de l’Âne ». [G.J. Witkowski, L’Art du profane à l’Église. Étranger. Paris, Schemit, 1908, p. 35.] Ajoutons qu’une scène identique, enluminée, figure au folio 40 du manuscrit n° 5055 de la Bibliothèque nationale.
Ce furent, enfin, ces coutumes bizarres où transparaît un sens hermétique souvent très pur, qui se renouvelaient chaque année et avaient pour théâtre l’église gothique, comme la Flagellation de l’Alleluia, dans laquelle les enfants de chœur chassaient, à grands coups de fouet, leurs sabots [Toupie au profil de Tau ou Croix. En cabale, sabot équivaut à cabot ou chabot, le chat botté des Contes de ma mère l’Oie. La galette de l’Épiphanie contient parfois un sabot au lieu d’une fève.] ronflants hors des nefs de la cathédrale de Langres ; le Convoi de Carême-Prenant ; la Diablerie de Chaumont ; les processions et banquets de l’Infanterie dijonnaise, dernier écho de la Fête des Fous, avec sa Mère Folle, ses diplômes rabelaisiens, son guidon où deux frères, tête-bêche, se plaisent à découvrir leurs fesses ; le singulier Jeu de Pelote, qui se disputait dans le vaisseau de Saint-Étienne, cathédrale d’Auxerre, et disparut vers 1538 ; etc.
II (Le Mystère des Cathédrales)
La cathédrale est le refuge hospitalier de toutes infortunes. Les malades qui venaient, à Notre-Dame de Paris, implorer Dieu pour le soulagement de leurs souffrances, y demeuraient jusqu’à leur guérison complète. On leur affectait une chapelle, située vers la seconde porte, et qui était éclairée par six lampes. Ils y passaient les nuits. Les médecins y donnaient leurs consultations, à l’entrée même de la basilique, autour du bénitier. C’est encore là que la Faculté de médecine, quittant, au XIIIe siècle, l’Université pour vivre indépendante, vint y donner ses assises et s’y fixa jusqu’en 1454, époque de sa dernière réunion, provoquée par Jacques Desparts.
C’est l’asile inviolable des gens poursuivis et le sépulcre des défunts illustres. C’est la cité dans la cité, le noyau intellectuel et moral de l’agglomération, le cœur de l’activité publique, l’apothéose de la pensée, du savoir et de l’art.
Par l’abondante floraison de son ornementation, par la variété des sujets et des scènes qui la parent, la cathédrale apparaît comme une encyclopédie très complète et très variée, tantôt naïve, tantôt noble, toujours vivante, de toutes les connaissances médiévales. Ces sphinx de pierre sont ainsi des éducateurs, des initiateurs au premier chef.
Ce peuple de chimères hérissées, de grotesques, de marmousets, de mascarons, de gargouilles menaçantes, – dragons, stryges et tarasques, – est le gardien séculaire du patrimoine ancestral. L’art et la science, jadis concentrés dans les grands monastères, s’échappent de l’officine, accourent à l’édifice, s’accrochent aux clochers, aux pinacles, aux arcs-boutants, se suspendent aux voussures, peuplent les niches, transforment les vitres en gemmes précieuses, l’airain en vibrations sonores et s’épanouissent sur les portails dans une joyeuse envolée de liberté et d’expression. Rien de plus laïque que l’exotérisme de cet enseignement ; rien de plus humain que cette profusion d’images originales, vivantes, libres, mouvementées, pittoresques, parfois désordonnées, toujours intéressantes ; rien de plus émouvant que ces multiples témoignages de l’existence quotidienne, du goût, de l’idéal, des instincts de nos pères ; rien de plus captivant, surtout, que le symbolisme des vieux alchimistes, habilement traduit par les modestes statuaires médiévaux. À cet égard, Notre-Dame de Paris, église philosophale, est sans contredit l’un des plus parfaits spécimens, et, comme l’a dit Victor Hugo, « l’abrégé le plus satisfaisant de la science hermétique, dont l’église de Saint-Jacques-la-Boucherie était un hiéroglyphe si complet ».
Les alchimistes du XIVe siècle s’y rencontrent, hebdomadairement, au jour de Saturne, soit au grand porche, soit au portail Saint-Marcel, ou encore à la petite Porte-Rouge, toute décorée de salamandres. Denys Zachaire nous apprend que l’usage s’y maintenait encore l’an 1539, « les dimanches et jours de festes », et Noël du Fail dit que « le grand rendez-vous de tels académiques estoit à Nostre-Dame de Paris ». [Noël du Fail, Propos rustiques, baliverneries, contes et discours d’Eutrapel (ch. X). Paris, Gosselin, 1842.]
Là, dans l’éblouissement des ogives peintes et dorées (*), des cordons de voussures, des tympans aux figures multicolores, chacun exposait le résultat de ses travaux, développait l’ordre de ses recherches. On y émettait des probabilités ; on y discutait les possibilités ; on y étudiait sur place l’allégorie du beau livre, et ce n’était pas la partie la moins animée de ces réunions que l’exégèse abstruse des mystérieux symboles.
* [Dans les cathédrales, tout était doré et peint de couleurs vives. Nous avons le texte de Martyrius, évêque et voyageur arménien du XVe siècle, qui en fait foi. Cet auteur dit que le porche de Notre-Dame de Paris resplendissait comme l’entrée du paradis. On y voyait le pourpre, le rose, l’azur, l’argent et l’or. On peut encore apercevoir des traces de dorure au sommet du tympan du grand portail. Celui de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois a conservé ses peintures, sa voûte azurée constellée d’or.]
Après Gobineau de Montluisant, Cambriel et tutti quanti, nous allons entreprendre le pieux pèlerinage, parler aux pierres et les interroger. Hélas ! il est bien tard. Le vandalisme de Soufflot a détruit en grande partie ce qu’au XVIe siècle le souffleur pouvait admirer. Et, si l’art doit quelque reconnaissance aux éminents architectes Toussaint, Geffroy Dechaume, Bœswillwald, Viollet-le-Duc et de Lassus qui restaurèrent la basilique, odieusement profanée par l’École, la Science ne retrouvera jamais ce qu’elle a perdu.
Quoi qu’il en soit, et malgré ces regrettables mutilations, les motifs qui subsistent encore sont assez nombreux pour n’avoir pas à regretter le temps et la peine d’une visite. Nous nous estimerons donc satisfaits et largement payé de notre effort, si nous avons pu éveiller la curiosité du lecteur, retenir l’attention de l’observateur sagace et montrer aux amateurs de l’occulte qu’il n’est pas impossible de retrouver le sens de l’arcane dissimulé sous l’écorce pétrifiée du prodigieux grimoire.
III (Le Mystère des Cathédrales)
Auparavant, il nous faut dire un mot du terme gothique, appliqué à l’art français qui imposa ses directives à toutes les productions du moyen âge, et dont le rayonnement s’étend du XIIe au XVe siècle.
D’aucuns ont prétendu, à tort, qu’il provenait des Goths, ancien peuple de la Germanie ; d’autres ont cru qu’on appelait ainsi cette forme d’art, dont l’originalité et l’extrême singularité faisaient scandale au XVIIe et XVIIIe siècle, par dérision, en lui imposant le sens de barbare : telle est l’opinion de l’École classique, imbue des principes décadents de la Renaissance.
La vérité, qui sort de la bouche du peuple, a pourtant maintenu et conservé l’expression d’Art gothique, malgré les efforts de l’Académie pour lui substituer celle d’Art ogival. Il y a là une raison obscure qui aurait dû porter à réflexion nos linguistiques, toujours à l’affût des étymologies. D’où vient donc que si peu de lexicologues aient rencontré juste ? – De ce fait très simple que l’explication doit en être recherchée dans l’origine cabalistique du mot plutôt que dans sa racine littérale.
Quelques auteurs perspicaces, et moins superficiels, frappés de la similitude qui existe entre gothique et goétique, ont pensé qu’il devait y avoir un rapport étroit entre l’Art gothique et l’Art goétique ou magique.
Pour nous, art gothique n’est qu’une déformation orthographique du mot argotique, dont l’assonance est parfaite, conformément à la loi phonétique qui régit, dans toutes les langues et sans tenir compte de l’orthographe, la cabale traditionnelle. La cathédrale est une œuvre d’art goth ou d’argot. Or, les dictionnaires définissent l’argot comme étant « un langage particulier à tous les individus qui ont intérêt à se communiquer leurs pensées sans être compris de ceux qui les entourent ». C’est donc bien une cabale parlée. Les argotiers, ceux qui utilisent ce langage, sont descendants hermétiques des argo-nautes, lesquels montaient le navire Argo, parlaient la langue argotique, – notre langue verte, – en voguant vers les rives fortunées de Colchos pour y conquérir la fameuse Toison d’or. On dit encore aujourd’hui d’un homme très intelligent, mais aussi très rusé : il sait tout, il entend l’argot. Tous les Initiés s’exprimaient en argot, aussi bien les truands de la Cour des Miracles, – le poète Villon à leur tête, – que les Frimasons, ou francs-maçons du moyen âge, « logeurs du bon Dieu », qui édifièrent les chefs-d’œuvre argotiques que nous admirons aujourd’hui. Eux-mêmes, ces nautes constructeurs, connaissaient la route du Jardin des Hespérides…
De nos jours encore, les humbles, les misérables, les méprisés, les insoumis avides de liberté et d’indépendance, les proscrits, les errants et les nomades parlent l’argot, ce dialecte maudit, banni de la haute société, des nobles qui le sont si peu, des bourgeois repus et bien pensants, vautrés dans l’hermine de leur ignorance et de leur fatuité. L’argot reste le langage d’une minorité d’individus vivant en dehors des lois reçues, des conventions, des usages, du protocole, auxquels on applique l’épithète de voyous, c’est-à-dire de voyants, et celle, plus expressive encore, de Fils ou Enfants du soleil. L’art gothique est, en effet, l’art got ou cot (Χο), l’art de la Lumière ou de l’Esprit.
Ce sont là, pensera-t-on, de simples jeux de mots. Nous en convenons volontiers. L’essentiel est qu’ils guident notre foi vers une certitude, vers la vérité positive et scientifique, clef du mystère religieux, et ne la tiennent pas errante dans le dédale capricieux de l’imagination. Il n’y a, ici-bas, ni hasard, ni coïncidence, ni rapport fortuit ; tout est prévu, ordonné, réglé, et il ne nous appartient pas de modifier à notre gré la volonté imperscrutable du Destin. Si le sens usuel des mots ne nous permet aucune découverte capable de nous élever, de nous instruire, de nous rapprocher du Créateur, le vocabulaire devient inutile. Le verbe, qui assure à l’homme l’incontestable supériorité, la souveraineté qu’il possède sur tout ce qui vit, perd sa noblesse, sa grandeur, sa beauté et n’est plus qu’une affligeante vanité. Or, la langue, instrument de l’esprit, vit par elle-même, bien qu’elle ne soit que le reflet de l’Idée universelle. Nous n’inventons rien, nous ne créons rien. Tout est dans tout. Notre microcosme n’est qu’une particule infime, animée, pensante, plus ou moins imparfaite, du macrocosme. Ce que nous croyons trouver par le seul effort de notre intelligence existe déjà quelque part. C’est la foi qui nous fait pressentir ce qui est ; c’est la révélation qui nous en donne la preuve absolue. Nous côtoyons souvent le phénomène, voire le miracle, sans le remarquer, en aveugles et en sourds. Que de merveilles, que de choses insoupçonnées ne découvririons-nous pas si nous savions disséquer les mots, en briser l’écorce et libérer l’esprit, divine lumière qu’ils renferment ! Jésus ne s’exprimait qu’en paraboles ; pouvons-nous nier la vérité qu’elles enseignent ? Et, dans la conversation courante, ne sont-ce pas des équivoques, des à peu près, des calembours ou des assonances qui caractérisent les gens d’esprit, heureux d’échapper à la tyrannie de la lettre, et se montrant à leur manière cabalistes sans le savoir ?
Ajoutons enfin que l’argot est une des formes dérivées de la Langue des Oiseaux, mère et doyenne de toutes les autres, la langue des philosophes et des diplomates. C’est elle dont Jésus révèle la connaissance à ses apôtres, en leur envoyant son esprit, l’Esprit-Saint. C’est elle qui enseigne le mystère des choses et dévoile les vérités les plus cachées. Les anciens Incas l’appelaient Langue de cour, parce qu’elle était familière aux diplomates, à qui elle donnait la clef d’une double science : la science sacrée et la science profane. Au moyen âge, on la qualifiait de Gaie science ou Gay sçavoir, Langue des dieux, Dive-Bouteille. [La Vie de Gargantua et de Pantagruel, par François Rabelais, est une œuvre ésotérique, un roman d’argot. Le bon curé de Meudon s’y révèle comme un grand initié doublé d’un cabaliste de premier ordre.] La Tradition nous assure que les hommes la parlaient avant l’édification de la tour de Babel [Le tour, la tournure ba employée pour bel.], cause de sa perversion et, pour le plus grand nombre, de l’oubli total de cet idiome sacré. Aujourd’hui, en dehors de l’argot, nous en retrouvons le caractère dans quelques langues locales telles que le picard, le provençal, etc., et dans le dialecte des gypsies.
La mythologie veut que le célèbre devin Tirésias ait eu une parfaite connaissance de la Langue des Oiseaux, que lui aurait enseignée Minerve, déesse de la Sagesse. [Tirésias avait, dit-on, perdu la vue pour avoir dévoilé aux mortels les secrets de l’Olympe. Il vécut pourtant « sept, huit ou neuf âges d’homme » et aurait été successivement homme et femme !] Il la partageait, dit-on, avec Thalès de Milet, Melampus et Apollonios de Tyane (*), personnages fictifs dont les noms parlent éloquemment, dans la science qui nous occupe, et assez clairement pour que nous ayons besoin de les analyser en ces pages.
* [Philosophe dont la vie, bourrée de légendes, de miracles, de faits prodigieux, semble fort hypothétique. Le nom de ce personnage quasi-fabuleux ne nous paraît être qu’une image mytho-hermétique du compost, ou rebis philosophal, réalisé par l’union du frère et de la sœur, de Gabritius et de Beya, d’Apollon et de Diane. Dès lors, les merveilles racontées par Philostrate, étant d’ordre chimique, ne sauraient nous surprendre.]
IV (Le Mystère des Cathédrales)
A de rares exceptions près, le plan des églises gothiques, – cathédrales, abbatiales ou collégiales, – affecte la forme d’une croix latine étendue sur le sol. Or, la croix est l’hiéroglyphe alchimique du creuset, que l’on nommait jadis cruzol, crucible et croiset (dans la basse latinité, crucibulum, creuset, a pour racine crux, crucis, croix, d’après Ducange).
C’est en effet dans le creuset que la matière première, comme le Christ lui-même, souffre la Passion ; c’est dans le creuset qu’elle meurt pour ressusciter ensuite, purifiée, spiritualisée, déjà transformée. D’ailleurs le peuple, gardien fidèle des traditions orales, n’exprime-t-il pas l’épreuve humaine terrestre par des paraboles religieuses et des similitudes hermétiques ? – Porter sa croix, gravir son calvaire, passer au creuset de l’existence sont autant de locutions courantes où nous retrouvons le même sens sous un même symbolisme.
N’oublions pas qu’autour de la croix lumineuse vue en songe par Constantin apparurent ces paroles prophétiques qu’il fit peindre sur son labarum : In hoc signo vinces : tu vaincras par ce signe. Souvenez-vous aussi, alchimistes mes frères, que la croix porte l’empreinte des trois clous qui servirent à immoler le Christ-matière, image des trois purifications par le fer et par le feu. Méditez pareillement ce clair passage de saint Augustin, dans sa Dispute avec Tryphon (Dialogus cum Tryphone, 40) : « Le mystère de l’agneau que Dieu avait ordonné d’immoler à Pâque, dit-il, était la figure du Christ, dont ceux qui croient teignent leurs demeures, c’est-à-dire eux-mêmes, par la foi qu’ils ont en lui. Or, cet agneau, que la loi prescrivait de faire rôtir en entier, était le symbole de la croix que le Christ devait endurer. Car l’agneau, pour être rôti, est disposé de façon à figurer une croix : l’une des branches le traverse de part en part, de l’extrémité inférieure jusqu’à la tête ; l’autre lui traverse les épaules, et l’on y attache les pieds antérieurs de l’agneau (le grec porte : les mains, Χειρες). »
La croix est un symbole fort ancien, employé de tous temps, en toutes religions, chez tous les peuples, et l’on aurait tort de la considérer comme un emblème spécial au christianisme, ainsi que le démontre surabondamment l’abbé Ansault [M. l’abbé Ansault, La Croix avant Jésus-Christ. Paris, V. Rétaux, 1894.]. Nous dirons même que le plan des grands édifices religieux du moyen âge, par adjonction d’une abside semi-circulaire ou elliptique soudée au chœur, épouse la forme du signe hiératique égyptien de la croix ansée, qui se lit ank, et désigne la Vie universelle cachée dans les choses. On en peut voir un exemple au musée de Saint-Germain-en-Laye, sur un sarcophage chrétien provenant des cryptes arlésiennes de Saint-Honorat. D’autre part, l’équivalent hermétique du signe ank est l’emblème de Vénus ou Cypris (en grec Κύπρος, l’impure), le cuivre vulgaire que certains, pour voiler davantage le sens, ont traduit par airain et laiton. « Blanchis le laiton et brûle tes livres », nous répètent tous les bons auteurs. Κύπρος est le même mot que Σουϕρος, soufre, lequel a la signification d’engrais, fiente, fumier, ordure. « Le sage trouvera notre pierre jusque dans le fumier, écrit le Cosmopolite, tandis que l’ignorant ne pourra pas croire qu’elle soit dans l’or. »
Et c’est ainsi que le plan de l’édifice chrétien nous révèle les qualités de la matière première, et sa préparation, par le signe de la Croix ; ce qui aboutit, pour les alchimistes, à l’obtention de la Première pierre, pierre angulaire du Grand-Œuvre philosophal. C’est sur cette pierre que Jésus a bâti son Église ; et les francs-maçons médiévaux ont suivi symboliquement l’exemple divin. Mais avant d’être taillée pour servir de base à l’ouvrage d’art gothique aussi bien qu’à l’œuvre d’art philosophique, on donnait souvent à la pierre brute, impure, matérielle et grossière, l’image du diable.
Notre-Dame de Paris possédait un hiéroglyphe semblable, qui se trouvait sous le jubé, à l’angle de la clôture du chœur. C’était une figure de diable, ouvrant une bouche énorme, et dans laquelle les fidèles venaient éteindre leurs cierges ; de sorte que le bloc sculpté apparaissait souillé de bavures de cire et de noir de fumée. Le peuple appelait cette image Maistre Pierre du Coignet, ce qui ne laissait pas d’embarrasser les archéologues. Or, cette figure, destinée à représenter la matière initiale de l’Œuvre, humanisée sous l’aspect de Lucifer (qui porte la lumière, – l’étoile du matin), était le symbole de notre pierre angulaire, la pierre du coin, la maîtresse pierre du coignet. « La pierre que les édifians ont rejettée, écrit Amyraut, a esté faite la maistresse pierre du coin, sur qui repose toute la structure du bastiment ; mais qui est pierre d’achoppement et pierre de scandale, contre laquelle ils se heurtent à leur ruine. » [M. Amyraut, Paraphrase de la Première Épître de saint Pierre (ch. II, v. 7). Saumur, Jean Lesnier, 1646, p. 27.] Quant à la taille de cette pierre angulaire, – nous entendons sa préparation, – on peut la voir traduite en un fort joli bas-relief de l’époque, sculpté à l’extérieur de l’édifice, sur une chapelle absidiale, du côté de la rue du Cloître-Notre-Dame.
V (Le Mystère des Cathédrales)
Tandis qu’on réservait au tailleur d’imaiges la décoration des parties saillantes, on attribuait au céramiste l’ornementation du sol des cathédrales. Celui-ci était ordinairement dallé, ou carrelé à l’aide de plaques de terre cuite peintes et recouvertes d’un émail plombifère. Cet art avait acquis au moyen âge assez de perfection pour assurer aux sujets historiés une suffisante variété de dessin et de coloris. On utilisait aussi de petits cubes de marbre multicolores, à la manière des mosaïstes byzantins. Parmi les motifs le plus fréquemment employés, il convient de citer les labyrinthes, que l’on traçait sur le sol, au point d’intersection de la nef et des transepts. Les églises de Sens, de Reims, d’Auxerre, de Saint-Quentin, de Poitiers, de Bayeux ont conservé leurs labyrinthes. Dans celui d’Amiens, on remarquait, au centre, une large dalle incrustée d’une barre d’or et d’un demi-cercle de même métal, figurant le lever du soleil au-dessus de l’horizon. On substitua plus tard au soleil d’or un soleil de cuivre, et ce dernier disparut à son tour sans jamais être remplacé. Quant au labyrinthe de Chartres, vulgairement appelé la lieue (pour le lieu), et dessiné sur le pavé de la nef, il se compose d’une grande série de cercles concentriques qui se replient les uns dans les autres avec une infinie variété. Au centre de cette figure se voyait autrefois le combat de Thésée et du Minotaure. C’est encore là une preuve de l’infiltration des sujets païens dans l’iconographie chrétienne et, conséquemment, celle d’un sens mytho-hermétique évident. Cependant, il ne saurait être question d’établir un rapport quelconque entre ces images et les constructions fameuses de l’antiquité, les labyrinthes de Grèce et d’Égypte.
Le labyrinthe des cathédrales, ou labyrinthe de Salomon, est, nous dit Marcellin Berthelot, « une figure cabalistique qui se trouve en tête de certains manuscrits alchimiques, et qui fait partie des traditions magiques attribuées au nom de Salomon. C’est une série de cercles concentriques, interrompus sur certains points, de façon à former un trajet bizarre et inextricable ». [La Grande Encyclopédie. Art. Labyrinthe. T. XXI, p. 703.]
L’image du labyrinthe s’offre donc à nous comme emblématique du travail entier de l’Œuvre, avec ses deux difficultés majeures : celle de la voie qu’il convient de suivre pour atteindre le centre, – où se livre le rude combat des deux natures, – l’autre, du chemin que l’artiste doit tenir pour en sortir. C’est ici que le fil d’Ariane lui devient nécessaire, s’il ne veut errer parmi les méandres de l’ouvrage sans parvenir à en découvrir l’issue.
Notre intention n’est point d’écrire, comme le fit Batsdorff, un traité spécial pour enseigner ce qu’est le fil d’Ariane, qui permit à Thésée d’accomplir son dessein. Mais, en nous appuyant sur la cabale, nous espérons fournir aux investigateurs sagaces quelques précisions sur la valeur symbolique du mythe fameux.
Ariane est une forme d’airagne (araignée), par métathèse de l’i. En espagnol, ñ se prononce gn ; ἀράχνη (araignée, airagne) peut donc se lire arahné, arahni, arahgne. Notre âme n’est-elle pas l’araignée qui tisse notre propre corps ? Mais ce mot se réclame encore d’autres formations. Le verbe αἴρω signifie prendre, saisir, entraîner, attirer ; d’où αιρην, ce qui prend, saisit, attire. Donc, αιρην est l’aimant, la vertu renfermée dans le corps que les Sages nomment leur magnésie. Poursuivons. En provençal, le fer est appelé aran et iran, suivant les différents dialectes. C’est l’Hiram maçonnique, le divin Bélier, l’architecte du Temple de Salomon. L’araignée, chez les félibres, se dit aragno et iragno, airagno ; en picard arègni. Rapprochez tout cela du grec Σίδηρος, fer et aimant. Ce mot a les deux sens. Ce n’est pas tout. Le verbe ἀρύω exprime le lever d’un astre qui sort de la mer : d’où αρυαν (aryan), l’astre qui sort de la mer, se lève ; αρυαν, ou ariane est donc l’Orient, par permutation de voyelles. De plus, ἀρύω a aussi le sens d’attirer ; donc αρυαν est aussi l’aimant. Si maintenant nous rapprochons Σίδηρος, qui a donné le latin sidus, sideris, étoile, nous reconnaîtrons notre aran, iran, airan provençal, l’αρυαν grecque, le soleil levant.
Ariane, l’araignée mystique, échappée d’Amiens, a seulement laissé sur le pavé du chœur la trace de sa toile…
Rappelons, en passant, que le plus célèbre des labyrinthes antiques, celui de Cnossos en Crète, qui fut découvert en 1902 par le docteur Evans, d’Oxford, était appelé Absolum. Or, nous ferons remarquer que ce terme est voisin d’Absolu, qui est le nom par lequel les alchimistes anciens désignaient la pierre philosophale.
VI (Le Mystère des Cathédrales)
Toutes les églises ont leur abside tournée vers le sud-est, leur façade vers le nord-ouest, tandis que les transepts, formant les bras de la croix, sont dirigés du nord-est au sud-ouest. C’est là une orientation invariable, voulue de telle façon que fidèles et profanes, entrant dans le temple par l’occident, marchent droit au sanctuaire, la face portée du côté où le soleil se lève, vers l’Orient, la Palestine, berceau du christianisme. Ils quittent les ténèbres et vont vers la lumière.
Par suite de cette disposition, des trois roses qui ornent les transepts et le grand porche, l’une n’est jamais éclairée par le soleil ; c’est la rose septentrionale, qui rayonne à la façade du transept gauche. La seconde flamboie au soleil de midi ; c’est la rose méridionale ouverte à l’extrémité du transept droit. La dernière s’illumine aux rayons colorés du couchant ; c’est la grande rose, celle du portail, qui surpasse en surface et en éclat ses sœurs latérales. Ainsi se développent, au fronton des cathédrales gothiques, les couleurs de l’Œuvre, selon un processus circulaire allant des ténèbres, – figurées par l’absence de lumière et la couleur noire, – à la perfection de la lumière rubiconde, en passant par la couleur blanche, considérée comme étant « moyenne entre le noir et le rouge ».
Au moyen âge, la rose centrale des porches se nommait Rota, la roue. Or, la roue est l’hiéroglyphe alchimique du temps nécessaire à la coction de la matière philosophale et, par suite, de la coction elle-même. Le feu soutenu, constant et égal que l’artiste entretient nuit et jour au cours de cette opération, est appelé, pour cette raison, feu de roue. Cependant, outre la chaleur nécessaire à la liquéfaction de la pierre des philosophes, il faut, en plus, un second agent, dit feu secret ou philosophique. C’est ce dernier feu, excité par la chaleur vulgaire, qui fait tourner la roue et provoque les divers phénomènes que l’artiste observe dans son vaisseau :
D’aller par ce chemin, non ailleurs, je t’avoue ;
Remarque seulement les traces de ma roue.
Et pour donner partout une chaleur égalle,
Trop tost vers terre et ciel ne monte ny dévalle.
Car en montant trop haut le ciel tu brusleras,
Et devallant trop bas la terre destruiras.
Mais si par le milieu ta carrière demeure,
La course est plus unie et la voye plus seure.
[De Nuysement, Poème philosophic de la Vérité de la Phisique Mineralle, dans Traittez de l’Harmonie et Constitution generalle du Vray Sel. Paris, Périer et Buisard, 1620 et 1621, p. 254.]
La rose représente donc, à elle seule, l’action du feu et sa durée. C’est pourquoi les décorateurs médiévaux ont cherché à traduire, dans leurs rosaces, les mouvements de la matière excitée par le feu élémentaire, ainsi qu’on peut le remarquer sur le portail nord de la cathédrale de Chartres, aux roses de Toul (Saint-Gengoult), de Saint-Antoine de Compiègne, etc. Dans l’architecture des XIVe et XVe siècles, la prépondérance du symbole igné, qui caractérise nettement la dernière période de l’art médiéval, a fait donner au style de cette époque le nom de Gothique flamboyant.
Certaines roses, emblématiques du composé, ont un sens particulier qui souligne davantage les propriétés de cette substance que le Créateur a signée de sa propre main. Ce sceau magique révèle à l’artiste qu’il a suivi le bon chemin, et que la mixtion philosophale a été préparée canoniquement. C’est une figure radiée, à six pointes (digamma), dite Étoile des Mages, qui rayonne à la surface du compost, c’est-à-dire au-dessus de la crèche où repose Jésus, l’Enfant-Roi.
Parmi les édifices qui nous offrent des roses étoilées à six pétales, – reproduction du traditionnel Sceau de Salomon [La convallaire polygonée, vulgairement Sceau de Salomon, doit son appellation à sa tige, dont la section est étoilée comme le signe magique attribué au roi des Israélites, fils de David.], – citons la cathédrale Saint-Jean et l’église Saint-Bonnaventure de Lyon (roses et portails) ; l’église Saint-Gengoult à Toul ; les deux roses de Saint-Vulfran d’Abbeville ; le portail de la Calende à la cathédrale de Rouen ; la splendide rose bleue de la Sainte-Chapelle, etc.
Ce signe étant du plus haut intérêt pour l’alchimiste, – n’est-ce point l’astre qui le guide et lui annonce la naissance du Sauveur ? – on nous saura gré de réunir ici certains textes qui relatent, décrivent, expliquent son apparition. Nous laisserons au lecteur le soin d’établir tous rapprochements utiles, de coordonner les versions, d’isoler la vérité positive combinée à l’allégorie légendaire dans ces fragments énigmatiques.
VII (Le Mystère des Cathédrales)
Varron, dans ses Antiquitates rerum humanarum, rappelle la légende d’Énée, sauvant son père et ses pénates des flammes de Troie, et aboutissant, après de longues pérégrinations, aux champs de Laurente [Cabalistiquement, l’or enté, greffé.], terme de son voyage. Il en donne la raison suivante :
Ex quo de Troja est egressus Æneas, Veneris eum per diem quotidie stellam vidisse, donec ad agrum Laurentum veniret, in quo eam non vidit ulterius ; qua recognovit terras esse fatales. (Depuis son départ de Troie, il vit tous les jours et pendant le jour, l’étoile de Vénus, jusqu’à ce qu’il arrivât aux champs Laurentins, où il cessa de la voir, ce qui lui fit connaître que c’étaient les terres désignées par le Destin.) [Varro, dans Servius, Æneid, t. III, p. 386.]
Voici maintenant une légende extraite d’un ouvrage qui a pour titre le Livre de Seth, et qu’un auteur du VIe siècle relate en ces termes :
« J’ai entendu quelques personnes parlant d’une Écriture qui, quoique peu certaine, n’est pas contraire à la foi et est plutôt agréable à entendre. On y lit qu’il existait un peuple à l’Extrême-Orient, sur les bords de l’Océan, chez lequel il y avait un Livre attribué à Seth, qui parlait de l’apparition future de cette étoile et des présents qu’on devait apporter à l’Enfant, laquelle prédiction était donnée comme transmise par les générations des Sages, de père en fils.
« Ils choisirent douze d’entre eux parmi les plus savants et les plus amateurs des mystères des cieux et se constituèrent pour l’attente de cette étoile. Si quelqu’un d’entre eux venait à mourir, son fils ou le proche parent qui était dans la même attente, était choisi pour le remplacer.
« On les appelait, dans leur langue, Mages, parce qu’ils glorifiaient Dieu dans le silence et à voix basse.
« Tous les ans, ces hommes, après la moisson, montaient sur un mont qui, dans leur langue, s’appelait Mont de la Victoire, lequel renfermait une caverne taillée dans le rocher, et agréable par les ruisseaux et les arbres qui l’entouraient. Arrivés sur ce mont, ils se lavaient, priaient et louaient Dieu en silence pendant trois jours ; c’est ce qu’ils pratiquaient pendant chaque génération, toujours dans l’attente si, par hasard, cette étoile de bonheur ne paraîtrait pas pendant leur génération. Mais à la fin, elle parut sur ce Mont de la Victoire, sous la forme d’un petit enfant, offrant la figure d’une croix ; elle leur parla, les instruisit et leur ordonna de partir pour la Judée.
« L’étoile les précéda ainsi pendant deux ans, et le pain ni l’eau ne manquèrent jamais dans leurs courses.
« Ce qu’ils firent ensuite est rapporté en abrégé dans l’Évangile. » [Opus imperfectum in Mattheum. Hom. II, joint aux Œuvres de saint Jean Chrysostome, Patr. grecque, t. LVI, p. 637.]
La figure de l’étoile serait différente, d’après cette autre légende, d’époque inconnue :
« Durant le voyage, qui dura treize jours, les Mages ne prirent ni repos ni nourriture ; le besoin ne s’en fit pas sentir, et cette période leur sembla n’avoir que la durée d’un jour. Plus ils approchaient de Bethléem, plus l’étoile brillait avec éclat ; elle avait la forme d’un aigle, volant à travers les airs et agitant ses ailes ; au-dessus était une croix. » [Apocryphes, t. II, p. 469.]
La légende suivante, qui a pour titre Des choses qui arrivèrent en Perse, lors de la naissance du Christ, est attribuée à Jules Africain, chronographe du IIIe siècle, bien qu’on ne sache à quelle époque elle appartienne réellement :
« La scène se passe en Perse, dans un temple de Junon (Ηρης), bâti par Cyrus. Un prêtre annonce que Junon a conçu. – Toutes les statues des dieux dansent et chantent à cette nouvelle. – Une étoile descend et annonce la naissance d’un Enfant Principe et Fin. – Toutes les statues tombent le visage contre terre. – Les Mages annoncent que cet Enfant est né à Bethléem et conseillent au roi d’envoyer des ambassadeurs. – Alors paraît Bacchus (Διόνυσος), qui prédit que cet Enfant chassera tous les faux dieux. – Départ des Mages, guidés par l’étoile. Arrivés à Jérusalem, ils annoncent aux prêtres la naissance du Messie. – À Bethléem, ils saluent Marie, font peindre par un esclave habile, son portrait avec l’Enfant et le placent dans leur temple principal avec cette inscription : À Jupiter Mithra (Διι Ηλιω, – au dieu soleil), au Dieu grand, au Roi Jésus, l’empire des Perses fait cette dédicace. » [Julius Africanus, dans Patr. grecque, t. X, p. 97 et 107.]
« La lumière de cette étoile, écrit saint Ignace, surpassait celle de toutes les autres ; son éclat était ineffable, et sa nouveauté faisait que ceux qui la regardaient en étaient frappés de stupeur. Le soleil, la lune et les autres astres formaient le chœur de cette étoile. » [Épître aux Éphésiens, c. XIX.]
Huginus à Barma, dans la Pratique de son ouvrage, emploie les mêmes termes pour exprimer la matière du Grand-Œuvre sur laquelle paraît l’étoile : « Prenez de la vraie terre, dit-il, bien imprégnée des rayons du soleil, de la lune et des autres astres. » [Huginus à Barma, Le Règne de Saturne changé en Siècle d’or. Paris, Derieu, 1780.]
Au IVe siècle, le philosophe Chalcidius, qui, comme le dit Mullachius, le dernier de ses éditeurs, professait qu’il fallait adorer les dieux de la Grèce, les dieux de Rome et les dieux étrangers, a conservé la mention de l’étoile des Mages et l’explication que les savants en donnaient. Après avoir parlé d’une étoile appelée Ahc par les Égyptiens, et qui annonce des malheurs, il ajoute :
« Il y a une autre histoire plus sainte et plus vénérable, qui atteste que par le lever d’une certaine étoile furent annoncés, non des maladies ni des morts, mais la descente d’un Dieu vénérable, pour la grâce de la conversation avec l’homme et pour l’avantage des choses mortelles. Les plus savants des Chaldéens, ayant vu cette étoile en voyageant pendant la nuit, en hommes parfaitement exercés à la contemplation des choses célestes, recherchèrent, à ce que l’on raconte, la naissance récente d’un Dieu, et ayant trouvé la majesté de cet Enfant, ils lui rendirent les vœux qui convenaient à un si grand Dieu. Ce qui vous est beaucoup plus connu qu’à d’autres. » [Chalcidius, Comm. in Timæum Platonis, c. 125 ; dans les Frag. philosophorum græcorum de Didot, t. II, p. 210. – Chalcidius s’adresse, de toute évidence, à un initié.]
Diodore de Tarse se montre plus positif encore lorsqu’il affirme que « cette étoile n’était pas une de celles qui peuplent le ciel, mais une certaine vertu ou force (δύναμις) urano-diurne (θειοτεραν), ayant pris la forme d’un astre pour annoncer la naissance du Seigneur de tous ». [Diodore de Tarse, Du Destin, dans Photius, cod. 233 ; Patr. grecque, t. CIII, p. 878.]
Evangile selon saint Luc, II, v. 8 à 14 :
« Or, en la même contrée, se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Voilà qu’un Ange du Seigneur se présenta devant eux, et une lumière divine les environna, et ils furent saisis d’une grande crainte ; mais l’Ange leur dit :
« Ne craignez point, car voici que je vous apporte la Bonne Nouvelle d’une grande joie pour tout le peuple ; c’est qu’il vous est né aujourd’hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ-Seigneur ; et ceci sera pour vous le signe : vous trouverez un Enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche.
« Au même instant se joignit à l’Ange une multitude de la milice céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. »
Evangile selon saint Matthieu, II, v. 1 à 11 :
« Lors donc que Jésus fut né en Bethléem de Juda, aux jours du roi Hérode, voilà que des Mages vinrent d’Orient à Jérusalem, disant : Où est Celui qui est né, roi des Juifs, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l’adorer ?
« … Alors Hérode, les Mages secrètement appelés, s’enquit d’eux avec soin du temps où l’étoile leur était apparue et, les envoyant à Bethléem, il dit :
« Allez, informez-vous exactement de l’Enfant, et, lorsque vous l’aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que, moi aussi, j’aille l’adorer.
« Ceux-ci donc, après avoir entendu le roi, s’en allèrent ; et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vînt et s’arrêtât au-dessus du lieu où était l’Enfant.
« Or, voyant l’étoile, ils se réjouirent d’une grande joie, et entrant dans la maison, ils trouvèrent l’Enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l’adorèrent ; puis, leurs trésors ouverts, ils lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
À propos de faits si étranges et devant l’impossibilité d’en attribuer la cause à quelque phénomène céleste, A. Bonnetty, frappé du mystère qui enveloppe ces narrations, interroge :
« Qui sont ces Mages, et que faut-il penser de cette étoile ? C’est ce que se demandent en ce moment les critiques rationalistes et autres. Il est difficile de répondre à ces questions, parce que le Rationalisme et l’Ontologisme anciens et modernes, puisant toutes leurs connaissances en eux-mêmes, ont fait oublier tous les moyens par lesquels les anciens peuples de l’Orient conservaient les traditions primitives. » [A. Bonnetty, Documents historiques sur la Religion des Romains, t. II, p. 564.]
Nous retrouvons la première mention de l’étoile dans la bouche de Balaam. Celui-ci, qui serait né dans la ville de Péthor, sur l’Euphrate, vivait, dit-on, vers l’an 1477 av. J.-C., au milieu de l’empire assyrien à ses débuts. Prophète ou Mage en Mésopotamie, Balaam s’écrie :
« Comment pourrai-je maudire celui que son Dieu ne maudit pas ? Comment donc menacerai-je celui que Jéhovah ne menace pas ? Écoutez !… Je la vois, mais pas maintenant ; je la contemple, mais pas de près… Une étoile se lève de Jacob et le sceptre sort d’Israël… » (Num., XXIII, 8, XXIV, 17).
Dans l’iconographie symbolique, l’étoile sert à désigner aussi bien la conception que la naissance. La Vierge est souvent représentée nimbée d’étoiles. Celle de Larmor (Morbihan), qui fait partie d’un fort joli triptyque interprétant la mort du Christ et la souffrance de Marie, – Mater dolorosa, – où l’on peut remarquer, dans le ciel de la composition centrale, le soleil, la lune, les étoiles et l’écharpe d’Iris, tient de la main droite une grande étoile, – maris stella, – épithète donné à la Vierge dans une hymne catholique.
G. J. Witkowski nous décrit un vitrail très curieux, qui se trouvait près de la sacristie, dans l’ancienne église Saint-Jean à Rouen, aujourd’hui détruite. Ce vitrail figurait la Conception de saint Romain. « Son père, Benoît, conseiller de Clotaire II, et sa mère Félicité, étaient couchés dans un lit, entièrement nus, selon l’usage qui dura jusqu’au milieu du XVIe siècle. La conception était figurée par une étoile qui brillait sur la couverture en contact avec le ventre de la femme… Les bordures de cette vitre, déjà singulière par son motif principal, étaient ornées de médaillons où l’on distinguait, non sans surprise, les figures de Mars, Jupiter, Vénus, etc., et pour qu’on n’eût aucun doute sur leur identité, la figure de chaque déité était accompagnée de son nom. » [G. J. Witkowski, L’Art profane à l’Église. France. Paris, Schemit, 1908, p. 382.]
VIII (Le Mystère des Cathédrales)
De même que l’âme humaine a ses replis secrets, de même la cathédrale a ses couloirs cachés. Leur ensemble, qui s’étend sous le sol de l’église, constitue la crypte (du grec Κρυπτός, caché).
En ce lieu bas, humide et froid, l’observateur éprouve une sensation singulière et qui impose le silence : celle de la puissance unie aux ténèbres. Nous sommes ici dans l’asile des morts, comme à la basilique de Saint-Denis, nécropole des illustres, comme aux Catacombes romaines, cimetière des chrétiens. Des dalles de pierre ; des mausolées de marbre ; des sépulcres ; débris historiques, fragments du passé. Un silence morne et pesant emplit les espaces voûtés. Les mille bruits du dehors, ces vains écho du monde, n’arrivent plus jusqu’à nous. Allons-nous déboucher dans les cavernes des cyclopes ? Sommes-nous au seuil d’un enfer dantesque, ou sous les galeries souterraines, si accueillantes, si hospitalières aux premiers martyrs ? – Tout est mystère, angoisse et crainte en cet antre obscur…
Autour de nous, nombreux, des piliers énormes, massifs, parfois jumelés, dressés sur leurs bases larges et chanfreinées. Chapiteaux courts, peu saillants, sobres, trapus. Formes rudes et frustes, où l’élégance et la richesse cèdent le pas à la solidité. Muscles épais, contractés sous l’effort, qui se partagent sans défaillance le poids formidable de l’édifice entier. Volonté nocturne, muette, rigide, tendue dans une résistance perpétuelle à l’écrasement. Force matérielle que le constructeur sut ordonner et répartir, en donnant à tous ces membres l’archaïque aspect d’un troupeau de pachydermes fossiles, soudés les uns aux autres, arrondissant leurs dos osseux, creusant leur ventre pétrifié sous la poussée d’une charge excessive. Force réelle, mais occulte, qui s’exerce dans le secret, se développe dans l’ombre, agit sans trêve dans la profondeur des substructions de l’œuvre. Telle est l’impression dominante qu’éprouve le visiteur en parcourant les galeries des cryptes gothiques.
Jadis, les chambres souterraines des temples servaient de demeure aux statues d’Isis, lesquelles devinrent, lors de l’introduction du christianisme en Gaule, ces Vierges noires que le peuple, de nos jours, entoure d’une vénération toute particulière. Leur symbolisme est d’ailleurs identique ; les unes et les autres montrent, sur leur soubassement, la fameuse inscription : Virgini parituræ : la Vierge qui doit enfanter. Ch. Bigarne nous parle de plusieurs statues d’Isis désignées sous le même vocable. « Déjà, dit l’érudit Pierre Dujols, dans sa Bibliographie générale de l’Occulte, le savant Elias Schadius avait signalé, dans son livre De dictis Germanicis, une inscription analogue : Isidi, seu Virgini ex qua filius proditurus est [A Isis, ou à la Vierge de qui le Fils prendra naissance.]. Ces icônes n’auraient donc point le sens chrétien qu’on leur prête, du moins exotériquement. Isis, avant la conception, c’est, dit Bigarne, dans la théogonie astronomique, l’attribut de la Vierge que plusieurs monuments, bien antérieurs au christianisme, désignent sous le nom de Virgo paritura, c’est-à-dire la terre avant sa fécondation, et que les rayons du soleil vont bientôt animer. C’est aussi la mère des dieux, comme l’atteste une pierre de Die : Matri Deum Magnæ ideæ. » [Ch. Bigarne, Considérations sur le Culte d’Isis chez les Éduens. Beaune, 1862.] On ne peut mieux définir le sens ésotérique de nos Vierges noires. Elles figurent, dans la symbolique hermétique, la terre primitive, celle que l’artiste doit choisir pour sujet de son grand ouvrage. C’est la matière première à l’état de minerai, telle qu’elle sort des gîtes métallifères, profondément enfouie sous la masse rocheuse. C’est, nous disent les textes, « une substance noire, pesante, cassante, friable, qui a l’aspect d’une pierre et se peut broyer en menus morceaux à la façon d’une pierre ». Il apparaît donc régulier que l’hiéroglyphe humanisé de ce minéral en possède la couleur spécifique et qu’on lui réserve pour habitat les lieux souterrains des temples.
De nos jours, les Vierges noires sont peu nombreuses. Nous en citerons quelques-unes qui, toutes, jouissent d’une grande célébrité. La cathédrale de Chartres est la mieux partagée sous ce rapport ; elle en possède deux, l’une, désignée sous le vocable expressif de Notre-Dame-sous-Terre, dans la crypte, est assise sur un trône dont le socle porte l’inscription déjà relevée : Virgini parituræ ; l’autre, extérieure, appelée Notre-Dame-du-Pilier, occupe le centre d’une niche remplie d’ex voto sous forme de cœurs embrasés. Cette dernière, nous dit Witkowski, est l’objet de la dévotion d’un grand nombre de pèlerins. « Primitivement, ajoute cet auteur, la colonne de pierre qui lui sert de support était « cavée » des coups de langue et de dents de ses fougueux adorateurs, comme le pied de saint Pierre, à Rome, ou le genou d’Hercule que les païens adoraient en Sicile ; mais, pour la préserver des baisers trop ardents, elle fut entourée d’une boiserie en 1831. » Avec sa Vierge souterraine, Chartres passe pour être le plus ancien de tous les pèlerinages. Ce n’était d’abord qu’une antique statuette d’Isis « sculptée avant Jésus-Christ », ainsi que le racontent d’anciennes chroniques locales. Toutefois, notre image actuelle ne date que de l’extrême fin du XVIIIe siècle, celle de la déesse Isis ayant été détruite, à une époque inconnue, et remplacée par une statue de bois, tenant son Enfant assis sur les genoux, laquelle fut brûlée en 1793.
Quant à la Vierge noire de Notre-Dame du Puy, – dont les membres ne sont pas apparents, – elle affecte la figure d’un triangle, par sa robe qui la ceint au col et s’évase sans un pli jusqu’au pied. L’étoffe en est décorée de ceps de vigne et d’épis de blé, – allégoriques du pain et du vin eucharistiques, – et laisse passer, au niveau de l’ombilic, la tête de l’Enfant, aussi somptueusement couronnée que celle de sa mère.
Notre-Dame-de-Confession, célèbre Vierge noire des cryptes Saint-Victor, à Marseille, nous offre un beau spécimen de statuaire ancienne, souple, large et grasse. Cette figure, pleine de noblesse, tient un sceptre de la main droite et a le front ceint d’une couronne à triple fleuron (pl. I).
 |
NOTRE-DAME-DE-CONFESSION
Vierge Noire des cryptes
de Saint-Victor à Marseille
Planche I |
Notre-Dame de Rocamadour, but d’un pèlerinage fameux, déjà fréquenté l’an 1166, est une madone miraculeuse dont la tradition fait remonter l’origine au juif Zachée, chef des publicains de Jéricho, et qui domine l’autel de la chapelle de la Vierge construite en 1479. C’est une statuette de bois, noircie par le temps, enveloppée dans une robe de lamelles d’argent qui en consolide les débris vermoulus. « La célébrité de Rocamadour remonte au légendaire ermite, saint Amateur ou Amadour, lequel sculpta en bois une statuette de la Vierge à laquelle de nombreux miracles furent attribués. On raconte qu’Amateur était le pseudonyme du publicain Zachée, converti par Jésus-Christ ; venu en Gaule, il aurait propagé le culte de la Vierge. Celui-ci est fort ancien à Rocamadour ; cependant, la grande vogue du pèlerinage ne date que du XIIe siècle. » [La Grande Encyclopédie, t. XXVIII, p. 761.]
À Vichy, la Vierge noire de l’église Saint-Blaise y est vénérée « de toute ancienneté », ainsi que le disait Antoine Gravier, prêtre communaliste au XVIIe siècle. Les archéologues datent cette sculpture du XIVe siècle, et, comme l’église Saint-Blaise, où elle est déposée, ne fut construite, dans ses parties les plus anciennes, qu’au XVe siècle, l’abbé Allot, qui nous signale cette statue, pense qu’elle figurait autrefois dans la chapelle Saint-Nicolas, fondée en 1372 par Guillaume de Hames.
L’église de Guéodet, nommée encore Notre-Dame-de-la-Cité, à Quimper, possède aussi une Vierge noire.
Camille Flammarion nous parle d’une statue analogue qu’il vit dans les caves de l’Observatoire, le 24 septembre 1871, deux siècles après la première observation thermométrique qui y fut faite en 1671. « Le colossal édifice de Louis XIV, écrit-il, qui élève la balustrade de sa terrasse à vingt-huit mètres au- dessus du sol, descend au-dessous en des fondations qui ont la même profondeur : vingt-huit mètres. À l’angle de l’une des galeries souterraines, on remarque une statuette de la Vierge, placée là cette même année 1671, et que des vers gravés à ses pieds invoquent sous le nom de Nostre-Dame de dessoubs terre. » [Camille Flammarion, L’Atmosphère. Paris, Hachette, 1888, p. 362.] Cette Vierge parisienne peu connue, qui personnifie dans la capitale le mystérieux sujet d’Hermès, paraît être une réplique de celle de Chartres, la benoiste Dame souterraine.
Un détail encore, utile pour l’hermétiste. Dans le cérémonial prescrit pour les processions de Vierges noires, on ne brûlait que des cierges de couleur verte.
Quant aux statuettes d’Isis, – nous parlons de celles qui échappèrent à la christianisation, – elles sont plus rares encore que les Vierges noires. Peut-être conviendrait-il d’en rechercher la cause dans la haute antiquité de ces icônes. Witkowski en signale une que logeait la cathédrale Saint-Étienne, de Metz. « Cette figure en pierre d’Isis, écrit l’auteur, mesurant 0m43 de haut sur 0m29 de large, provenait du vieux cloître. La saillie de ce haut relief était de 0m18 ; il représentait un buste nu de femme, mais si maigre que, pour nous servir d’une expression imagée de l’abbé Brantôme, « elle ne pouvoit rien monstrer que le bastiment » ; sa tête était couverte d’un voile. Deux mamelles sèches pendaient à sa poitrine comme celles des Dianes d’Éphèse. La peau était colorée en rouge, et la draperie qui contournait la taille en noir… Une statue analogue existait à Saint-Germain-des-Prés et à Saint-Étienne de Lyon. » [Cf. L’Art profane à l’Église. Étranger, Op. cit., p. 26.]
Toutefois, ce qui demeure pour nous, c’est que le culte d’Isis, la Cérès égyptienne, était fort mystérieux. Nous savons seulement qu’on fêtait solennellement la déesse, chaque année, dans la ville de Busiris, et qu’on lui sacrifiait un bœuf. « Après les sacrifices, dit Hérodote, les hommes et les femmes, au nombre de plusieurs myriades, se portent de grands coups. Pour quel dieu ils se frappent, j’estime que ce serait de ma part une impiété que de le dire. » Les grecs, de même que les Égyptiens, gardaient un silence absolu sur les mystères du culte de Cérès, et les historiens ne nous ont rien appris qui pût satisfaire notre curiosité. La révélation aux profanes du secret de ces pratiques était punie de mort. On considérait même comme un crime de prêter l’oreille à la divulgation. L’entrée du temple de Cérès, à l’exemple des sanctuaires égyptiens d’Isis, était rigoureusement interdite à tous ceux qui n’avaient point reçu l’initiation. Cependant, les renseignements qui nous ont été transmis sur la hiérarchie des grands prêtres nous autorisent à penser que les mystères de Cérès devaient être du même ordre que ceux de la Science hermétique. En effet, nous savons que les ministres du culte se répartissaient en quatre degrés : l’Hiérophante, chargé d’instruire les néophytes ; le Porte-Flambeau, qui représentait le Soleil ; le Hérault, qui représentait Mercure ; le Ministre de l’Autel, qui représentait la Lune. À Rome, les Céréalies se célébraient le 12 avril et duraient huit jours. On portait, dans les processions, un œuf, symbole du monde, et l’on y sacrifiait des porcs.
Nous avons dit plus haut qu’une pierre de Die, représentant Isis, la désignait comme étant la mère des dieux. La même épithète s’appliquait à Rhéa ou Cybèle. Les deux divinités se révèlent ainsi proches parentes, et nous aurions tendance à ne les considérer qu’en tant qu’expressions différentes d’un seul et même principe. M. Charles Vincens confirme cette opinion par la description qu’il donne d’un bas-relief figurant Cybèle, que l’on a vu, durant des siècles, à l’extérieur de l’église paroissiale de Pennes (Bouches-du-Rhône), avec son inscription : Matri Deum. « Ce curieux morceau, nous dit-il, a disparu vers 1610 seulement, mais il est gravé dans le Recueil de Grosson (p. 20). » Analogie hermétique singulière : Cybèle était adorée à Pessinonte, en Phrygie, sous la forme d’une pierre noire que l’on disait être tombée du ciel. Phidias représente la déesse assise sur un trône entre deux lions, ayant sur la tête une couronne murale de laquelle descend un voile. Parfois, on la figure tenant une clef et paraissant écarter son voile. Isis, Cérès, Cybèle, trois têtes sous le même voile.
IX (Le Mystère des Cathédrales)
Ces préliminaires achevés, il nous faut maintenant entreprendre l’étude hermétique de la cathédrale, et, pour limiter nos investigations, nous prendrons pour type le temple chrétien de la capitale, Notre-Dame de Paris.
Notre tâche, certes, est difficile. Nous ne vivons plus au temps de messire Bernard, comte de Trévise, de Zachaire ou de Flamel. Les siècles ont laissé leur trace profonde au front de l’édifice, les intempéries l’ont creusé de larges rides, mais les ravages du temps comptent peu au regard de celles qu’y imprimèrent les fureurs humaines. Les révolutions y gravèrent leur empreinte, regrettable témoignage de la colère plébéienne ; le vandalisme, ennemi du beau, y assouvit sa haine par d’affreuses mutilations, et les restaurateurs eux-mêmes, quoique portés des meilleures intentions, ne surent pas toujours respecter ce que les iconoclastes avaient épargné.
Notre-Dame de Paris élevait jadis sa majesté sur un perron de onze marches. A peine isolée, par un parvis étroit, des maisons de bois, des pignons aigus étagés en encorbellement, elle gagnait en hardiesse, en élégance ce qu’elle perdait en masse. Aujourd’hui, et grâce au recul, elle paraît d’autant plus massive qu’elle est plus dégagée, et que ses porches, ses piliers et ses contreforts portent directement sur le sol ; les remblais successifs ont peu à peu comblé ses degrés et fini par les absorber jusqu’au dernier.
Au milieu de l’espace limité, d’une part, par l’imposante basilique, et, de l’autre, par l’agglomération pittoresque des petits hôtels garnis de flèches, d’épis, de girouettes, percés de boutiques peintes aux poutrelles sculptées, aux enseignes burlesques, creusés sur leurs angles de niches ornées de madones ou de saints, flanqués de tourelles, d’échauguettes à poivrières, de bretèches, au milieu de cet espace, disons-nous, se dressait une statue de pierre, haute et étroite, qui tenait un livre d’une main et un serpent de l’autre. Cette statue faisait corps avec une fontaine monumentale où se lisait ce distique :
Qui sitis, huc tendas : desunt si forte liquores,
Pergredere, æternas diva paravit aquas.
[Toi qui a soif, viens ici : Si par hasard les ondes manquent,
Par degré, la Déesse a préparé les eaux éternelles.]
Le peuple l’appelait tantôt Monsieur Legris, tantôt Vendeur de gris, Grand Jeûneur ou Jeûneur de Notre-Dame.
Bien des interprétations ont été données sur ces expressions étranges, appliquées par le vulgaire à une image que les archéologues ne purent identifier. La meilleure explication est celle que nous en fournit Amédée de Ponthieu, et elle nous semble d’autant plus digne d’intérêt que l’auteur, qui n’était point hermétiste, juge sans parti pris et prononce sans idée préconçue :
« Devant ce temple, nous dit-il en parlant de Notre-Dame, se dressait un monolithe sacré que le temps avait rendu informe. Les anciens le nommaient Phœbigène [Engendré du soleil ou de l’or.], fils d’Apollon ; le peuple le nomma plus tard Maître Pierre, voulant dire Pierre maîtresse, pierre de pouvoir [C’est la pierre angulaire dont nous avons parlé.] ; il se nommait aussi messire Legris, alors que gris signifiait feu, et particulièrement feu grisou, feu follet…
« Selon les uns, ces traits informes rappelaient ceux d’Esculape, ou de Mercure, ou du dieu Terme [Les termes étaient des bustes d’Hermès (Mercure).] ; selon d’autres, ceux d’Archambaud, maire du Palais sous Clovis II, qui avait donné le fonds sur lequel l’Hôtel-Dieu était bâti ; d’autres y voyaient les traits de Guillaume de Paris, qui l’avait érigé en même temps que le portail de Notre-Dame ; l’abbé Lebœuf y voit la figure de Jésus-Christ ; d’autres, celle de sainte Geneviève, patronne de Paris.
« Cette pierre fut enlevée en 1748, quand on agrandit la place du Parvis-de-Notre-Dame. » [Amédée de Ponthieu, Légendes du Vieux Paris. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867, p. 91.]
Vers la même époque, le chapitre de Notre-Dame reçut l’ordre de supprimer la statue de saint Christophe. Le colosse, peint en gris, s’adossait au premier pilier de droite, en entrant dans la nef. Il avait été érigé en 1413 par Antoine des Essarts, chambellan du roi Charles VI. On voulut l’enlever en 1772, mais Christophe de Beaumont, alors archevêque de Paris, s’y opposa formellement. Ce ne fut qu’à sa mort, en 1781, qu’il fut traîné hors de la métropole et brisé. Notre-Dame d’Amiens possède encore le bon géant chrétien porteur de l’Enfant-Jésus, mais il ne doit d’avoir échappé à la destruction que parce qu’il fait corps avec la muraille : c’est une sculpture en bas-relief. La cathédrale de Séville conserve aussi un saint Christophe colossal et peint à fresque. Celui de l’église Saint-Jacques-la-Boucherie périt avec l’édifice, et la belle statue de la cathédrale d’Auxerre, qui datait de 1539, fut détruite, par ordre, en 1768, quelque années seulement avant celle de Paris.
Pour motiver de tels actes, il est évident qu’il fallait de puissantes raisons. Bien qu’elles nous paraissent injustifiées, nous en trouvons cependant la cause dans l’expression symbolique tirée de la légende et condensée, – trop clairement sans doute, – par l’image. Saint Christophe, dont Jacques de Voragine nous révèle le nom primitif : Offerus, signifie, pour la masse, celui qui porte le Christ (du grec Χριστοϕος) ; mais la cabale phonétique découvre un autre sens, adéquat et conforme à la doctrine hermétique. Christophe est mis pour Chrysophe : qui porte l’or (gr. Χρυσοϕορος). Dès lors, on comprend mieux la haute importance du symbole, si parlant, de saint Christophe. C’est l’hiéroglyphe du soufre solaire (Jésus), ou de l’or naissant, élevé sur les ondes mercurielles et porté ensuite, par l’énergie propre de ce Mercure, au degré de puissance que possède l’Élixir. D’après Aristote, le Mercure a pour couleur emblématique le gris ou le violet, ce qui suffit à expliquer pourquoi les statues de saint Christophe étaient revêtues d’un enduit du même ton. Un certain nombre de vieilles gravure conservées au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale, et représentant le colosse, sont exécutées au simple trait et d’une teinte bistre. La plus ancienne date de 1418.
On montre encore, à Rocamadour (Lot), une gigantesque statue de saint Christophe, élevée sur le plateau Saint-Michel, qui précède l’église. À côté, on remarque un vieux coffre ferré, au-dessus duquel est fiché dans le roc, et retenu par une chaîne, un grossier tronçon d’épée. La légende veut que ce fragment ait appartenu à la fameuse Durandal, l’épée que brisa le paladin Roland en ouvrant la brèche de Ronceveaux. Quoiqu’il en soit, la vérité qui se dégage de ces attributs est fort transparente. L’épée qui ouvre le rocher, la verge de Moïse qui fait jaillir l’eau de la pierre d’Horeb, le sceptre de la déesse Rhée, dont elle frappe le mont Dyndime, le javelot d’Atalante sont un seul et même hiéroglyphe de cette matière cachée des Philosophes, dont saint Christophe indique la nature et le coffre ferré le résultat.
Nous regrettons de n’en pouvoir dire plus sur le magnifique emblème à qui la première place était réservée dans les basiliques ogivales. Il ne nous reste pas de description précise et détaillée de ces grandes figures, groupes admirables par leur enseignement, mais qu’une époque superficielle et décadente fit disparaître sans avoir l’excuse d’une indiscutable nécessité.
Le XVIIIe siècle, règne de l’aristocratie et du bel esprit, des abbés de cour, des marquises poudrées, des gentilshommes à perruques, temps béni des maîtres à danser, des madrigaux et des bergères de Watteau, le siècle brillant et pervers, frivole et maniéré qui devait sombrer dans le sang, fut particulièrement néfaste aux œuvres d’art gothiques.
Entraînés par le grand courant de décadence que généra François Ier sous le nom paradoxal de Renaissance, incapables d’un effort équivalent à celui de leurs ancêtres, tout à fait ignorants de la symbolique médiévale, les artistes préférèrent reproduire des œuvres bâtardes, sans goût, sans caractère, sans pensée ésotérique, plutôt que poursuivre et développer l’admirable et saine création française.
Architectes, peintres, sculpteurs, préférant leur propre gloire à celle de l’Art, s’adressèrent aux modèles antiques contrefaits en Italie.
Les constructeurs du moyen âge avaient en apanage la foi et la modestie. Artisans anonymes de purs chefs-d’œuvre, ils édifièrent pour la Vérité, pour l’affirmation de leur idéal, pour la propagation et la noblesse de leur science. Ceux de la Renaissance, préoccupés surtout de leur personnalité, jaloux de leur valeur, édifièrent pour la postérité de leur nom. Le moyen âge dut sa splendeur à l’originalité de ses créations ; la Renaissance dut sa vogue à la fidélité servile de ses copies. Ici, une pensée ; là une mode. D’un côté, le génie ; de l’autre, le talent. Dans l’œuvre gothique, la facture demeure soumise à l’Idée ; dans l’œuvre renaissante, elle la domine et l’efface. L’une parle au cœur, au cerveau, à l’âme : c’est le triomphe de l’esprit ; l’autre s’adresse aux sens : c’est la glorification de la matière. Du XIIe au XVe siècle, pauvreté de moyens mais richesse d’expression ; à partir du XVIe, beauté plastique, médiocrité d’invention. Les maîtres médiévaux surent animer le calcaire commun ; les artistes de la Renaissance laissèrent le marbre inerte et froid.
C’est l’antagonisme de ces deux périodes, nées de concepts opposés, qui explique le mépris de la Renaissance et sa répugnance profonde pour tout ce qui était gothique.
Un tel état d’esprit devait être fatal à l’œuvre du moyen âge ; et c’est à lui, en effet, que nous devons attribuer les mutilations sans nombre que nous déplorons aujourd’hui.
La cathédrale de Paris, ainsi que la plupart des basiliques métropolitaines, est placée sous l’invocation de la benoîte Vierge Marie ou Vierge-Mère. En France, le populaire appelle ces églises des Notre-Dame. En Sicile, elles portent un nom plus expressif encore, celui de Matrices. Ce sont donc bien des temples dédiés à la Mère (lat. mater, matri), à la Matrone dans le sens primitif, mot qui, par corruption, est devenu la Madone (ital. ma donna), ma Dame, et, par extension, Notre-Dame.
Franchissons la grille du porche, et commençons l’étude de la façade par le grand portail, dit porche central ou du Jugement.
Le pilier trumeau qui partage en deux la baie d’entrée offre une série de représentations allégoriques des sciences médiévales. Face au parvis, – et à la place d’honneur, – l’alchimie y est figurée par une femme dont le front touche les nues. Assise sur un trône, elle tient de la main gauche un sceptre, – insigne de souveraineté, – tandis que la droite supporte deux livres, l’un fermé (ésotérisme), l’autre ouvert (exotérisme). Maintenue entre ses genoux et appuyée contre sa poitrine se dresse l’échelle aux neuf degrés, –
scala philosophorum, – hiéroglyphe de la patience que doivent posséder ses fidèles, au cours des neufs opérations successives du labeur hermétique (pl. II). « La patience est l’eschelle des Philosophes, nous dit Valois, et l’humilité est la porte de leur jardin ; car quiconque persévérera sans orgueil et sans envie, Dieu lui fera miséricorde. » [
Œuvres de Nicolas Grosparmy et Nicolas Valois. Mss. biblioth. de l’Arsenal, n° 2516 (166 S.A.F.), p. 176.]
 |
L'ALCHIMIE
Bas-relief du grand porche de Notre-Dame de Paris
Planche II |
Tel est le titre du chapitre philosophal de ce mutus Liber qu’est le temple gothique ; le frontispice de cette Bible occulte aux massifs feuillets de pierre ; l’empreinte, le sceau du Grand-Œuvre laïque au front du Grand-Œuvre chrétien. Il ne pouvait être mieux situé qu’au seuil même de l’entrée principale.
Ainsi, la cathédrale nous apparaît basée sur la science alchimique, investigatrice des transformations de la substance originelle, de la Matière élémentaire (lat. materea, racine mater, mère). Car la Vierge-Mère, dépouillée de son voile symbolique, n’est autre chose que la personnification de la substance primitive dont se servit, pour réaliser ses desseins, le Principe créateur de tout ce qui est. Tel est le sens, d’ailleurs fort lumineux, de cette épître singulière qu’on lit à la messe de l’Immaculée-Conception de la Vierge, et dont voici le texte :
« Le Seigneur m’a possédée au commencement de ses voies. J’étais avant qu’il formât aucune créature. J’étais de toute éternité avant que la terre ne fut créée. Les abîmes n’étaient pas encore, et déjà j’étais conçue. Les fontaines n’étaient pas encore sorties de la terre ; la pesante masse des montagnes n’était pas encore formée ; j’étais enfantée avant les collines. Il n’avait créé ni la terre, ni les fleuves, ni affermi le monde sur ses pôles. Lorsqu’il préparait les Cieux, j’étais présente ; lorsqu’il environnait les abîmes de leurs bornes et qu’il prescrivait une loi inviolable ; lorsqu’il affermissait l’air au-dessus de la terre ; lorsqu’il donnait leur équilibre aux eaux des fontaines ; lorsqu’il renfermait la mer dans ses limites et lorsqu’il imposait une loi aux eaux afin qu’elles ne passassent point leurs bornes ; lorsqu’il posait les fondements de la terre, j’étais avec lui, et je réglais toutes choses. »
Il s’agit visiblement ici de l’essence même des choses. Et, en effet, les Litanies nous apprennent que la Vierge est le Vase qui contient l’Esprit des choses : Vas spirituale. « Sur une table, à hauteur de la poitrine des Mages, nous dit Etteilla, étoient, d’un côté, un livre ou une suite de feuillets ou lames d’or (le livre de Thot) et, de l’autre côté, un vase plein d’une liqueur céleste-astrale, composée d’un tiers de miel sauvage, d’une part d’eau terrestre et d’une part d’eau céleste… Le secret, le mystère étoit donc dans le vase. » [Etteilla, Le Denier du Pauvre, dans les Sept nuances de l’Œuvre philosophique, s. l. n. d. (1786), p. 57.]
Cette Vierge singulière, – Virgo singularis, comme le désigne expressément l’Église – est, au surplus, glorifiée sous des épithètes qui dénotent assez son origine positive. Ne la nomme-t-on pas aussi le Palmier de la Patience (Palma patientiæ) ; le Lis entre les épines (Lilium inter spinas) [C’est le titre de mss. alchimiques célèbres d’Agricola et de Ticinensis. Cf. biblioth. de Rennes (159) ; de Bordeaux (533) ; de Lyon (154) ; de Cambrai (919).] ; le Miel symbolique de Samson ; la Toison de Gédéon ; la Rose mystique ; la Porte du Ciel ; la Maison de l’Or ; etc. ? Les mêmes textes appellent encore Marie le Siège de la Sagesse, en d’autres termes le Sujet de la Science hermétique, de la sapience universelle. Dans le symbolisme des métaux planétaires, c’est la Lune, qui reçoit les rayons du Soleil et les conserve secrètement dans son sein. C’est la dispensatrice de la substance passive, que l’esprit solaire vient animer. Marie, Vierge et Mère, représente donc la forme ; Élie, le Soleil, Dieu le Père est l’emblème de l’esprit vital. De l’union de ces deux principes résulte la matière vivante, soumise aux vicissitudes des lois de mutation et de progression. C’est alors Jésus, l’esprit incarné, le feu corporifié dans les choses telles que nous les connaissons ici-bas :
ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, ET IL A HABITÉ PARMI NOUS.
D’autre part, la Bible nous enseigne que Marie, mère de Jésus, était de la tige de Jessé. Or, le mot hébreu Jes signifie le feu, le soleil, la divinité. Être de la tige de Jessé, c’est donc être de la race du soleil, du feu. Comme la matière tire son origine du feu solaire, ainsi que nous venons de le voir, le même nom de Jésus nous apparaît dans sa splendeur originelle et céleste : feu, soleil, Dieu.
Enfin, dans l’Ave Regina, la Vierge est appelée proprement Racine (Salve, radix) pour marquer qu’elle est le principe et le commencement du Tout. « Salut, racine par laquelle la Lumière a brillé sur le monde. »
Telles sont les réflexions suggérées par l’expressif bas-relief qui accueille le visiteur sous le porche de la basilique. La Philosophie hermétique, la vieille Spagyrie lui souhaitent la bienvenue dans le temple gothique, le temple alchimique par excellence. Car la cathédrale tout entière n’est qu’une glorification muette, mais imagée, de l’antique science d’Hermès, dont elle a su, d’ailleurs, conserver l’un des anciens artisans. Notre-Dame de Paris, en effet, garde son alchimiste.
Si, poussé par la curiosité, ou pour donner quelque agrément à la flânerie d’un jour d’été, vous gravissez l’escalier en hélice qui accède aux parties hautes de l’édifice, parcourez lentement le chemin, creusé comme une rigole, au sommet de la seconde galerie. Arrivé près de l’axe médian du majestueux édifice, à l’angle rentrant de la tour septentrionale, vous apercevrez, au milieu du cortège de chimères, le saisissant relief d’un grand vieillard de pierre. C’est lui, c’est l’alchimiste de Notre-Dame (pl. III).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
L'Alchimiste
Planche III |
Coiffé du bonnet phrygien, attribut de l’Adeptat (*), négligemment posé sur la longue chevelure aux boucles épaisses, le savant, serré dans la cape légère du laboratoire, s’appuie d’une main sur la balustrade, tandis qu’il caresse, de l’autre, sa barbe abondante et soyeuse. Il ne médite pas, il observe. L’œil est fixe ; le regard, d’une étrange acuité. Tout, dans l’attitude du Philosophe, révèle une extrême émotion. La courbure des épaules, la projection en avant de la tête et du buste trahissent, en effet, la plus forte surprise. En vérité, cette main pétrifiée s’anime. Est-ce une illusion ? On croirait la voir trembler…
* [Le bonnet phrygien, qui coiffait les sans-culottes et constituait une sorte de talisman protecteur, au milieu des hécatombes révolutionnaires, était le signe distinctif des Initiés. Dans l’analyse qu’il fait d’un ouvrage de Lombard (de Langres), intitulé : Histoire des Jacobins, depuis 1789 jusqu’à ce jour, ou État de l’Europe en novembre 1820 (Paris, 1820), le savant Pierre Dujols écrit qu’au grade d’Épopte (dans les Mystères d’Éleusis) « on demandait au récipiendaire s’il se sentait la force, la volonté et le dévouement requis pour mettre la main au GRAND-ŒUVRE. Alors, on lui posait un bonnet rouge sur la tête, en prononçant cette formule : « Couvre-toi de ce bonnet, il vaut mieux que la couronne d’un roi. » On était loin de se douter que ce genre de pétase, nommé libéria dans les Mithriaques, et qui désignait autrefois les esclaves affranchis, fût un symbole maçonnique et la marque suprême de l’Initiation. On ne sera donc plus étonné de le voir figurer sur nos monnaies et nos monuments publics. »]
Quelle splendide figure que celle du vieux maître qui scrute, interroge, anxieux et attentif, l’évolution de la vie minérale, puis contemple enfin, ébloui, le prodige que sa foi seule lui laissait entrevoir !
Et qu’elles sont pauvres, les statues modernes de nos savants, – qu’ils soient coulés dans le bronze ou taillés dans le marbre, – auprès de cette image vénérable, d’un si puissant réalisme en sa simplicité !
Le stylobate de la façade, qui se développe et s’étend sous les trois porches, est tout entier consacré à notre science ; et c’est un véritable régal pour le déchiffreur des énigmes hermétiques que cet ensemble d’images aussi curieuses qu’instructives.
C’est là que nous allons trouver le nom lapidaire du sujet des Sages ; là que nous assisterons à l’élaboration du dissolvant secret ; là, enfin, que nous suivrons pas à pas le travail de l’Élixir, depuis sa calcination première jusqu’à son ultime coction.
Mais afin de garder quelque méthode en cette étude, nous observerons toujours l’ordre de succession des figures, en allant de l’extérieur vers les ventaux du porche, comme le ferait un fidèle pénétrant dans l’édifice.
Sur les faces latérales des contreforts qui limitent le grand portail, nous trouverons, à hauteur de l’œil, deux petits bas-reliefs encastrés chacun dans une ogive. Celui du pilier de gauche présente l’alchimiste découvrant la Fontaine mystérieuse que le Trévisan décrit dans la Parabole finale de son livre sur la Philosophie naturelle des Métaux [Cf. J. Mangin de Richebourg, Bibliothèque des Philosophes Chimiques. Paris, 1741, t. II, traité VII.].
L’artiste a cheminé longtemps ; il a erré par les voies fausses et les chemins douteux ; mais sa joie éclate enfin ! Le ruisseau d’eau vive coule à ses pieds ; il sourd, en bouillonnant, du vieux chêne creux [« Note ce chêne », dit simplement Flamel au
Livre des Figures hiéroglyphiques.]. Notre Adepte a frappé le but. Aussi, dédaignant l’arc et les flèches avec lesquelles, à l’instar de Cadmus, il transperça la dragon, il regarde ondoyer la source limpide dont la vertu dissolvante et l’essence volatile lui sont attestées par un oiseau perché sur l’arbre (pl. IV).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORTAIL DU JUGEMENT
La fontaine mystérieuse au pied
du Vieux Chêne
Planche IV |
Mais quelle est cette Fontaine occulte ? De quelle nature est ce puissant dissolvant capable de pénétrer tous les métaux, – l’or en particulier, – et d’accomplir, avec l’aide du corps dissous, le grand ouvrage en entier ? – Ce sont là des énigmes si profondes qu’elles ont rebuté un nombre considérable de chercheurs ; tous, ou presque, se sont brisés le front contre ce mur impénétrable, élevé par les Philosophes pour servir d’enceinte à leur citadelle.
La mythologie la nomme Libéthra [Cf Noël, Dictionnaire de la Fable. Paris, Le Normant, 1801.] et nous raconte que c’était une fontaine de Magnésie, laquelle avait, dans son voisinage, une autre source nommée la Roche. Toutes deux sortaient d’une grosse roche dont la figure imitait le sein d’une femme ; de sorte que l’eau semblait couler de deux mamelles comme du lait. Or, nous savons que les anciens auteurs appellent la matière de l’Œuvre notre Magnésie et que la liqueur extraite de cette magnésie est dite Lait de la Vierge. Il y a là une indication. Quant à l’allégorie du mélange ou de la combinaison de cette eau primitive issue du Chaos des Sages, avec une seconde eau de nature différente (quoique de même genre), elle est assez claire et suffisamment expressive. De cette combinaison résulte une troisième eau qui ne mouille point les mains, et que les Philosophes ont appelé tantôt Mercure, tantôt Soufre, selon qu’ils envisageaient la qualité de cette eau ou son aspect physique.
Dans le traité de l’Azoth, attribué au célèbre moine d’Erfurth, Basile Valentin, et qui serait plutôt l’œuvre de Senior Zadith, on remarque une figure sur bois représentant une nymphe ou sirène couronnée, nageant sur la mer et faisant jaillir de ses mamelles deux jets de lait qui se mélangent avec les flots. [Azoth ou Moyen de faire l’Or caché des Philosophes, par Frère Basile Valentin. Paris, Pierre Moët, 1659, p.51.]
Chez les auteurs arabes, cette Fontaine porte le nom d’Holmat ; ils nous enseignent, de plus, que ses eaux donnèrent l’immortalité au prophète Élie (Ηλιος, soleil). Ils placent la source fameuse dans le Modhallan, terme dont la racine signifie Mer obscure et ténébreuse, ce qui marque bien la confusion élémentaire que les Sages attribuent à leur Chaos ou matière première.
Une réplique peinte de la fable que nous venons de citer se trouvait dans la petite église de Brixen (Tyrol). Ce curieux tableau, décrit par Misson et signalé par Witkowski, paraît être la version religieuse du même thème chimique. « Jésus fait couler dans un grand bassin le sang de son côté, ouvert par la lance de Longin ; la Vierge presse ses mamelles, et le lait qui en jaillit tombe dans le même récipient. Le trop-plein s’écoule dans un second bassin et se perd au fond d’un gouffre de flammes, où les âmes du Purgatoire, des deux sexes, en bustes nus, s’empressent à recevoir cette précieuse liqueur qui les console et les rafraîchit. » [G. J. Witkowski, L’Art profane à l’Église. Étranger, p. 63.]
Au bas de cette vieille peinture, on lit l’inscription en latin de sacristie :
Dum fluit e Christi benedicto Vulnere sanguis,
Et dum Virgineum lac pia Virgo premit,
Lac fuit et sanguis, sanguis conjungitur et lac
Et sit Fons Vitæ, Fons et Origo boni.
[« Tandis que le sang s’écoule de la blessure bénie du Christ, et que la Vierge sainte presse son sein virginal, le lait et le sang jaillissent et se mélangent, et deviennent la Fontaine de Vie et la Source du Bien. »]
Parmi les descriptions qui accompagnent les Figures symboliques d’Abraham le Juif, dont le livre, dit-on, appartint à Nicolas Flamel, et que cet Adepte tenait exposées dans sa boutique d’écrivain, nous en relèverons deux qui ont trait à la Fontaine mystérieuse et à ses composants. Voici les textes originaux de ces deux descriptions [Recueil de Sept Figures peintes. Bibl. de l’Arsenal, n° 3047 (153 S. A. F.).] :
« Troisième figure. – Est dépeint et représenté un jardin clos de hayes, où y a plusieurs quarreaux. Au milieu, y a un vieil creux de chesne, au pied duquel, à costé, y a un rosier à feuilles d’or et de roses blanches et rouges, qui entoure ledit chesne jusqu’au haut, proche de ses branches. Et au pied dudit creux de chesne bouillonne une fontaine clere comme argent, qui se va perdant en terre ; et parmy plusieurs qui la cherchent, estoient quatre aveugles qui la houent et quatre autres qui la cherchent sans fouiller, estant ladite fontaine devant eux, et ne peuvent la trouver, excepté un qui la pèse en sa main. »
C’est ce dernier personnage qui forme le sujet du motif sculpté de Notre-Dame de Paris. La préparation du dissolvant en question est relatée dans l’explication qui accompagne l’image suivante :
« Quatrième figure. – Est dépeint un champ, auquel y a un roy couronné, habillé de rouge à la Juifve, tenant une espée nue ; deux soldats qui tuent des enfants de deux mères, qui sont assises à terre, pleurans leurs enfans ; et deux autres soldats qui jettent le sang dans une grande cuve pleine dudit sang, où le soleil et la lune, descendans du ciel ou des nues, se viennent baigner. Et sont six soldats armez d’armure blanche, et le roy fait le septiesme, et sept innocens morts, et deux mères, l’une vestue de bleu, qui pleure, s’essuiant la face d’un mouchoir, et l’autre qui pleure aussi, vestue de rouge. »
Signalons encore une figure du livre de Trismosin, qui est, à très peu près, semblable à la troisième d’Abraham. On y voit un chêne dont le pied, ceint d’une couronne d’or, donne naissance au ruisseau occulte qui s’écoule dans la campagne. Dans les frondaisons de l’arbre, des oiseaux blancs s’ébattent, à l’exception d’un corbeau, qui semble endormi, et qu’un homme, pauvrement habillé, dressé sur une échelle, s’apprête à saisir. Au premier plan de cette scène rustique, deux sophistes, vêtus avec recherche d’étoffes somptueuses, discutent et argumentent sur ce point de science, sans remarquer le chêne placé derrière eux, ni voir la Fontaine qui coule à leurs pieds… [Cf. Trismosin, La Toyson d’Or. Paris, Ch. Sevestre, 1612, p. 52.]
Disons enfin que la tradition ésotérique de la Fontaine de Vie ou Fontaine de Jouvence se retrouve matérialisée dans les Puits sacrés que possédaient, au moyen âge, la plupart des églises gothiques. L’eau qu’on y puisait passait le plus souvent pour avoir des vertus curatives, et on l’employait dans le traitement de certaines maladies. Abbon, dans son poème sur le siège de Paris par les Normands, rapporte plusieurs traits qui attestent les propriétés merveilleuses de l’eau du puits de Saint-Germain-des-Prés, lequel était foré au fond du sanctuaire de la célèbre abbatiale. De même, l’eau du puits de Saint-Marcel, à Paris, creusé dans l’église, près de la pierre tombale du vénérable évêque, se révélait, d’après Grégoire de Tours, comme un puissant spécifique de plusieurs affections. Il existe encore aujourd’hui, à l’intérieur de la basilique ogivale Notre-Dame de Lépine (Marne), un puits miraculeux, dit Puits de la Sainte-Vierge, et, au milieu du chœur de Notre-Dame de Limoux (Aude), un puits analogue dont l’eau guérit, dit-on, toutes les maladies ; il porte cette inscription :
Omnis qui bibit hanc aquam, si fidem addit, savus erit.
[Quiconque boit cette eau, s’il y joint la foi, sera bien portant.]
Nous aurons bientôt l’occasion de revenir sur cette eau pontique, à laquelle les Philosophes ont donné une foule d’épithètes plus ou moins suggestives.
En face du motif sculpté traduisant les propriétés et la nature de l’agent secret, nous allons assister, sur le contrefort opposé, à la cuisson du compost philosophal. L’artiste, cette fois, veille sur le produit de son labeur. Revêtu de l’armure, les jambes bardées de grèves et l’écu au bras, notre chevalier est campé sur la terrasse d’une forteresse, si nous en jugeons par les créneaux qui l’entourent. Dans un mouvement défensif, il menace du javelot une forme imprécise (quelque rayon ? une gerbe de flammes ?), qu’il est malheureusement impossible d’identifier, tant le relief en est mutilé. Derrière le combattant, un petit édifice bizarre, formé d’un soubassement cintré, crénelé et porté sur quatre piliers, est recouvert d’un dôme segmenté à clef sphérique. Sous la voûte inférieure, une masse aculéiforme et flammée vient en préciser la destination. Ce curieux donjon, burg en miniature, c’est l’instrument du Grand-Œuvre, l’Athanor, l’occulte four aux deux flammes, – potentielle et virtuelle, – que tous les disciples connaissent et que nombre de descriptions, de gravures ont contribué à vulgariser (pl. V).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORTAIL DU JUGEMENT
L'Alchimiste protège l'Athanor
contre les influences extérieures
Planche V |
Immédiatement au dessus de ces figures sont reproduits deux sujets qui en paraissent former le complément. Mais, comme l’ésotérisme se cache ici sous des dehors sacrés et des scènes bibliques, nous éviterons d’en parler, afin de ne point encourir le reproche d’une interprétation arbitraire. De grands savants, parmi les maître anciens, n’ont pas craint d’expliquer alchimiquement les paraboles des saintes Écritures, tant le sens en est susceptible de versions diverses. La Philosophie hermétique invoque fréquemment le témoignage de la Genèse pour servir d’analogie au premier travail de l’Œuvre ; quantité d’allégories du vieux et du nouveau Testament prennent un relief imprévu au contact alchimique. De tels précédents devraient à la fois et nous encourager et nous servir d’excuse ; nous préférons cependant nous en tenir exclusivement aux motifs dont le caractère profane est indiscutable, laissant aux instigateurs bénévoles la faculté d’exercer leur sagacité sur les autres.
Les sujets hermétiques du stylobate se développent sur deux rangs superposés, à droite et à gauche du porche. Le rang inférieur comporte douze médaillons, et le rang supérieur douze figures. Ces dernières représentent des personnages assis sur des socles ornés de cannelures à profil tantôt concave, tantôt angulaire, et placés dans les entre-colonnements d’arcades trilobées. Tous présentent des disques garnis d’emblèmes variés ayant trait au labeur alchimique.
Si nous commençons par le rang supérieur, côté gauche, le premier bas-relief nous montrera l’image du corbeau, symbole de la couleur noire. La femme qui le tient sur ses genoux symbolise la Putréfaction (pl. VI).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Le Corbeau - Putréfaction
Planche VI |
Qu’il nous soit permis de nous arrêter un instant sur l’hiéroglyphe du Corbeau, parce qu’il cache un point important de notre science. Il exprime, en effet, dans la cuisson du Rebis philosophal, la couleur noire, première apparence de la décomposition consécutive à la mixtion parfaite des matières de l’Œuf. C’est, au dire des Philosophes, la marque certaine du succès futur, le signe évident de l’exacte préparation du compost. Le Corbeau est, en quelque sorte, le sceau canonique de l’Œuvre, comme l’étoile est la signature du sujet initial.
Mais cette noirceur que l’artiste espère, qu’il attend avec anxiété, dont l’apparition vient combler ses vœux et le remplir de joie, ne se manifeste pas seulement au cours de la coction. L’oiseau noir paraît à diverses reprises, et cette fréquence permet aux auteurs de jeter la confusion dans l’ordre des opérations.
Selon Le Breton, « il y a quatre putréfactions dans l’Œuvre philosophique. La première, dans la première séparation ; la seconde, dans la première conjonction ; la troisième dans la seconde conjonction, qui se fait de l’eau pesante avec son sel ; la quatrième, enfin, dans la fixation de soulphre. Dans chacune de ces putréfactions, la noirceur arrive. » [Le Breton, Clefs de la Philosophie Spagyrique. Paris, Jombert, 1722, p. 282.]
Nos vieux maîtres ont donc eu beau jeu pour couvrir l’arcane d’un voile épais, en mélangeant les qualités spécifiques des diverses substances, au cours des quatre opérations qui manifestent la couleur noire. Aussi devient-il très laborieux de les séparer et de distinguer nettement ce qui appartient à chacune d’elles.
Voici quelques citations qui pourront éclairer l’investigateur et lui permettre de reconnaître sa route dans ce ténébreux labyrinthe.
« Dans la seconde opération, écrit le Chevalier Inconnu, le prudent artiste fixe l’âme générale du monde dans l’or commun et rend pure l’âme terrestre et immobile. Dans cette dite opération, la putréfaction, qu’ils appellent la Tête du Corbeau, est très longue. Celle-ci est suivie d’une troisième multiplication en adjoutant la matière philosophique ou l’âme générale du monde. » [La Nature à découvert, par le Chevalier Inconnu. Aix, 1669.]
Il y a là, clairement indiquée, deux opérations successives, dont la première se termine et la seconde commence après l’apparition de la coloration noire, ce qui n’est pas le cas de la coction.
Un précieux manuscrit anonyme du XVIIIe siècle parle ainsi de cette putréfaction première, qu’il ne faut pas confondre avec les autres :
« Si la matière n’est pas corrompue et mortifiée, dit cet ouvrage, vous ne pourrez pas extraire nos élémens et nos principes ; et pour vous aider en cette difficulté, je vous donnerai des signes pour la connoistre. Quelques Philosophes l’ont aussi marqué. Morien dit : il faut qu’on y remarque quelque acidité, et qu’elle ait quelque odeur de sépulcre. Philalèthe dit qu’il faut qu’elle paroisse comme des yeux de poisson, c’est-à-dire des petites bouteilles sur la superficie, et qu’il paroisse qu’elle écume ; car c’est une marque que la matière se fermente et qu’elle bout. Cette fermentation est fort longue et il faut avoir une grande patience, parce qu’elle se fait par notre feu secret, qui est le seul agent qui puisse ouvrir, sublimer et putréfier. » [La Clef du Cabinet hermétique. Mss. du XVIIIe siècle. Anon., s. l. n. d.]
Mais, de toutes ces descriptions, celles qui se rapportent au Corbeau (ou couleur noire) de la coction sont de beaucoup les plus nombreuses et les plus fouillées, parce qu’elles englobent tous les caractères des autres opérations.
Bernard Trévisan s’exprime de cette manière :
« Notez donc que, quand nostre compost commence à estre abreuvé de nostre eau permanente, lors est tout le compost tourné en manière de poix fondue, et est tout noircy comme charbon. Et en cet endroit est appelé nostre compost : la poix noire, le sel bruslé, le plomb fondu, le laton non net, la Magnésie et le Merle de Jean. Car lors est veuë une nuée noire, volant par la moyenne région du vaisseau, en belle et souëfve manière, estre eslevée au-dessus du vaisseau ; et au fonds d’iceluy est la matière fondue en manière de poix, et demeure totalement dissoulte. De laquelle nuë parle Jaques du bourg S. Saturnin, disant : O benoiste nuë qui t’envoles par nostre vaisseau ! Là est l’éclipse du soleil, dont parle Raymond. [L’auteur, sous ce seul prénom, entend parler de Raymod Lulle (Doctor Illuminatus).] Et quand ceste masse est ainsy noircie, adonc elle est dicte morte et privée de sa forme… Lors est manifestée l’humidité en couleur d’argent vif noir et puant, lequel estoit premièrement sec, blanc, bien odorant, ardent, dépuré de soulphre par la première opération, et maintenant à dépurer par ceste seconde opération. Et pour ce, est privé ce corps de son âme, qu’il a perdue, et de sa resplendeur et merveilleuse lucidité qu’il avoit premièrement, et maintenant est noir et enlaidy… Ceste masse ainsy noire ou noircie est la clef, le commencement et le signe de la parfaicte invention de la manière d’œuvrer du second régime de nostre pierre précieuse. [On donne le nom de Clef à toute dissolution alchimique radicale (c’est-à-dire irréductible), et l’on étend parfois ce terme aux menstrues ou dissolvants capable de l’effectuer.] Pourquoy, dict Hermès, veuë la noirceur, croyez que vous avez esté par une bonne sente et tenu bon chemin. » [Bernard Trévisan, La Parole délaissée. Paris, Jean Sara, 1618, p. 39.]
Batsdorff, auteur présumé d’un ouvrage classique, que d’autres attribuent à Gaston de Claves, enseigne que la putréfaction se déclare quand la noirceur apparaît, et que c’est là le signe d’un travail régulier et conforme à la nature. Il ajoute : « Les Philosophes lui ont donné divers noms et l’ont appelée Occident, Ténèbres, Éclypse, Lèpre, Teste de Corbeau, Mort, Mortification du Mercure… Il appert donc que par cette putréfaction on fait la séparation du pur et de l’impur. Or, les signes d’une bonne et vraye putréfaction sont une noirceur très noire ou très profonde, une odeur puante, mauvaise et infecte, dite des Philosophes toxicum et venenum, laquelle odeur n’est pas sensible à l’odorat, mais seulement à l’entendement. » [Le Filet d’Ariadne. Paris, d’Houry, 1695, p. 99.]
Arrêtons ici ces citations, que nous pourrions multiplier sans autre profit pour l’étudiant, et revenons aux figures hermétiques de Notre-Dame.
Le second bas-relief nous offre l’effigie du Mercure philosophique : un serpent enroulé sur la verge d’or. Abraham le Juif, connu aussi sous le nom d’Éléazar, en fit usage dans le livre qui échut à Flamel, – ce qui n’a rien de surprenant, car nous rencontrons ce symbole durant toute la période médiévale (pl. VII).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Le Mercure Philosophique
Planche VII |
Le serpent indique la nature incisive et dissolvante du Mercure, qui absorbe avidement le soufre métallique et le retient si fort que la cohésion ne peut être ultérieurement vaincue. C’est là ce « ver empoisonné qui infecte tout par son venin », dont parle l’Ancienne Guerre des Chevaliers. [Rééditée par Limojon de Saint-Didier, dans le Triomphe hermétique ou la Pierre philosophale victorieuse. Amsterdam, Weitsten, 1699, et Desbordes, 1710.] Ce reptile est le type du Mercure dans son premier état, et la verge d’or, le soufre corporel qui lui est ajouté. La dissolution du soufre ou, en d’autres termes, son absorption par le mercure, a fourni le prétexte d’emblèmes très divers ; mais le corps résultant, homogène et parfaitement préparé, conserve le nom de Mercure philosophique et l’image du caducée. C’est la matière ou le composé du premier ordre, l’œuf vitriolé qui n’exige plus qu’une cuisson graduée pour se transformer d’abord en soufre rouge, ensuite en Élixir, puis, au troisième période, en Médecine universelle. « Dans notre Œuvre, affirment les Philosophes, le Mercure seul suffit. »
Une femme, aux longs cheveux mouvants comme des flammes, vient ensuite. Personnifiant la Calcination, elle presse sur sa poitrine le disque de la Salamandre « qui vit dans le feu et se nourrit du feu » (pl. VIII). Ce lézard fabuleux ne désigne pas autre chose que le sel central, incombustible et fixe, qui garde sa nature jusque dans les cendres des métaux calcinés, et que les Anciens ont nommé Semence métallique. Dans la violence de l’action ignée, les portions adustibles du corps se détruisent ; seules, les parties pures, inaltérables, résistent et, quoique très fixes, peuvent s’extraire par lixiviation.
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
La Salamandre - Calcination
Planche VIII |
Telle est, du moins, l’expression spagyrique de la calcination, similitude dont usent les Auteurs pour servir d’exemple à l’idée générale que l’on doit avoir du travail hermétique. Cependant, nos maîtres dans l’Art ont soin d’attirer l’attention du lecteur sur la différence fondamentale existant entre la calcination vulgaire, telle qu’on la réalise dans les laboratoires chimiques, et celle que l’Initié opère dans le cabinet des philosophes. Celle-ci ne se fait par aucun feu vulgaire, ne nécessite point le secours du réverbère, mais demande l’aide d’un agent occulte, d’un feu secret, lequel, pour donner un aperçu de sa forme, ressemble plus à une eau qu’à une flamme. Ce feu, ou cette eau ardente, est l’étincelle vitale communiquée par le Créateur à la matière inerte ; c’est l’esprit enclos dans les choses, le rayon igné, impérissable, enfermé au fond de l’obscure substance, informe et frigide. Nous touchons ici au plus haut secret de l’Œuvre ; et nous serions heureux de trancher ce nœud gordien en faveur des aspirants à notre Science, – nous souvenant, hélas ! que nous fûmes arrêté nous-même par cette difficulté pendant plus de vingt ans, – s’il nous était permis de profaner un mystère dont la révélation dépend du Père des Lumières. À notre grand regret, nous ne pouvons faire plus que signaler l’écueil et conseiller, avec les plus éminents philosophes, la lecture attentive d’Artephius [Le Secret Livre d’Artephius, dans Trois Traitez de la Philosophie naturelle. Paris, Marette, 1612.], de Pontanus [Pontanus, De Lapide Philosphico. Francofurti, 1614.] et du petit ouvrage intitulé : Epistola de Igne Philosophorum [Manuscrit de la Bibliothèque nationale, 19969.]. On y trouvera de précieuses indications sur la nature et les caractéristiques de ce feu aqueux ou de cette eau ignée, enseignements que l’on pourra compléter par les deux textes suivants.
L’auteur anonyme des Préceptes du Père Abraham dit : « Il faut tirer cette eau primitive et céleste du corps où elle est, et qui s’exprime par sept lettres selon nous, signifiant la semence première de tous les êtres, et non spécifiée ni déterminée dans la maison d’Ariès pour engendrer son fils. C’est à cette eau que les Philosophes ont donné tant de noms, et c’est le dissolvant universel, la vie et la santé de toute chose. Les Philosophes disent que c’est dans cette eau que le soleil et la lune se baignent, et qu’ils se résolvent eux-mêmes en eau, leur première origine. C’est par cette résolution qu’il est dit qu’ils meurent, mais leurs esprits sont portés sur les eaux de cette mer où ils estoient ensevelis… Quoy qu’on dise, mon fils, qu’il y a d’autres manières de résoudre ces corps en leur première matière, tiens-toy à celle que je te déclare, parce que je l’ay connuë par l’expérience et selon que nos Anciens nous l’ont transmis. »
Limojon de Saint-Didier écrit de même : « … Le feu secret des Sages est un feu que l’artiste prépare selon l’Art, ou du moins qu’il peut faire préparer par ceux qui ont une parfaite connoissance de la chimie. Ce feu n’est pas actuellement chaud, mais il est un esprit igné introduit dans un sujet d’une même nature que la Pierre ; et, étant médiocrement excité par le feu extérieur, la calcine, la dissout, la sublime et la résout en eau seiche, ainsi que le dit le Cosmopolite. »
D’ailleurs, nous découvrirons bientôt d’autres figures se rapportant soit à la fabrication, soit aux qualités de ce feu secret enclos dans une eau, qui constitue le dissolvant universel. Or, la matière qui sert à le préparer fait précisément l’objet du quatrième motif : un homme expose l’image du Bélier et tient, de la dextre, un objet qu’il est malheureusement impossible de déterminer aujourd’hui (pl. IX). Est-ce un minéral, un fragment d’attribut, un ustensile ou encore quelque morceau d’étoffe ? Nous ne savons. Le temps et le vandalisme ont passé par là. Toutefois, le Bélier demeure, et l’homme, hiéroglyphe du principe métallique mâle, en présente la figure. Cela nous aide à comprendre les paroles de Pernety : « Les Adeptes disent qu’ils tirent leur acier du ventre d’Ariès, et ils appellent aussi cet acier leur aimant. »
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Préparation du Dissolvant Universel
Planche IX |
L’Évolution succède et montre l’oriflamme aux trois pennons, triplicité des Couleurs de l’Œuvre, que l’on trouve décrites dans tous les ouvrages classiques (pl. X).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
L'Evolution
Couleurs et Régimes du Grand Oeuvre
Planche X |
Ces couleurs, au nombre de trois, se développent selon l’ordre invariable qui va du noir au rouge en passant par le blanc. Mais, comme la nature, d’après le vieil adage, – Natura non fecit saltus, – ne fait rien brutalement, il y en a beaucoup d’autres intermédiaires qui apparaissent entre ces trois principales. L’artiste en tient peu de cas parce qu’elles sont superficielles et passagères. Elles n’apportent qu’un témoignage de continuité et de progression des mutations internes. Quant aux couleurs essentielles, elles durent plus longtemps que ces nuances transitoires et affectent profondément la matière même, en marquant un changement d’état dans sa constitution chimique. Ce ne sont point là des teintes fugitives, plus ou moins brillantes, qui jouent à la surface du bain, mais bien des colorations dans la masse qui se traduisent au dehors et résorbent toutes les autres. Il était bon, croyons-nous, de préciser ce point important.
Ces phases colorées, spécifiques de la coction dans la pratique du Grand-Œuvre, ont toujours servi de prototype symbolique ; on attribua à chacune d’elles une signification précise, et souvent assez étendue, pour exprimer sous leur voile certaines vérités concrètes. C’est ainsi qu’il exista, de tous temps, une langue des couleurs, intimement unie à la religion, ainsi que le dit Portal, et qui reparaît, au moyen âge, dans les vitraux des cathédrales gothiques. [Frédéric Portal, Des Couleurs Symboliques. Paris, Treuttel et Würtz, 1857, p. 2.]
La couleur noire fut donnée à Saturne, qui devint, en spagyrie, l’hiéroglyphe du plomb, en astrologie une planète maléfique, en hermétique le dragon noir ou Plomb des Philosophes, en magie la Poule noire, etc. Dans les temples d’Égypte, lorsque le récipiendaire était sur le point de passer les épreuves initiatiques, un prêtre s’approchait de lui et lui glissait à l’oreille cette phrase mystérieuse : « Souviens-toi qu’Osiris est un dieu noir ! » C’est la couleur symbolique des Ténèbres et des Ombres cimmériennes, celle de Satan, à qui l’on offrait des roses noires, et aussi celle du Chaos primitif, où les semences de toutes choses sont confuses et mélangées ; c’est le sable du blason héraldique et l’emblème de l’élément terre, de la nuit et de la mort.
De même que le jour, dans la Genèse, succède à la nuit, la lumière succède à l’obscurité. Elle a pour signature la couleur blanche. Parvenue à ce degré, les Sages assurent que leur matière est dégagée de toute impureté, parfaitement lavée et très exactement purifiée. Elle se présente alors sous l’aspect de granulations solides ou de corpuscules brillants, à reflets adamantins et d’une blancheur éclatante. Aussi, a-t-on appliqué le blanc à la pureté, à la simplicité, à l’innocence. La couleur blanche est celle des Initiés, parce que l’homme qui abandonne les ténèbres pour suivre la lumière passe de l’état profane à celui d’Initié, de pur. Il est, spirituellement, rénové. « Ce terme de Blanc, dit Pierre Dujols, avait été choisi pour des raisons philosophiques très profondes. La couleur blanche, – la plupart des langues l’attestent, – a toujours désigné la noblesse, la candeur, la pureté. Suivant le célèbre Dictionnaire-Manuel hébreu et chaldéen de Genesius, hur, heur, signifie être blanc ; hurim, heurim, désigne les nobles, les blancs, les purs. Cette transcription de l’hébreu plus ou moins variable (hur, heur, hurim, heurim) nous conduit au mot heureux. Les bienheureux, – ceux qui ont été régénérés et lavés par le sang de l’Agneau, – sont toujours représentés avec des robes blanches. Nul n’ignore que bienheureux est encore l’équivalent, le synonyme d’Initié, de noble, de pur. Or, les Initiés étaient en blanc. Les nobles s’habillaient de même. En Égypte, les Mânes étaient aussi vêtus de blanc. Phtah, le Régénérateur, était de même gainé de blanc, pour indiquer la nouvelle naissance des Purs ou des Blancs. Les Cathares, secte à laquelle appartenaient les Blancs de Florence, étaient les Purs (du grec Καθαρός). En latin, en allemand, en anglais, les mots Weiss, White, veulent dire blanc, heureux, spirituel, sage. Par contre, en hébreu, schher caractérise une couleur noire de transition, c’est-à-dire le profane cherchant l’initiation. « L’Osiris noir, qui paraît au commencement du Rituel funéraire, dit Portal, représente cet état de l’âme qui passe de la nuit au jour, de la mort à la vie. »
Quant au rouge, symbole du feu, il marque l’exaltation, la prédominance de l’esprit sur la matière, la souveraineté, la puissance et l’apostolat. Obtenue sous forme de cristal ou poudre rouge, volatile et fusible, la pierre philosophale devient pénétrante et susceptible de guérir les lépreux, c’est-à-dire de transmuer en or les métaux vulgaires que leur oxydabilité rend inférieurs, imparfaits, « malades ou infirmes ».
Paracelse, au Livre des Images, parle ainsi des colorations successives de l’Œuvre : « Quoiqu’il y ait, dit-il, quelques couleurs élémentaires, – car la couleur azurée appartient plus particulièrement à la terre, la verte à l’eau, la jaune à l’air, la rouge au feu, – cependant, les couleurs blanche et noire se rapportent directement à l’art spagyrique, dans lequel on trouve aussi les quatre couleurs primitives, sçavoir le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Or, le noir est la racine et l’origine des autres couleurs ; car toute matière noire peut être réverbérée pendant le tems qui lui est nécessaire, de manière que les trois autres couleurs paroîtront successivement et chacune à son tour. La couleur blanche succède à la noire, la jaune à la blanche et la rouge à la jaune. Or, toute matière parvenue à la quatrième couleur au moyen de la réverbération est la teinture des choses de son genre, c’est-à-dire de sa nature. »
Pour donner quelque idée de l’extension que prit la symbolique des couleurs, – et spécialement des trois majeures de l’Œuvre, – notons que la Vierge est toujours représentée drapée de bleu (correspondant au noir, ainsi que nous le dirons par la suite), Dieu de blanc et le Christ de rouge. Ce sont là les couleurs nationales du drapeau français, lequel, d’ailleurs, fut composé par le maçon écribouille Louis David. Dans celui-ci, le bleu foncé ou le noir représente la bourgeoisie ; le blanc est réservé au peuple, aux pierrots ou paysans, et le rouge à la baillie ou royauté. En Chaldée, les Ziguras, qui furent ordinairement des tours à trois étages, et à la catégorie desquelles appartenait la fameuse Tour de Babel, sont revêtues de trois couleurs : noire, blanche et rouge-pourpre.
Nous avons jusqu’ici parlé des couleurs en théoricien, et, comme les Maîtres l’ont fait avant nous, afin d’obéir à la doctrine philosophique et à l’expression traditionnelle. Peut-être conviendrait-il maintenant d’écrire, en faveur des Fils de Science, plutôt en praticien qu’en spéculatif, et de découvrir ainsi ce qui différencie la similitude de la réalité.
Peu de Philosophes ont osé s’aventurer sur ce terrain glissant. Etteilla [Cf. Le Denier du Pauvre ou la Perfection des métaux. Paris (vers 1785), p. 58.], en nous signalant un tableau hermétique [Ce tableau aurait été peint vers le milieu du XVIIe siècle.] qu’il aurait eu en sa possession, nous a conservé quelques légendes placées au-dessous ; parmi celles-ci, on lit, non sans surprise, ce conseil digne d’être suivi : Ne vous en rapportez point trop à la couleur. – Qu’est-ce à dire ? Les vieux auteurs, de propos délibéré, auraient-ils trompé leurs lecteurs ? Et quelle indication les disciples d’Hermès devraient-ils substituer aux couleurs défaillantes pour reconnaître et suivre la voie droite ?
Cherchez, frères, sans vous rebuter, car ici comme en d’autres points obscurs il vous faut faire un gros effort. Vous n’êtes pas sans avoir lu, en plusieurs endroits de vos ouvrages, que les Philosophes ne parlent clairement que lorsqu’ils veulent écarter les profanes de leur Table ronde. Les descriptions qu’ils donnent de leurs régimes, auxquels ils attribuent des colorations emblématiques, sont d’une limpidité parfaite. Or, vous en devez conclure que ces observations si bien décrites sont fausses et chimériques. Vos livres sont fermés, comme celui de l’Apocalypse, par des sceaux cabalistiques. Il vous faut les briser un à un. La tâche est rude, nous le reconnaissons, mais à vaincre sans péril on triomphe sans gloire.
Apprenez donc, non en quoi une couleur diffère d’une autre, mais plutôt en quoi un régime se distingue du suivant. Et d’abord, qu’est-ce qu’un régime ? – Tout simplement la manière de faire végéter, d’entretenir et d’accroître la vie que votre pierre a reçue dès sa naissance. C’est donc un modus operandi, lequel ne se traduit pas, forcément, par une succession de couleurs diverses. « Celui qui connoîtra le Régime, écrit Philalèthe, sera honoré des princes et des grands de la terre. » Et le même auteur ajoute : « Nous ne vous cachons rien que le Régime. » Or, pour ne point attirer sur notre tête la malédiction des Philosophes, en révélant ce qu’ils ont cru devoir laisser dans l’ombre, nous nous contenterons d’avertir que le Régime de la pierre, c’est-à-dire sa coction, en contient plusieurs autres, entendez plusieurs répétitions d’une même manière d’opérer. Réfléchissez, ayez recours à l’analogie et, surtout, ne vous écartez jamais de la simplicité naturelle. Pensez qu’il vous faut manger tous les jours, afin d’entretenir votre vitalité ; que le repos vous est indispensable parce qu’il favorise, d’une part, la digestion et l’assimilation de l’aliment, et d’autre part, le renouvellement des cellules usées par le labeur quotidien. Bien plus, ne devez-vous pas expulser fréquemment certains produits hétérogènes, déchets ou résidus non assimilables ?
De même, votre pierre a besoin de nourriture pour augmenter sa puissance, et cette nourriture doit être graduée, voire changée à certain moment. Donnez d’abord du lait ; le régime carné, plus substantiel, viendra ensuite. Et n’omettez pas, après chaque digestion, de séparer les excréments, car votre pierre pourrait en être infectée… Suivez donc la nature et lui obéissez le plus fidèlement qu’il vous sera possible. Et vous comprendrez de quelle façon il convient d’effectuer la coction lorsque vous aurez acquis la parfaite connaissance du Régime. Ainsi, vous saisirez mieux l’apostrophe que Tollius adresse aux souffleurs, esclaves de la lettre. « Allez, et vous retirez présentement, vous qui cherchez avec une application extrême vos diverses couleurs dans vos vaisseaux de verre. Vous qui me fatiguez les oreilles avec votre noir corbeau, vous êtes aussi fous que cet homme de l’antiquité qui avoit coutume d’applaudir au théâtre, quoyqu’il y fust seul, parce qu’il s’imaginoit toujours avoir devant les yeux quelque spectacle nouveau. De mesme en faites-vous, lorsque, versant des larmes de joye, vous vous imaginez voir dans vos vaisseaux votre blanche colombe, votre aigle jaune et votre faysan rouge ! Allez, vous dis-je, et vous retirez loin de moy, si vous cherchez la pierre philosophale dans une chose fixe ; car elle ne pénétrera pas plus les corps métalliques que feroit le corps d’un homme les murailles les plus solides…
« Voilà ce que j’avois à vous dire des couleurs, afin qu’à l’avenir vous quittiez vos travaux inutiles ; à quoi j’ajouteray un mot touchant l’odeur.
« La Terre est noire, l’Eau est blanche ; l’air, plus il approche du Soleil, et plus il jaunit ; l’aëther est tout à fait rouge. La mort de même, comme il est dit, est noire, la vie est pleine de lumière ; plus la lumière est pure, plus elle approche de la nature angélique, et les anges sont de purs esprits de feu. Maintenant, l’odeur d’un mort ou d’un cadavre n’est-elle pas fâcheuse et désagréable à l’odorat ? Ainsi, l’odeur puante, chez les Philosophes, dénote la fixation ; au contraire, l’odeur agréable marque la volatilité, parce qu’elle approche de la vie et de la chaleur. » [J. Tollius, Le Chemin du Ciel Chymique. Trad. du Manuductio ad Cœlum Chemicum. Amstelædami, Janss. Waesbergios, 1688.]
Revenant au soubassement de Notre-Dame, nous trouverons, en sixième lieu, la Philosophie, dont le disque porte l’empreinte d’une croix. C’est là l’expression du quaternaire des éléments et le manifeste des deux principes métalliques, soleil et lune, – celle-ci, martelée, – ou soufre et mercure, parents de la pierre, selon Hermès (pl. XI).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Les quatre Elements
et les deux Natures
Planche XI |
Les motifs ornant le côté droit sont de lecture plus ingrate ; noircis et rongés, ils doivent surtout leur détérioration à l’orientation de cette partie du porche. Balayés par les vents d’ouest, sept siècles de rafales les ont effrités jusqu’au point de réduire certains d’entre eux à l’état de silhouettes mousses et floues.
Sur le septième bas-relief de cette série, – le premier à droite, – nous remarquerons une coupe longitudinale de l’Athanor et l’appareillage interne destiné à supporter l’œuf philosophique ; de la main droite, le personnage tient une pierre (pl. XII).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
L'Athanor et la Pierre
Planche XII |
C’est un griffon que l’on voit inscrit dans le cercle suivant. Le monstre mythologique dont la tête et la poitrine sont celles de l’aigle, et qui emprunte au lion le reste du corps, initie l’investigateur aux qualités contraires qu’il faut nécessairement assembler dans la matière philosophale (pl. XIII).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Conjonction du Soufre et du Mercure
Planche XIII |
Nous trouvons en cette image l’hiéroglyphe de la première conjonction, laquelle ne s’opère que peu à peu, au fur et à mesure de ce labeur pénible et fastidieux que les Philosophes ont appelé leurs aigles. La série d’opérations dont l’ensemble aboutit à l’union intime du soufre et du mercure porte aussi le nom de Sublimation. C’est par la réitération des Aigles ou Sublimations philosophiques que le mercure exalté se dépouille de ses parties grossières et terrestres, de son humidité superflue, et s’empare d’une portion du corps fixe, qu’il dissout, absorbe et assimile. Faire voler l’aigle, selon l’expression hermétique, c’est faire sortir la lumière du tombeau et la porter à la surface, ce qui est le propre de toute véritable sublimation. C’est ce que nous enseigne la fable de Thésée et d’Ariane. Dans ce cas, Thésée est θεσ-ειος, la lumière organisée, manifestée, qui se sépare d’Ariane, l’araignée qui est au centre de sa toile, le caillou, la coque vide, le cocon, la dépouille du papillon (Psyché). « Sachez, mon frère, écrit Philalèthe, que l’exacte préparation des Aigles volantes est le premier degré de la perfection, et pour la connaître il faut un génie industrieux et habile… Pour y parvenir, nous avons beaucoup sué et travaillé ; nous avons même passé des nuits sans dormir. Ainsi, vous qui ne faites que commencer, soyez persuadé que vous ne réussirez pas dans la première opération sans un grand travail…
« Comprenez donc, mon frère, ce que disent les Sages, en marquant qu’ils conduisent leurs aigles pour dévorer le lion ; et moins on emploi d’aigles, plus le combat est rude et plus on trouve de difficulté à remporter la victoire. Mais pour perfectionner notre Œuvre, il ne faut pas moins de sept aigles, et l’on devrait même en employer jusqu’à neuf. Et notre Mercure philosophique est l’oiseau d’Hermès, à qui l’on donne aussi le nom d’Oie ou de Cygne, et quelquefois celui de Faysan. » [Lenglet-Dufresnoy, Histoire de la Philosophie Hermétique. – L’Entrée au Palais Fermé du Roy, t. II, p. 35. Paris, Coustelier, 1742.]
Ce sont ces sublimations que décrit Callimaque, dans l’Hymne à Délos (v. 250, 255), lorsqu’il dit, en parlant des cygnes :
… εχυχλωσαντο λιποντες
Εβδοµαχις περι ∆ηλον…
Ογδοον ουχ ετ αεισαν, ο δ’εχθορεν.
« (Les Cygnes) tournèrent sept fois autour de Délos… et ils n’avaient pas encore chanté la huitième fois, lorsqu’Apollon naquit. »
C’est une variante de la procession que Josué fit faire sept fois autour de Jéricho, dont les murs tombèrent avant le huitième tour (Josué, c. VI, 15).
Afin de marquer la violence du combat qui précède notre conjonction, les Sages ont symbolisé les deux natures par l’Aigle et le Lion, de puissance égale, mais de complexion contraire. Le lion traduit la force terrestre et fixe, tandis que l’aigle exprime la force aérienne et volatile. Mis en présence, les deux champions s’attaquent, se repoussent, s’entre-déchirent avec énergie jusqu’à ce qu’enfin l’aigle ayant perdu ses ailes, et le lion son chef, les antagonistes ne fassent plus qu’un même corps, de qualité moyenne et de substance homogène, le Mercure animé.
Au temps déjà lointain où, étudiant de la sublime Science, nous nous penchions sur le mystère tout rempli de lourdes énigmes, il nous souvient d’avoir vu construire un bel immeuble dont la décoration, reflétant nos préoccupations hermétiques, ne laissa pas de nous surprendre. Au dessus de la porte d’entrée, deux jeunes enfants, garçon et fille, enlacés, écartent et soulèvent un voile qui les recouvrait. Leurs bustes émergent d’un amoncellement de fleurs, de feuilles et de fruits. Sur le couronnement d’angle, un haut bas-relief domine ; il offre le combat symbolique de l’aigle et du lion, dont nous venons de parler, et l’on devine aisément que l’architecte eut quelque peine à loger l’emblème encombrant, imposé par une volonté intransigeante et supérieure…
[Cet immeuble, construit en pierres de taille et élevé de six étages, est situé dans le XVIIe arrondissement, à l’angle du boulevard Péreire et de la rue de Monbel. De même, à Tousson, près Malesherbe (Seine-et-Oise), une vieille maison du XVIIIe siècle, d’assez grand air, porte sur sa façade, gravés en caractères de l’époque, l’inscription suivante, dont nous respectons la disposition et l’orthographe :
Par un Laboureur
je fus construite.
sans intérêt et d’un don zellé,
il m’a nommée PIERRE BELLE.
1762.
(L’alchimie portait encore le nom d’Agriculture céleste, et ses Adeptes celui de Laboureurs.)
Le neuvième sujet nous permet de pénétrer davantage le secret de fabrication du Dissolvant universel. Une femme y désigne, – allégoriquement, – les matériaux nécessaires à la construction du vaisseau hermétique ; elle élève une planchette de bois, ayant quelque apparence d’une douve de tonneau, dont l’essence nous est révélée par la branche de chêne que porte l’écusson. Nous retrouvons ici la source mystérieuse, sculptée sur le contrefort du porche, mais le geste de notre personnage trahit la spiritualité de cette substance, de ce feu de nature sans lequel rien ne peut croître ni végéter ici-bas (pl. XIV). C’est cet esprit, répandu à la surface du globe, que l’artiste subtil et ingénieux doit capter au fur et à mesure de sa matérialisation. Nous ajouterons encore qu’il est besoin d’un corps particulier servant de réceptacle, d’une terre attractive où il puisse trouver un principe susceptible de le recevoir et le « corporifier ». « La racine de nos corps est en l’air, disent les Sages, et leurs chefs en terre. » C’est là cet aimant enfermé au ventre d’Ariès, qu’il faut prendre au moment de sa naissance, avec autant d’adresse que d’habileté.
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Les Matériaux nécessaires à la
préparation du Dissolvant
Planche XIV |
« L’eau dont nous nous servons, écrit l’auteur anonyme de la Clef du Cabinet Hermétique, est une eau qui renferme toutes les vertus du ciel et de la terre ; c’est pourquoi elle est le Dissolvant général de toute la Nature ; c’est elle qui ouvre les portes de notre cabinet hermétique et royal ; en elle sont renfermés notre Roy et notre Reine, aussi est-elle leur bain… C’est la Fontaine de Trévisan où le Roy se dépouille de son manteau de pourpre pour se vestir d’un habit noir… Il est vray que cette eau est difficile à avoir ; c’est ce qui fait dire au Cosmopolite, dans son Enigme, qu’elle étoit rare dans l’isle… Cet auteur nous la marque plus particulièrement par ces paroles : elle n’est pas semblable à l’eau de la nüe, mais elle en a toute l’apparence. En un autre endroit, il nous la décrit sous le nom d’acier et d’aimant, car c’est véritablement un aimant qui attire à lui toutes les influences du ciel, du soleil, de la lune et des astres, pour les communiquer à la terre. Il dit que cet acier se trouve dans Ariès, qui marque encore le commencement du Printems, lorsque le soleil parcourt le signe du Bélier… Flamel nous en fait une peinture assez juste, dans les Figures d’Abraham le Juif ; il nous dépeint un vieux chesne creux [Vide supra, p. 96.], d’où sort une fontaine, et de la même eau un jardinier arrose les plantes et les fleurs d’un parterre. Le vieux chesne, qui est creux, marque le tonneau qui est fait du bois de chesne, dans lequel il faut corrompre l’eau qu’il réserve pour arroser les plantes, et qui est bien meilleure que l’eau crue… Or, c’est ici le lieu de découvrir un des grands secrets de cet Art, que les Philosophes ont caché, sans lequel vaisseau vous ne pourrez pas faire cette putréfaction et purification de nos élémens, de même qu’on ne sçauroit faire le vin sans qu’il ait bouilli dans le tonneau. Or, comme le tonneau est fait de bois de chesne, de même le vaisseau doit être en bois de vieux chesne, tourné en rond en dedans, comme un demi-globe, dont les bords soient fort épais en quarré ; à faute de ce, un baril, un autre pareil pour le couvrir. Presque tous les Philosophes ont parlé de ce vaisseau absolument nécessaire pour cette opération. Philalèthe le décrit par la fable du serpent Python, que Cadmus perça d’outre en outre contre un chesne. Il y a une figure dans le Livre des Douze Clefs [Cf. Les Douze Clefs de Philosophie de Frère Basile Valentin. Paris, Moët, 1659, clef 12 Grand-Œuvre (Réeditées par les Éditions de Minuit (1956)).] qui représente cette même opération et le vaisseau où elle se fait, d’où il sort une grande fumée, qui marque la fermentation et l’ébullition de cette eau ; et cette fumée se termine à une fenestre, où l’on voit le ciel, où sont dépeints le soleil et la lune, qui marquent l’origine de cette eau et les vertus qu’elle contient. C’est notre vinaigre mercuriel qui descend du ciel en terre et monte de la terre au ciel. »
Nous avons donné ce texte parce qu’il peut être utile, à condition toutefois qu’on sache le lire avec prudence et le comprendre avec sagesse. C’est ici le cas de répéter encore la maxime chère aux Adeptes : l’esprit vivifie, mais la lettre tue.
Nous voici maintenant en face d’un symbole fort complexe, celui du Lion. Complexe, parce que nous ne pouvons, devant la nudité actuelle de la pierre, nous contenter d’une seule explication. Les Sages ont adjoint au lion divers qualificatifs, soit afin d’exprimer l’aspect des substances qu’ils travaillaient, soit pour en désigner une qualité spéciale et prépondérante. Dans l’emblème du Griffon (huitième motif), nous avons vu que le Lion, roi des animaux terrestres, représentait la partie fixe, basique d’un composé, fixité qui perdait, au contact de la volatilité adverse, la meilleure partie d’elle même, celle qui en caractérisait la forme, c’est-à-dire, en langage hiéroglyphique, la tête. Cette fois, nous devons étudier l’animal seul, et nous ignorons de quelle couleur il était originairement revêtu. En général, le Lion est le signe de l’or, tant alchimique que naturel ; il traduit donc les propriétés physico-chimiques de ces corps. Mais les textes donnent le même nom à la matière réceptive de l’Esprit universel, du feu secret dans l’élaboration du dissolvant. Dans ces deux cas, il s’agit toujours d’une interprétation de puissance, d’incorruptibilité, de perfection, comme l’indique assez, d’ailleurs, le preux à l’épée haute, le chevalier couvert du haubert de mailles, qui le représente (pl. XV).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PÖRCHE CENTRAL
Le Corps fixe
Planche XV |
Le premier agent magnétique servant à préparer le dissolvant, – que certains ont dénommé Alkaest, – est appelé Lion vert, non pas tant parce qu’il possède une coloration verte, que parce qu’il n’a point acquis les caractères minéraux qui distinguent chimiquement l’état adulte de l’état naissant. C’est un fruit vert et acerbe, comparé au fruit rouge et mûr. C’est la jeunesse métallique, sur laquelle l’Évolution n’a pas ouvré, mais qui contient le germe latent d’une énergie réelle, appelée plus tard à se développer. C’est l’arsenic et le plomb à l’égard de l’argent et de l’or. C’est l’imperfection actuelle d’où sortira la plus grande perfection future ; le rudiment de notre embryon, l’embryon de notre pierre, la pierre de notre Élixir. Certains Adeptes, Basile Valentin est de ceux-là, l’ont nommé Vitriol vert, pour déceler sa nature chaude, ardente et saline ; d’autres, Émeraude des Philosophes, Rosée de mai, Herbe saturnienne, Pierre végétale, etc. « Nostre eau prend les noms des feuilles de tous les arbres, des arbres mesmes, et de tout ce qui prend une couleur verte, afin de tromper les insensés », dit Maître Arnaud de Villeneuve.
Quant au Lion rouge, ce n’est autre chose, selon les Philosophes, que la même matière, ou Lion vert, amenée par certains procédés à cette qualité spéciale qui caractérise l’or hermétique ou Lion rouge. C’est ce qui a engagé Basile Valentin à donner ce conseil : « Dissous et nourris le vray Lion du sang du Lion vert, car le sang fixe du Lion rouge est fait du sang volatil du vert, parquoy ils sont tous deux d’une mesme nature. »
De ces interprétations, quelle est la véritable ? – C’est là une question que nous avouons ne pouvoir résoudre. Le lion symbolique était, sans aucun doute, peint ou doré. Quelque trace de cinabre, de malachite ou de métal viendrait aussitôt nous tirer d’embarras. Mais il ne subsiste rien, rien que le calcaire rongé, grisâtre et fruste. Le lion de pierre conserve son secret !
L’extraction du Soufre rouge et incombustible est manifestée par la figure d’un monstre tenant à la fois du coq et du renard. C’est le même symbole dont se servit Basile Valentin dans la troisième de ses Douze Clefs. « C’est ce superbe manteau avec le Sel des Astres, dit l’Adepte, qui suit ce soulfre céleste, gardé soigneusement de peur qu’il ne se gaste, et les faict voller comme un oyseau, tant qu’il sera besoin, et le coq mangera le renard, et se noyera et estouffera dans l’eau, puis, reprenant vie par le feu, sera (afin de jouer chacun leur tour) dévoré par le renard » (pl. XVI).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Union du Fixe et du Volatil
Planche XVI |
Au renard-coq succède le Taureau (pl. XVII).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Le Soufre Philosophique
Planche XVII |
Envisagé comme signe zodiacal, c’est le second mois des opérations préparatoires dans le premier œuvre, et le premier régime du feu élémentaire dans le second. Comme figure de pratique, le taureau et le bœuf étant consacrés au soleil, de même que la vache l’est à la lune, il figure le Soufre, principe mâle, puisque le soleil est dit métaphoriquement, par Hermès, le Père de la pierre. Le taureau et la vache, le soleil et la lune, le soufre et le mercure sont donc des hiéroglyphes de sens identique et désignent les natures primitives contraires, avant leur conjonction, natures que l’Art extrait de mixtes imparfaits.
Des douze médaillons ornant le rang inférieur du soubassement, dix retiendront notre attention ; deux sujets ont, en effet, souffert de mutilations trop profondes pour qu’il soit possible d’en rétablir le sens. Nous passerons donc, à regret, devant les restes informes du cinquième médaillon (côté gauche) et du onzième (côté droit).
Auprès du contrefort qui sépare le porche central du portail nord, le premier motif nous présente un cavalier désarçonné se cramponnant à la crinière d’un cheval fougueux (pl. XVIII).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
La Cohobation
Planche XVIII |
Cette allégorie a trait à l’extraction des parties fixes, centrales et pures, par les volatiles ou éthérées dans la Dissolution philosophique. C’est proprement la rectification de l’esprit obtenu et la cohobation de cet esprit sur la matière grave. Le coursier, symbole de rapidité et de légèreté, marque la substance spirituelle ; son cavalier indique la pondérabilité du corps métallique grossier. À chaque cohobation, le cheval jette bas son cavalier, le volatil quitte le fixe ; mais l’écuyer reprend aussitôt ses droits, et cela tant que l’animal exténué, vaincu et soumis, consente à porter ce fardeau obstiné et ne puisse plus s’en dégager. L’absorption du fixe par le volatil s’effectue lentement et avec peine. Pour y réussir, il faut employer beaucoup de patience et de persévérance et réitérer souvent l’affusion de l’eau sur la terre, de l’esprit sur le corps. Et c’est seulement par cette technique, – longue et fastidieuse, en vérité, – que l’on parvient à extraire le sel occulte du Lion rouge avec le secours de l’esprit du Lion vert. Le coursier de Notre-Dame est le même que le Pégase ailé de la fable (racine πηγη, source). Comme lui, il jette ses cavaliers à terre, qu’ils s’appellent Persée ou Bellérophon. C’est lui encore qui transporte Persée, au travers des airs, chez les Hespérides, et fait jaillir, d’un coup de pied, la fontaine Hippocrène, sur le mont Hélicon, laquelle fut, dit-on, découverte par Cadmos.
Au second médaillon, l’Initiateur nous présente d’une main un miroir, tandis que de l’autre il élève la corne d’Amalthée ; à ses côtés se voit l’Arbre de Vie (pl. XIX). Le miroir symbolise le début de l’ouvrage, l’Arbre de Vie en marque la fin, et la corne d’abondance le résultat.
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Origine et résultat de la Pierre
Planche XIX |
Alchimiquement, la matière première, celle que l’artiste doit élire pour commencer l’Œuvre, est dénommée Miroir de l’Art. « Communément entre les Philosophes, dit Moras de Respour, elle est entendue par le Miroir de l’Art, parce que c’est principalement par elle que l’on a appris la composition des métaux dans les veines de la terre… Aussi est-il dit que la seule indication de nature nous peut instruire. » [De Respour, Rares Expériences sur l’Esprit minéral. Paris, Langlois et Barbin, 1668.] C’est également ce qu’enseigne le Cosmopolite, lorsque, parlant du Soufre, il dit : « En son royaume, il y a un miroir dans lequel on voit tout le monde. Quiconque regarde en ce miroir peut voir et apprendre les trois parties de la Sapience de tout le monde, et, de cette manière, il deviendra très sçavant en ces trois règnes, comme ont été Aristote, Avicenne et plusieurs autres, lesquels, aussi bien que leurs prédécesseurs, ont veu dans ce miroir comment le monde a été créé. » [Nouvelle Lumière Chymique. Traité du Soufre, p. 78. Paris, d’Houry, 1649.] Basile Valentin, dans son Testamentum, écrit de même : « Le corps entier du Vitriol ne doit être reconnu que pour un Miroir de la Science philosophique… C’est un Miroir où l’on voit briller et paraître notre Mercure, notre Soleil et Lune, par où l’on peut montrer en un instant, et prouver à l’incrédule Thomas l’aveuglement de son ignorance crasse. » Pernety, dans son Dictionnaire Mytho-Hermétique, n’a point cité ce terme, soit qu’il ne l’ait pas connu, soit qu’il l’ait volontairement omis. Ce sujet, si vulgaire et méprisé, devient par la suite l’Arbre de Vie, Élixir ou Pierre philosophale, chef-d’œuvre de la nature aidée de l’industrie humaine, le pur et riche joyau alchimique. Synthèse métallique absolue, elle assure à l’heureux possesseur de ce trésor le triple apanage du savoir, de la fortune et de la santé. C’est la corne d’abondance, source intarissable des félicités matérielles de notre monde terrestre. Rappelons enfin que le miroir est l’attribut de la Vérité, de la Prudence et de la Science chez tous les poètes et mythologues grecs.
Voici maintenant l’allégorie du poids de nature : l’alchimiste retire le voile qui enveloppait la balance (pl. XX).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
La Connaissance des Poids
Planche XX |
Tous les Philosophes n’ont guère été prolixes sur le secret des poids. Basile Valentin s’est contenté de dire qu’il fallait « bailler un cygne blanc à l’homme double igné », ce qui correspondrait au Sigillum Sapientum d’Huginus à Barma, où l’artiste tient une balance dont un plateau entraîne l’autre selon le rapport apparent de deux à un. Le Cosmopolite, dans son Traité du Sel, est moins précis encore : « Le poids de l’eau, dit-il, doit estre pluriel, et celui de la terre feuillée blanche ou rouge doit estre singulier. » L’auteur des Aphorismes Basiliens, ou Canons Hermétiques de l’Esprit et de l’Âme, écrit au canon XVI : « Nous commençons notre œuvre hermétique par la conjonction des trois principes préparés sous une certaine proportion, laquelle consiste au poids du corps, qui doit égaler l’esprit et l’âme presque de sa moitié. » [Imprimé à la suite des Œuvres tant Médicinales que Chymiques, du R. P. de Castaigne. Paris, de la Nove, 1681.] Si Raymond Lulle et Philalèthe en ont parlé, beaucoup ont préféré se taire ; certains ont prétendu que la nature seule répartissait les quantités selon une harmonie mystérieuse que l’Art ignorait. Ces contradictions ne résistent guère à l’examen. En effet, nous savons que le mercure philosophique résulte de l’absorption d’une certaine partie de soufre par une quantité déterminée de mercure ; il est donc indispensable de connaître exactement les proportions réciproques des composants, si l’on opère par l’ancienne voie. Nous n’avons pas besoin d’ajouter que ces proportions sont enveloppées de similitudes et couvertes d’obscurité, même chez les auteurs les plus sincères. Mais on doit remarquer, d’autre part, qu’il est possible de substituer l’or vulgaire au soufre métallique ; dans ce cas, l’excès de dissolvant pouvant toujours être séparé par distillation, le poids se trouve ramené à une simple appréciation de consistance. La balance, on le voit, constitue un indice précieux pour la détermination de la voie ancienne, de laquelle l’or paraît devoir être exclu. Nous entendons parler de l’or vulgaire qui n’a souffert ni l’exaltation ni la transfusion, opérations qui, en modifiant ses propriétés et ses caractères physiques, le rendent propre au travail.
Une dissolution particulière et peu employée nous est exprimée par l’un des cartouches que nous étudions. C’est celle du vif-argent vulgaire, afin d’en obtenir le mercure commun des Philosophes, que ceux-ci appellent « notre » mercure, pour le différencier du métal fluide dont il provient. Quoique l’on puisse rencontrer fréquemment des descriptions assez étendues sur ce sujet, nous ne cacherons pas qu’une telle opération nous paraît hasardeuse, sinon sophistique. Dans l’esprit des auteurs qui en ont parlé, le mercure vulgaire, débarrassé de toute impureté et parfaitement exalté, prendrait une qualité ignée qu’il ne possède pas, et serait susceptible de devenir dissolvant à son tour. Une reine, assise sur un trône, renverse d’un coup de pied le valet qui, une coupe à la main, vient lui offrir ses services (pl. XXI).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
La Reine terrasse le Mercure
Servus Fugitivus
Planche XXI |
On ne doit donc voir en cette technique, à supposer qu’elle puisse fournir le dissolvant attendu, qu’une modification de la voie ancienne, et non une pratique spéciale, puisque l’agent reste toujours le même. Or, nous ne voyons pas quel avantage on pourrait retirer d’une solution de mercure obtenue à l’aide du solvant philosophique, celui-ci étant l’agent majeur et secret par excellence. C’est pourtant ce que prétend Sabine Stuart de Chevalier. « Pour avoir le mercure philosophique, écrit cet auteur, il faut dissoudre le mercure vulgaire sans rien diminuer de son poids, car toute sa substance doit être convertie en eau philosophique. Les Philosophes connaissent un feu naturel qui pénètre jusqu’au cœur du mercure et qui l’éteint intérieurement ; ils connaissent aussi un dissolvant qui le convertit en eau argentine pure et naturelle ; elle ne contient ni ne doit contenir aucun corrosif. Aussitôt que le mercure est délivré de ses liens, et qu’il est vaincu par la chaleur, il prend la forme de l’eau, et cette même eau est la chose la plus précieuse qui soit au monde. Il faut bien peu de temps pour faire prendre cette forme au mercure vulgaire. » [Sabine Stuart de Chevalier,
Discours philosophique sur les Trois Principes, ou la Clef du Sanctuaire philosophique. Paris, Quillau, 1781.] On nous pardonnera de ne pas être du même avis, ayant de bonnes raisons, appuyées sur l’expérience, de croire que le mercure vulgaire, dépourvu d’agent propre, pourrait devenir une eau utile à l’Œuvre. Le
servus fugitivus dont nous avons besoin est une eau minérale et métallique, solide, cassante, ayant l’aspect d’une pierre et de liquéfaction très aisée. C’est cette eau coagulée sous forme de masse pierreuse qui est l’Alkaest et le Dissolvant universel. S’il convient de lire les Philosophes, – selon le conseil de Philalèthe, – avec un grain de sel, il conviendrait d’utiliser la salière entière à l’étude de Stuart de Chevalier.
Un vieillard transi de froid, et courbé sous l’arc du médaillon suivant, s’appuie, las et défaillant, sur un bloc de pierre ; une sorte de manchon enveloppe sa main gauche (pl. XXII).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Le Régime de Saturne
Planche XXII |
Il est facile de reconnaître ici la première phase du second Œuvre, alors que le Rebis hermétique, enfermé au centre de l’Athanor, souffre la dislocation de ses parties et tend à se mortifier. C’est le début, actif et doux, du feu de roue symbolisé par le froid et par l’hiver, période embryonnaire où les semences, encloses au sein de la terre philosophale, subissent l’influence fermentative de l’humidité. C’est le règne de Saturne qui va paraître, emblème de la dissolution radicale, de la décomposition et de la couleur noire. « Je suis vieil, débile et malade, lui fait dire Basile Valentin ; pour cette cause, je suis enfermé dans une fosse… Le feu me tourmente grandement, et la mort rompt ma chair et mes os. » Un certain Démétrius, voyageur cité par Plutarque, – les Grecs ont tout dépassé, même dans la gasconnade, – raconte sérieusement que, dans l’une des îles qu’il visita sur la côte d’Angleterre, Saturne s’y trouve emprisonné et enseveli dans un profond sommeil. Le géant Briarée (Égéon) est le geôlier de sa prison. Et voici comment, à l’aide de fables hermétiques, de célèbres auteurs ont écrit l’Histoire !
Le sixième médaillon n’est qu’une répétition fragmentaire du second. L’Adepte s’y retrouve, mains jointes, dans l’attitude de la prière, et semble adresser des actions de grâces à la Nature, figurée sous les traits d’un buste féminin que reflète un miroir. Nous reconnaissons là l’hiéroglyphe du sujet des Sages, miroir dans lequel « on voit toute la nature à découvert » (pl. XXIII).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
Le Sujet des Sages
Planche XXIII |
À droite du porche, le septième médaillon nous montre un vieillard prêt à franchir le seuil du Palais mystérieux. Il vient d’arracher le vélum qui en dérobait l’entrée aux regards profanes. C’est le premier pas accompli dans la pratique, la découverte de l’agent capable d’opérer la réduction du corps fixe, de le réincruder, selon l’expression reçue, en une forme analogue à celle de sa prime substance (pl. XXIV).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
L'Entrée du Sanctuaire
Planche XXIV |
Les alchimistes font allusion à cette opération lorsqu’ils parlent de réanimer les corporifications, c’est-à-dire rendre vivants les métaux morts. C’est
l’Entrée au Palais fermé du Roy, de Philalèthe, la première porte de Ripley et de Basile Valentin, qu’il faut savoir ouvrir. Le vieillard n’est autre que notre Mercure, agent secret dont plusieurs bas-reliefs nous ont révélé la nature, le mode d’action, les matériaux et le temps de préparation. Quant au Palais, il représente l’or vif, ou philosophique, or vil, méprisé de l’ignorant, et caché sous des haillons qui le dérobent aux yeux, bien qu’il soit fort précieux à celui qui en connaît la valeur. Nous devons voir en ce motif une variante de l’allégorie des Lions vert et rouge, du dissolvant et du corps à dissoudre. En effet, le vieillard, que les textes identifient à Saturne, – lequel, dit-on, dévorait ses enfants, – était jadis peint en vert, tandis que l’intérieur visible du Palais offrait une coloration pourpre. Nous dirons plus loin à quelle source on peut se référer pour rétablir, grâce au coloris original, le sens de toutes ces figures. Il est à noter également que l’hiéroglyphe de Saturne, envisagé comme dissolvant, est très ancien. Sur un sarcophage du Louvre, ayant contenu la momie d’un prêtre hiérogrammate de Thèbes, nommé Poéris, on peut observer au côté gauche le dieu Sôou, soutenant le ciel par le secours du dieu Chnouphis (l’âme du monde), tandis qu’à leurs pieds est le dieu Sèr (Saturne), couché, et dont les chairs sont de couleur verte.
Le cercle suivant nous permet d’assister à la rencontre du vieillard et du roi couronné, du dissolvant et du corps, du principe volatil et du sel métallique fixe, incombustible et pur. L’allégorie se rapproche beaucoup du texte parabolique de Bernard Trévisan, où le « prestre ancien et de vieil âge » se montre si bien instruit des propriétés de la fontaine occulte, de son action sur le « roy du pays » qu’elle aime, attire et engloutit. Dans cette voie, et lors de l’animation du mercure, l’or ou roi est dissous peu à peu et sans violence ; il n’en est pas de même dans la seconde où, contrairement à l’amalgamation ordinaire, le mercure hermétique semble attaquer le métal avec une vigueur caractéristique et qui ressemble assez aux effervescences chimiques. Les sages ont dit à ce propos qu’en la Conjonction il s’élevait de violents orages, de grandes tempêtes, et que les flots de leur mer offraient le spectacle d’un « aigre combat ». Certains ont représenté cette réaction par la lutte à outrance d’animaux dissemblables : aigle et lion (Nicolas Flamel) ; coq et renard (Basile Valentin), etc. Mais, à notre avis, la plus jolie description, – la plus initiatique surtout, – est celle que nous laissa le grand philosophe Cyrano de Bergerac du duel effroyable que se livrèrent, sous ses yeux, la Rémore et la Salamandre. D’autres, et ce sont les plus nombreux, puisèrent les éléments de leurs figures dans la genèse primaire et traditionnelle de la Création ; ceux-là ont décrit la formation du composé philosophal en l’assimilant à celle du chaos terrestre, issu des bouleversements et des réactions du feu et de l’eau, de l’air et de la terre.
Pour être plus humain et plus familier, le style de Notre-Dame n’en est ni moins noble, ni moins expressif. Les deux natures y sont figurées par des enfants agressifs et querelleurs qui, en venant aux mains, ne se ménagent point les horions. Au plus fort du pugilat, l’un d’eux laisse choir un pot, l’autre une pierre (pl. XXV).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORCHE CENTRAL
La Dissolution
Combat des deux Natures
Planche XXV |
Il n’est guère possible d’écrire avec plus de clarté ni de simplicité l’action de l’eau pontique sur la matière grave, et ce médaillon fait grand honneur au maître qui l’a conçu.
En cette série de sujets par laquelle nous terminerons la description des figures du grand porche, il apparaît nettement que l’idée directrice eut pour objectif le groupement des points variables dans la pratique de la Solution. Elle seule suffit, en effet, à identifier la voie suivie. La dissolution de l’or alchimique par le Dissolvant Alkaest caractérise la première voie ; celle de l’or vulgaire par notre mercure indique la seconde. Par celle-ci on réalise le mercure animé.
Enfin, une solution seconde, celle du Soufre, rouge ou blanc, par l’eau philosophique, fait l’objet du douzième et dernier bas-relief. Un guerrier laisse tomber son épée et s’arrête, interdit, devant un arbre au pied duquel surgit un bélier ; l’arbre porte trois énormes fruits en boules, et l’on voit émerger de ses branches la silhouette d’un oiseau. On retrouve ici l’arbre solaire que décrit le Cosmopolite dans la Parabole du Traité de la Nature, arbre duquel il faut extraire l’eau. Quant au guerrier, il représente l’artiste qui vient d’accomplir le travail d’Hercule qu’est notre préparation. Le bélier témoigne qu’il a su choisir la saison favorable et la substance propre ; l’oiseau précise la nature volatile du composé « plus céleste que terrestre ». Désormais, il ne lui restera plus qu’à imiter Saturne, lequel, dit le Cosmopolite, « puisa dix parties de cette eau, et incontinent prit le fruit de l’arbre solaire et le mit dans cette eau… Car cette eau est l’Eau de vie, qui a puissance d’améliorer les fruits de cet arbre, de façon que désormais il ne sera plus besoin d’en planter ni enter ; parce qu’elle pourra, par sa seule odeur, rendre tous les autres six arbres de la même nature qu’elle est ». Au surplus, cette image est une réplique de l’expédition fameuse des Argonautes ; nous y voyons Jason auprès du bélier à la toison d’or et de l’arbre aux fruits précieux du Jardin des Hespérides.
Au cours de cette étude, nous eûmes l’occasion de regretter, et les détériorations d’iconoclastes stupides, et la disparition complète du revêtement polychrome que possédait jadis notre admirable cathédrale. Il ne nous reste aucun document bibliographique capable d’aider l’investigateur et de remédier, ne fût-ce qu’en partie, à l’outrage des siècles. Cependant, il n’est point nécessaire de compulser de vieux parchemins, ni de feuilleter vainement d’anciennes estampes : Notre-Dame conserve elle-même le coloris original des figures de son grand porche.
Guillaume de Paris, dont nous devons bénir la perspicacité, sut prévoir le préjudice considérable que le temps porterait à son œuvre. En maître avisé, il fit reproduire minutieusement les motifs des médaillons sur les vitraux de la rose centrale. Le verre vient ainsi compléter la pierre et, grâce au secours de la matière fragile, l’ésotérisme reconquiert sa pureté primitive.
On découvrira là l’intelligence des points douteux de la statuaire. Le vitrail, par exemple, dans l’allégorie de la Cohobation (premier médaillon), nous présente, non un vulgaire cavalier, mais un prince couronné d’or, à veste blanche et bas rouges ; des deux enfants batailleurs, l’un est vert, l’autre violet gris ; la reine terrassant le Mercure porte une couronne blanche, une chemise verte et un manteau pourpre. On sera même surpris d’y rencontrer certaines images disparues de la façade, témoin cet artisan, assis à une table rouge et qui extrait d’un sac de larges pièces d’or ; cette femme, au corsage vert et vêtue d’un bliaut écarlate, lissant sa chevelure devant un miroir ; ces Gémeaux, du zodiaque inférieur, dont l’un est de rubis et l’autre d’émeraude, etc.
En son harmonie, en son unité, quel profond sujet de méditation nous offre l’ancestrale Idée hermétique ! Pétrifiée sur la façade, vitrifiée dans l’orbe énorme de la rose, elle passe du mutisme à la révélation, de la gravité à l’enthousiasme, de l’inertie à l’expression vivante. Fruste, matérielle et froide sous la lumière crue du dehors, elle surgit du cristal en faisceaux colorés et pénètre sous les nefs, vibrante, chaude, diaphane et pure comme la Vérité même.
Et l’esprit ne peut se défendre de quelque trouble en présence de cette autre antithèse, plus paradoxale encore : le flambeau de l’alchimique pensée illuminant le temple de la pensée chrétienne !
Quittons le grand porche et venons au portail nord ou de la Vierge.
Au centre du tympan, sur la corniche médiane, regardez le sarcophage, accessoire d’un épisode de la vie du Christ ; vous y verrez sept cercles : ce sont les symboles des sept métaux planétaires (pl. XXVI) :
Le soleil marque l’or, le vif argent Mercure ;
Ce qu’est Saturne au plomb, Vénus l’est à l’airain ;
La Lune de l’argent, Jupiter de l’étain,
Et Mars du fer sont la figure.
[
La Cabale Intellective. Mss. de la biblioth. de l’Arsenal, S. et A. 72, p. 15.]
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORTAIL DE LA VIERGE
Les Métaux planétaires
Planche XXVI |
Le cercle central est décoré d’une façon particulière, tandis que les six autres se répètent deux à deux, – ce qui n’a jamais lieu dans les motifs purement décoratifs de l’art ogival. Bien plus, cette symétrie s’étend du centre vers les extrémités, ainsi que l’enseigne le Cosmopolite. « Regarde le ciel et les sphères des planètes, dit cet auteur, tu vois que Saturne est le plus haut de tous, auquel succède Jupiter, et puis Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et enfin la Lune. Considère maintenant que les vertus des planettes ne montent pas, mais qu’elles descendent ; mesme l’expérience nous apprend que le Mars se convertit facilement en Vénus, et non le Vénus en Mars, comme plus basse d’une sphère. Ainsi le Jupiter se transmue facilement en Mercure, pour ce que Jupiter est plus haut que Mercure ; celuy-là est le second après le firmament, celuy-cy le second au-dessus de la terre ; et Saturne le plus haut, la Lune la plus basse ; le Soleil se mesle avec tous, mais il n’est jamais amélioré par les inférieurs. Or, tu noteras qu’il y a une grande correspondance entre Saturne et la Lune, au milieu desquels est le Soleil, comme si entre Mercure et Jupiter, Mars et Vénus, lesquels tous ont le Soleil au milieu. » [Nouvelle Lumière chymique. Traité du Mercure, chap. IX, p. 41. Paris, Jean d’Houry, 1649.]
La concordance de mutation des planètes métalliques entre elles est donc indiquée, sur le porche de Notre-Dame, de la manière la plus formelle. Le motif central symbolise le Soleil ; les rosaces des extrémités indiquent Saturne et la Lune ; puis viennent respectivement Jupiter et Mercure ; enfin, de chaque côté du Soleil, Mars et Vénus.
Mais il y a mieux. Si nous analysons cette ligne bizarre qui semble relier les circonférences des roses, nous la verrons formée par une succession de quatre croix et de trois crosses, dont l’une à spire simple et les deux autres à double volute. Remarquez, en passant, que s’il s’agissait encore ici d’une volonté ornementale, il faudrait nécessairement six ou huit attributs, toujours afin de conserver une parfaite symétrie ; il n’en est rien, et ce qui achève de prouver que le sens symbolique est voulu, c’est qu’un espace, celui de gauche, demeure libre.
Les quatre croix, de même qu’en la notation spagyrique, représentent les métaux imparfaits ; les crosses à double spirale, les deux parfaits, et la crosse simple, le mercure, demi-métal ou semi-parfait.
Mais si, quittant le tympan, nous abaissons le regard vers la partie gauche du soubassement, divisé en cinq niches, nous remarquerons entre l’extrados de chaque arcature de curieuses figurines.
Voici, en allant de l’extérieur vers le pied-droit, le chien et les deux colombes (pl. XXVII), que nous rencontrons décrits dans l’animation du mercure exalté ; ce chien de Corascène, dont parlent Artephius et Philalèthe, qu’il faut savoir séparer du compost à l’état de poudre noire, et ces Colombes de Diane, autre énigme désespérante, sous laquelle la spiritualisation et sublimation du mercure philosophal sont cachées.
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORTAIL DE LA VIERGE
Le Chien et les Colombes
Planche XXVII |
L’agneau, emblème de l’édulcoration du principe arsenical de la Matière ; l’homme retourné, qui traduit au mieux l’apophtegme alchimique solve et coagula, lequel enseigne à réaliser la conversion élémentaire en volatilisant le fixe et fixant le volatil (pl. XXVIII) :
Si le fixe tu sçays dissouldre
Et le dissoult faire voller,
Puis le vollant fixer en pouldre,
Tu as de quoy te consoler.
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORTAIL DE LA VIERGE
"Solve et Coagula"
Planche XXVIII |
C’est dans cette partie du porche que se trouvait sculpté autrefois l’hiéroglyphe majeur de notre pratique : le Corbeau.
Principale figure du blason hermétique, le corbeau de Notre-Dame avait, de tout temps, exercé une attraction très vive sur la tourbe des souffleurs ; c’est qu’une vieille légende le désignait comme l’unique repère d’un dépôt sacré. On raconte, en effet, que Guillaume de Paris, « lequel, dit Victor Hugo, a sans doute été damné pour avoir attaché un si infernal frontispice au saint poème que chante éternellement le reste de l’édifice », aurait caché la pierre philosophale dans l’un des piliers de l’immense nef. Et le point exact de cette logette mystérieuse se trouvait précisément déterminé par l’angle visuel du corbeau…
Ainsi, d’après la légende, l’oiseau symbolique fixait jadis, du dehors, la place inconnue du pilier secret où le trésor serait scellé.
Sur la face externe des piliers sans imposte qui supportent le linteau et la naissance des voussoirs, sont représentés les signes du zodiaque. On rencontre en premier lieu, et de bas en haut, Ariès, puis Taurus, et, au-dessus, Gemini. Ce sont les mois printaniers indiquant le début du travail et le temps propice aux opérations.
On nous objectera sans doute que le zodiaque peut ne pas avoir une portée occulte et représenter tout uniment la zone des constellations. C’est chose possible. Mais, dans ce cas, il nous faudrait retrouver l’ordre astronomique, la succession cosmique des figures zodiacales que nos Anciens n’ont point ignorée. Or, à Gemini succède Leo, lequel usurpe la place de Cancer, rejeté sur le pilier opposé. L’imaigier a donc voulu indiquer, par cette habile transposition, la conjonction du ferment philosophique, – ou Lion, – avec le composé mercuriel, union qui se doit accomplir vers la fin du quatrième mois du premier Œuvre.
On remarque encore, sous ce porche, un petit bas-relief quadrangulaire vraiment curieux. Il synthétise et exprime la condensation de l’Esprit universel, lequel forme, aussitôt matérialisé, le fameux Bain des astres où le soleil et la lune chimiques doivent se baigner, changer de nature et rajeunir. Nous y voyons un enfant tomber d’un creuset, grand comme une jarre, que maintient un archange debout, nimbé, l’aile étendue, et qui paraît frapper l’innocent. Tout le fond de la composition est occupé par un ciel nocturne et constellé (pl. XXIX). Nous reconnaissons en ce sujet l’allégorie très simplifiée, chère à Nicolas Flamel, du Massacre des Innocents, que nous verrons bientôt sur un vitrail de la Sainte-Chapelle.
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORTAIL DE LA VIERGE
Le Bain des Astres
Condensation de l'Esprit universel
Planche XXIX |
Sans entrer par le menu dans la technique opératoire, – ce qu’aucun Auteur n’a osé faire, – nous dirons cependant que l’Esprit universel, corporifié dans les minéraux sous le nom alchimique de Soufre, constitue le principe et l’agent efficace de toutes les teintures métalliques. Mais on ne peut obtenir cet Esprit, ce sang rouge des enfants qu’en décomposant ce que la nature avait d’abord assemblé en eux. Il est donc nécessaire que le corps périsse, qu’il soit crucifié et qu’il meure si l’on extraire l’âme, vie métallique et Rosée céleste, qu’il tenait enfermée. Et cette quintessence, transfusée dans un corps pur, fixe, parfaitement digéré, donnera naissance à une nouvelle créature, plus resplendissante qu’aucune de celles dont elle provient. Les corps n’ont point d’action les uns sur les autres ; l’esprit, seul, est actif et agissant.
C’est pourquoi les Sages, sachant que le sang minéral dont ils avaient besoin pour animer le corps fixe et inerte de l’or n’était qu’une condensation de l’Esprit universel, âme de toute chose ; que cette condensation sous la forme humide, capable de pénétrer et rendre végétatifs les mixtes sublunaires, ne s’accomplissait que la nuit, à la faveur des ténèbres, du ciel pur et de l’air calme ; qu’enfin la saison pendant laquelle elle manifestait son activité avec le plus d’activité et d’abondance correspondait au printemps terrestre, les Sages, pour ces raisons combinées, lui donnèrent le nom de Rosée de Mai. Aussi, Thomas Corneille ne nous surprend-il pas lorsqu’il assure qu’on appelait les grands maîtres de la Rose-Croix Frères de la Rosée-Cuite, signification qu’ils donnaient eux-mêmes aux initiales de leur ordre : F. R. C. [Dictionnaire des Arts et des Sciences, art. Rose-Croix. Paris, Coignart, 1731.]
Nous voudrions pouvoir en dire davantage sur ce sujet d’extrême importance et montrer comment la Rosée de Mai (Maïa était mère d’Hermès), – humidité vivifiante du mois de Marie, la Vierge mère, – s’extrait aisément d’un corps particulier, abject et méprisé, dont nous avons déjà décrit les caractéristiques, s’il n’était des bornes infranchissables… Nous touchons au plus haut secret de l’Œuvre et désirons tenir notre serment. C’est là le Verbum demissum du Trévisan, la Parole perdue des francs-maçons médiévaux, celle que toutes les Fraternités hermétiques espéraient retrouver, et qui faisaient de cette recherche le but de leurs travaux et la raison d’être de leur existence.
[Parmi les plus célèbres centres d’initiaion de ce genre, nous citerons les ordres des Illuminés, des Chevaliers de l’Aigle noir, des Deux Aigles, de l’Apocalypse ; les Frères Initiés de l’Asie, de la Palestine, du Zodiaque ; les Sociétés des Frères noirs, des Élus Coëns, des Mopses, des Sept-Épées, des Invisibles, des Princes de la Mort ; les Chevaliers du Cygne, institués par Élie, les Chevaliers du Chien et du Coq, les Chevaliers de la Table ronde, de la Genette, du Chardon, du Bain, de la Bête morte, de l’Amarante, etc.]
Post tenebras lux. Ne l’oublions pas. La lumière sort des ténèbres ; elle est diffuse dans l’obscurité, dans le noir, comme le jour l’est dans la nuit. C’est de l’obscur Chaos que la lumière fut extraite et ses radiations assemblées, et si, au jour de la Création, l’Esprit divin se mouvait sur les eaux de l’Abîme, – Spiritus Domini ferebatur super aquas, – cet invisible esprit ne pouvait d’abord être distingué de la masse aqueuse et se confondait avec elle.
Enfin, souvenez-vous que Dieu employa six jours à parfaire son Grand-Œuvre ; que la lumière fut séparée le premier jour et que les jours suivants se déterminèrent, comme les nôtres, par des intervalles réguliers et alternatifs d’obscurité et de lumière :
A minuit, une Vierge mère,
Produit cet astre lumineux ;
En ce moment miraculeux
Nous appelons Dieu notre frère.
Revenons sur nos pas et arrêtons-nous au portail sud, appelé encore porche de Sainte-Anne. Il ne nous offre qu’un seul motif, mais l’intérêt en est considérable, parce qu’il décrit la pratique la plus courte de notre Science et mérite d’être, à cet égard, classé au premier rang des paradigmes lapidaires.
« Vois, dit Grillot de Givry, sculpté sur le portail droit de Notre-Dame de Paris, l’évêque juché sur l’aludel où se sublime, enchaîné dans les limbes, le mercure philosophal. Il t’enseigne d’où provient le feu sacré ; et le chapitre laissant, par une tradition séculaire, cette porte fermée toute l’année, t’indique que c’est ici la voie non vulgaire, inconnue à la foule, et réservée au petit nombre des élus de la Sapience. » [Grillot de Givry, Le Grand-Œuvre. Paris, Chacornac, 1907, p. 27.]
[À Saint-Pierre de Rome, la même porte, nommée Porte sainte ou jubilaire, est dorée et murée ; le pape l’ouvre à coups de marteau tous les vingt-cinq ans, soit quatre années par siècle.]
Peu d’alchimistes consentent à admettre la possibilité de deux voies, l’une courte et facile, nommée voie sèche, l’autre plus longue et plus ingrate, dite voie humide. Cela peut tenir à ce fait que beaucoup d’auteurs traitent exclusivement du procédé le plus long, soit parce qu’ils ignorent l’autre, soit parce qu’ils préfèrent garder le silence plutôt qu’en enseigner les principes. Pernety refuse de croire à cette duplicité de moyens, tandis que Huginus à Barma affirme, au contraire, que les maîtres anciens, les Geber, les Lulle, les Paracelse, avaient chacun un procédé qui leur était propre.
Chimiquement, rien ne s’oppose à ce qu’une méthode, employant la voie humide, ne puisse être remplacée par une autre utilisant des réactions sèches pour aboutir au même résultat. Hermétiquement, l’emblème qui nous occupe en est une preuve. Nous en trouvons une seconde dans l’Encyclopédie du XVIIIe siècle, où l’on assure que le Grand-Œuvre peut s’accomplir par deux voies, l’une dite voie humide, plus longue mais plus en honneur, et l’autre, ou voie sèche, beaucoup moins appréciée. Dans celle-ci, il faut « cuire le Sel céleste, qui est le mercure des Philosophes, avec un corps métallique terrestre, dans un creuset et à feu nu, pendant quatre jours ».
Dans la seconde partie d’un ouvrage attribué à Basile Valentin, mais qui serait plutôt l’œuvre de Senior Zadith, l’auteur paraît envisager la voie sèche, lorsqu’il écrit que, « pour parvenir à cet Art, il n’est requis grand travail ny peine, et les despens sont petits, les instruments de peu de valeur. Car cet Art peut estre appris en moins de douze heures, et de l’espace de huict jours mené à perfection, quand il y a en soy son propre principe ». [Azoth, ou Moyen de faire l’Or caché des Philosophes. Paris, Pierre Moët, 1659, p. 140.]
Philalèthe, au chapitre XIX de l’Introïtus, dit, après avoir parlé de la voie longue, qu’il assure ennuyeuse et propre seulement pour les personnes riches : « Mais, par notre voie, il ne faut pas plus d’une semaine ; Dieu a réservé cette voie rare et facile pour les pauvres méprisés et ses saints couverts d’abjections. » Au surplus, dans ses Remarques sur ce chapitre, Lenglet-Dufresnoy pense que « cette voie se fait par le double mercure philosophique. Par là, ajoute-t-il, l’Œuvre s’accomplit en huit jours, au lieu qu’il faut près de dix-huit mois pour la première voye ».
Cette voie abrégée, mais couverte d’un voile épais, a été nommée par les Sages le Régime de Saturne. La cuisson de l’Œuvre, au lieu de nécessiter l’emploi d’un vase de verre, ne réclame que le secours d’un simple creuset. « Je brouilleray ton corps dans un vase de terre où je l’enseveliray », écrit un auteur célèbre, lequel dit encore plus loin : « Fais un feu dans ton verre, c’est-à-dire dans la terre qui le tient enfermé. Cette briefve méthode, dont nous t’avons libéralement instruit, me semble la plus courte voie et la vraye sublimation philosophique pour parvenir à la perfection de ce grave labeur. » [Salomon Trismosin, La Toyson d’Or. Paris, Ch. Sevestre, 1612, p. 72 et 110.] C’est ainsi qu’on pourrait expliquer cette maxime fondamentale de la Science : un seul vaisseau, une seule matière, un seul fourneau.
Cyliani, dans la Préface de son livre, relate les deux procédés en ces termes :
« Je crois prévenir ici de ne jamais oublier qu’il ne faut que deux matières de même origine, l’une volatile, l’autre fixe ; qu’il y a deux voies, la voie sèche et la voie humide. Je suis cette dernière, de préférence, par devoir, quoique la première me soit très familière : elle se fait avec une matière unique. » [Cyliani, Hermès dévoilé. Paris, F. Locquin, 1832.]
Henri de Linthaut apporte également un témoignage favorable à la voie sèche lorsqu’il écrit : « Ce secret icy surpasse tous les secrets du monde, car vous pouvés en peu de tems, sans grand soin ny travail, parvenir à une grande projection, de laquelle voyés Isaac Hollandois qui en parle amplement. » [H. de Lintaut, L’Aurore. Mss. bibl. de l’Arsenal, S. A. F. 169, n° 3020.] Notre auteur, malheureusement, n’est pas plus prolixe que ses confrères.
« Quand je pense, écrit Henckel [J.-F. Henckel, Traité de l’Appropriation. Paris, Thomas Hérissant, 1760, p. 375, § 416.], que l’artiste Elias, cité par Helvétius, prétend que la préparation de la pierre philosophale se commence et s’achève en quatre jours de temps, et qu’il a montré en effet cette pierre encore adhérente aux tessons du creuset, il me semble qu’il ne seroit pas si absurde de mettre en question si ce que les alchymistes appellent des grands mois ne seroit pas autant de jours, ce qui seroit un espace de temps très borné ; et s’il n’y auroit pas une méthode dans laquelle toute l’opération ne consiste qu’à tenir longtemps les matières dans le plus grand degré de fluidité, ce qu’on obtiendroit par un feu violent, entretenu par l’action des soufflets ; mais cette méthode ne peut pas s’exécuter dans tous les laboratoires, et peut-être même tout le monde ne la trouveroit-il pas praticable. »
L’emblème hermétique de Notre-Dame, qui avait déjà, au XVIIe siècle, fixé l’attention du sagace de Laborde, occupe le trumeau du porche, du stylobate à l’architrave, et s’y trouve sculpté par le détail sur les trois côtés du pilier engagé. [De Laborde,
Explications de l’Énigme trouvée à un pilier de l’Église Notre-Dame de Paris. Paris, 1636.] C’est une haute et noble statue de saint Marcel, au chef mitré, surmonté d’un dais à tourelles et dépourvue, selon nous, de toute signification secrète. L’évêque se tient debout sur un dé oblong finement fouillé, orné de quatre colonnettes et d’un admirable dragon byzantin, le tout supporté par un socle bordé d’une frise et que relie au soubassement une moulure à talon renversé. Dé et socle ont, seuls, une réelle valeur hermétique (pl. XXX).
 |
NOTRE-DAME DE PARIS
PORTAIL SAINT-ANNE
PILIER SAINT MARCEL
(MUSEE DE CLUNY)
Le Mercure Philosophique et le Grand Oeuvre
Planche XXX |
Malheureusement ce pilier, si magnifiquement décoré, est presque neuf : douze lustres nous séparent à peine de sa réfection, car il a été refait et … modifié.
Nous n’avons pas à discuter ici l’opportunité de telles réfections, et ne prétendons point soutenir qu’il faille laisser croître, sans soins, la lèpre du temps sur un corps splendide ; cependant, et en tant que philosophe, nous ne pouvons que regretter la désinvolture qu’affectent les restaurateurs vis-à-vis des créations ogivales. S’il convenait de remplacer l’évêque noirci et de refaire sa base ruinée, la chose était facile ; il suffisait de copier le modèle, de le transcrire fidèlement. Qu’il contînt un sens caché, peu importait : l’imitation servile l’eût conservé. On voulut faire mieux encore et, si l’on s’en tint aux lignes du saint évêque et du joli dragon, par contre on ornementa le socle de rinceaux et d’entrelacs romans, aux lieu et place de besants et des fleurs qui s’y voyaient autrefois.
Cette seconde édition, revue, corrigée et augmentée, est, certes, plus riche que la première, mais le symbole en est tronqué, la science mutilée, la clef perdue, l’ésotérisme éteint. Le temps corrode, use, désagrège, effrite le calcaire ; la netteté en souffre, mais le sens demeure. Survient le restaurateur, le guérisseur de pierres ; en quelques coups de ciseau il ampute, rogne, oblitère, transforme, fait d’une ruine authentique un artificiel et brillant archaïsme, blesse et panse, retranche et surcharge, élague et contrefait au nom de l’Art, de la Forme ou de la Symétrie, sans le moindre souci de la pensée créatrice. Grâce à cette prothèse moderne, nos vénérables dames seront toujours jeunes !
Hélas ! en touchant à l’enveloppe on a laissé s’exhaler l’âme.
Disciples d’Hermès, allez à la cathédrale reconnaître la place et l’ordonnance du pilier neuf, et prenez ensuite le chemin que suivit l’original. Traversez la Seine, entrez au musée de Cluny et vous aurez la satisfaction de l’y trouver, auprès de l’escalier d’accès au frigidarium des Thermes de Julien. C’est là qu’est venu s’échouer le beau fragment.
[L’itinéraire n’est plus valable, puisque, depuis quelque six ans, le pilier symbolique, faisant l’objet d’une vénération tant justifiée, est revenu à Notre-Dame, non loin de la place qui fut sienne durant plus de cinq cent années. En effet, on le trouvera, dans une pièce, au plafond haut et en croisée d’ogives surbaissées, de la tour nord, laquelle sera, tôt ou tard, disposée en musée et possède, au sud, sa réplique, sur le plan même et de l’autre côté de la plate-forme du grand orgue.
Provisoirement, la curiosité, quelqu’en soit la nature, n’est plus aussi facilement satisfaite, qui, néanmoins, poussera le visiteur jusqu’au nouveau refuge de la sculpture initiatique. Hélas ! une surprise l’y attend, qui l’attristera tout aussitôt et qui réside dans l’amputation, infiniment regrettable, de presque tout le corps du dragon, maintenant réduit à sa partie antérieure encore pourvue de ses deux pattes.
La bête monstrueuse, avec la grâce d’un gros lézard, étreignait l’athanor, y laissant dans les flammes le petit roi triplement couronné, qui est le fils de ses œuvres violentes sur la morte adultère. Seul est apparent le visage de l’enfant minéral subissant les « laveures ignées » dont parle Nicolas Flamel. Il est ici emmailloté et ficelé, selon la mode médiévale, comme on le trouve encore sous la figure en porcelaine du tout petit « baigneur » qui est inclu dans la galette du jour de la fête des Rois. (Conf. Alchimie, op. cit., p. 89.)]
Cette énigme du travail alchimique, solutionnée d’une manière exacte, – au moins en partie, – par François Cambriel, lui valut d’être cité par Champfleury dans ses Excentriques, et par Tcherpakoff dans ses Fous littéraires. Nous fera-t-on le même honneur ?
Sur le socle cubique vous remarquerez, au côté droit, deux besants en relief, massifs et circulaires ; ce sont les matières ou natures métalliques, – sujet et dissolvant, – avec lesquelles on doit commencer l’Œuvre. À la face principale, ces substances, modifiées par les opérations préliminaires, ne sont plus représentées sous la forme de disques, mais comme des rosaces à pétales soudés. Il convient, en passant, d’admirer sans réserve l’habilité avec laquelle l’artiste a su traduire la transformation des produits occultes, dégagés des accidents externes et des matériaux hétérogènes qui les enrobaient dans la minière. Au côté gauche, les besants, devenus rosaces, affectent cette fois la forme de fleurs décoratives à pétales soudés, mais à calice apparent. Quoique bien rongées et presque effacées, il est facile cependant d’y retrouver la trace du disque central. Elles représentent toujours les mêmes sujets ayant acquis d’autres qualités ; le graphique du calice indique que les racines métalliques ont été ouvertes et sont disposées à manifester leur principe séminal. Telle est la traduction ésotérique des petits motifs du socle. Le dé va nous fournir l’explication complémentaire.
Les matières préparées et unies en un seul composé doivent subir la sublimation ou dernière purification ignée. Dans cette opération, les parties adustibles se détruisent, les matières terreuses perdent leur cohésion et se désagrègent, tandis que les principes purs, incombustibles, s’élèvent sous une forme très différente de celle qu’affectait le composé. C’est là le Sel des Philosophes, le Roi couronné de gloire, qui prend naissance dans le feu et doit se réjouir dans le mariage subséquent, afin, dit Hermès, que les choses occultes deviennent manifestes. Rex ab igne veniet, ac conjugio gaudebit et occulta patebunt. De ce roi, le dé ne montre que le chef, émergeant des flammes purifiantes. Il ne serait pas certain, à l’heure présente, que le bandeau frontal gravé sur la tête humaine appartienne à une couronne ; on pourrait aussi bien y discerner, d’après le volume et l’aspect du crâne, une sorte de bassinet ou de berruier. Mais nous possédons, heureusement, le texte d’Esprit Gobineau de Montluisant, dont le livre fut écrit « le mercredy 20 de may 1640, veille de la glorieuse Ascension de Nostre Sauveur Jésus-Christ », et qui nous apprend positivement que le roi porte une triple couronne. [Explication très curieuse des Énigmes et Figures hiéroglyphiques, Physiques, qui sont au grand portail de l’Église Cathédrale et Métropolitaine de Notre-Dame de Paris.]
Après l’élévation des principes purs et colorés du composé philosophique, le résidu est prêt, dès lors, à fournir le sel mercuriel, volatil et fusible, auquel les vieux auteurs ont souvent donné l’épithète de Dragon babylonien.
L’artiste créateur du monstre emblématique a produit un véritable chef-d’œuvre, et, quoique mutilé, – le pennage gauche est brisé, – il n’en demeure pas moins un morceau de statuaire remarquable. L’animal fabuleux émerge des flammes et sa queue paraît sortir de l’être humain dont elle entoure, en quelque sorte, la tête. Puis, dans un mouvement de torsion qui le cambre sur la voussure, il vient étreindre l’athanor de ses griffes puissantes.
Si nous examinons l’ornementation du dé, nous y remarquerons des cannelures groupées, légèrement creuses, à sommet curviligne et base plane. Celles de la paroi gauche sont accompagnées d’une fleur à quatre pétales dégagés, exprimant la matière universelle, quaternaire des éléments premiers, selon la doctrine d’Aristote répandue au moyen âge. Directement au-dessous, le duo des natures que l’alchimiste travaille et dont la réunion fournit le Saturne des Sages, dénomination anagrammatique de natures. Dans l’entre-colonnement de face, quatre cannelures, allant en décroissant, selon l’obliquité de la rampe flammée, symbolisent le quaternaire des éléments seconds ; enfin, de chaque côté de l’athanor, et sous les serres même du dragon, les cinq unités de la quintessence, comprenant les trois principes et les deux natures, puis leur totalisation sous le nombre dix « auquel tout finit et se termine ».
L.-P. François Cambriel prétend que la multiplication du Soufre, – blanc ou rouge, – n’est pas indiquée dans l’hiéroglyphe étudié ; nous n’oserions nous prononcer aussi catégoriquement. [L.-P. François Cambriel, Cours de Philosophie Hermétique ou d’Alchimie en dix-neuf leçons. Paris, Lacour et Maistrasse, 1843.] La multiplication, en effet, ne peut se réaliser qu’à l’aide du mercure, qui joue le rôle de patient dans l’Œuvre, et par coctions ou fixations successives. C’est donc sur le dragon, image du mercure, que nous devrions chercher le symbole représentatif de la nutrition et de la progression du Soufre ou de l’Élixir. Or, si l’auteur avait apporté plus de soin à l’examen des particularités décoratives, il eût certainement remarqué :
1° Une bande longitudinale partant de la tête et suivant la ligne des vertèbres jusqu’à l’extrémité de la queue ;
2° Deux bandes analogues, posées obliquement, une sur chaque aile ;
3° Deux bandes plus larges, transversales, ceignant la queue du dragon, la première au niveau du pennage, l’autre au-dessus de la tête du roi. Toutes ces bandes sont ornées de cercles pleins se touchant en un point de leur circonférence.
Quant à leur signification, elle nous sera fournie par les cercles des bandes caudales : le centre en est très nettement indiqué sur chacun d’eux. Or, les hermétistes savent que le roi des métaux est figuré par le signe solaire, c’est-à-dire une circonférence avec ou sans point central. Il nous paraît donc vraisemblable de penser que, si le dragon est couvert à profusion du symbole aurique, – il en porte jusque sur les serres de la patte droite, – c’est qu’il est capable de transmuter en quantité ; mais il ne peut acquérir cette puissance que par une série de cuissons ultérieures avec le Soufre ou Or philosophique, ce qui constitue les multiplications.
Tel est, aussi clairement exposé que possible, le sens ésotérique que nous avons cru reconnaître sur le joli pilier de la porte Sainte-Anne. D’autres, plus érudits ou plus savants, en donneront peut-être une interprétation meilleure, car nous ne prétendons imposer à personne la thèse développée ici. Il nous suffira de dire qu’elle concorde en général avec celle de Cambriel. Mais, en revanche, nous ne partageons pas l’opinion de cet auteur, qui voulu étendre, sans preuve, le symbolisme du dé à la statue elle-même.
Certes, il est toujours pénible d’avoir à reprocher une erreur manifeste, et plus affligeant encore de relever certaines affirmations pour les détruire en bloc. Il le faut pourtant, quelque regret que nous en ayons. La science que nous étudions est aussi positive, aussi réelle, aussi exacte que l’optique, la géométrie ou la mécanique ; ses résultats aussi tangibles que ceux de la chimie. Si l’enthousiasme, la foi intime y sont des stimulants, des auxiliaires précieux ; s’ils entrent pour une part dans la conduite et l’orientation de nos recherches, nous devons cependant en éviter les écarts, les subordonner à la logique, au raisonnement, les soumettre au critérium de l’expérience. Souvenons-nous que ce sont les friponneries des souffleurs avides, les pratiques insensées des charlatans, les inepties d’écrivains ignares et sans scrupule qui ont jeté le discrédit sur la vérité hermétique. On doit voir juste et bien dire. Pas un mot qui ne soit pesé, pas une pensée qui n’ait été passée au crible du jugement et de la réflexion. L’Alchimie demande à être épurée ; dégageons-la des macules dont ses partisans mêmes l’ont parfois souillée : elle en sortira plus robuste et plus saine, sans perdre rien de son charme ni de sa mystérieuse attraction.
François Cambriel, à la trente-troisième page de son livre, s’exprime ainsi : « De ce mercure, il résulte la Vie représentée par l’évêque qui est au dessus dudit dragon… Cet évêque porte un doigt à sa bouche, pour dire à ceux qui le voient et qui viennent prendre connaissance de ce qu’il représente… taisez-vous, n’en dites rien !… »
Le texte est accompagné d’une planche gravée, d’un bien mauvais dessin, – ce qui est peu de chose, – mais notoirement truqué, – ce qui est grave. Saint Marcel y tient une crosse, courte comme un drapeau de garde-barrière ; la tête est coiffée d’une mitre à décoration cruciforme, et, superbe anachronisme, l’élève de Prudence est barbu ! Détail piquant : dans le dessin de face, le dragon a la gueule de profil et ronge le pied du pauvre évêque qui semble, d’ailleurs, s’en soucier fort peu. Calme et souriant, il s’applique, de l’index, à clore ses lèvres dans le geste du silence commandé.(pl. XXXa)
 |
Cours de Philosophie hermétique
de Cambriel
Planche XXXa
(Ajout L.A.T.) |
Le contrôle est aisé, puisque nous possédons l’œuvre originale, et la supercherie éclate au premier coup d’œil. Notre saint est, selon la coutume médiévale, absolument glabre ; sa mitre, très simple, n’offre aucune ornementation ; la crosse qu’il soutient de la main gauche, s’applique par son extrémité inférieure sur la gueule du dragon. Quant au geste fameux des personnages du Mutus Liber et d’Harpocrate, il est sorti tout entier de l’imagination excessive de Cambriel. Saint Marcel est représenté bénissant, dans une attitude pleine de noblesse, le front incliné, l’avant-bras replié, la main au niveau de l’épaule, l’index et le médius levés. (pl.XXXb)
 |
PILIER SAINT-MARCEL
Planche XXXb
(Ajout L.A.T.) |
Il est difficile de croire que deux observateurs aient pu être le jouet d’une même illusion. Cette fantaisie émane-t-elle de l’artiste ou fut-elle imposée par le texte ? La description et le graphique ont entre eux une telle concordance qu’on nous permettra d’accorder peu de créance aux qualités d’observation manifestées dans cet autre fragment du même auteur.
« Passant un jour devant l’église Notre-Dame de Paris, j’examinai avec beaucoup d’attention les belles sculptures dont les trois portes sont ornées, et je vis à l’une de ces trois portes un hiéroglyphe des plus beaux, duquel je ne m’étais jamais aperçu, et pendant plusieurs jours de suite j’allais le consulter pour pouvoir donner le détail de tout ce qu’il représentait, à quoi je parvins. Par ce qui suit, le lecteur s’en convaincra, et mieux encore en se transportant de lui-même sur les lieux. »
Voilà qui ne manque, en vérité, ni de hardiesse ni d’impudence. Si le lecteur de Cambriel se rend à son invitation, il ne trouvera sur le trumeau de la porte Sainte-Anne que l’exotérisme légendaire de saint Marcel. Il y verra l’évêque tuant le dragon en le touchant de sa crosse, ainsi que le rapporte la tradition. Qu’il symbolise, au surplus, la vie de la matière, c’est là une opinion personnelle que l’auteur est libre d’exprimer ; mais qu’il réalise en fait le tacere de Zoroastre, cela n’est pas et ne fut jamais.
De telles incartades sont regrettables et indignes d’un esprit sincère, probe et droit.
Édifiées par les Frimasons médiévaux pour assurer la transmission des symboles et de la doctrine hermétiques, nos grandes cathédrales exercèrent, dès leur apparition, une influence marquée sur nombre de spécimens plus modestes de l’architecture civile ou religieuse.
Flamel se plaisait à revêtir d’emblèmes et d’hiéroglyphes les constructions qu’il élevait de tous côtés. L’abbé Villain nous apprend que le petit portail de Saint-Jacques-la-Boucherie, que l’Adepte fit exécuter en 1389, était couvert de figures. « Au jambage occidental du portail, dit-il, on voit un petit ange en sculpture qui tient en ses mains un cercle de pierre ; Flamel y avait fait enclaver un rond de marbre noir avec un filet d’or fin en forme de croix… » [Abbé Villain, Histoire critique de Nicolas Flamel. Paris, Desprez, 1761.] Les pauvres devaient également à sa générosité deux maisons, qu’il fit construire à leur intention rue du Cimetière-de-Saint-Nicolas-des-Champs, la première en 1407, l’autre en 1410. Ces immeubles présentaient, assure Salomon, « quantité de figures gravées dans les pierres, avec un N et une F gothiques de chaque costés ». La chapelle de l’hôpital Saint-Gervais, reconstruite à ses frais, ne le cédait en rien aux autres fondations. « La façade et le portail de la nouvelle chapelle, écrit Albert Poisson, étaient couverts de figures et de légendes à la manière ordinaire de Flamel. » [Albert Poisson, Histoire de l’Alchimie. Nicolas Flamel. Paris, Chacornac, 1893.] Le portail de Sainte-Geneviève-des-Ardents, situé rue de la Tixeranderie, conserva son intéressant symbolisme jusqu’au milieu du XVIIIe siècle ; à cette époque, l’église fut convertie en maison et les ornements de la façade détruits. Flamel éleva encore deux arcades décoratives au charnier des Innocents, l’une en 1389, la seconde en 1407. Poisson nous apprend qu’on voyait sur la première, parmi d’autres plaques hiéroglyphiques, un écusson que l’Adepte « semble avoir imité d’un autre attribué à saint Thomas d’Aquin ». Le célèbre occultiste ajoute qu’il figure à la fin de l’Harmonie Chymique de Lagneau. Voici, d’ailleurs, la description qu’il nous en donne :
« L’écusson est partagé en quatre par une croix ; celle-ci porte au milieu une couronne d’épines renfermant en son centre un cœur saignant d’où s’élève un roseau. Dans un des quartiers, on voit IEVE en caractères hébraïques, au milieu d’une foule de rayons lumineux, au dessous d’un nuage noir ; dans le second quartier, une couronne ; dans le troisième, la terre est chargée d’une ample moisson, et le quatrième est occupé par des globes de feu. »
Cette relation, conforme à la gravure de Lagneau, nous permet de conclure que celui-ci a fait copier son image d’après l’arcade du charnier. Il n’y a là rien d’impossible, puisque, sur quatre plaques, il en restait trois du temps de Gohorry, – c’est-à-dire vers 1572, – et que l’Harmonie Chymique parut chez Claude Morel en 1601. Cependant, il eût été préférable de s’adresser à l’écusson type, assez différent de celui de Flamel et beaucoup moins obscur. Il existait encore à l’époque de la Révolution, sur une verrière éclairant la chapelle de Saint-Thomas-d’Aquin, au couvent des Jacobins. L’église des Dominicains, – qui y logeaient et s’y étaient établis vers l’an 1217, – dut sa fondation à Louis IX. Elle était située rue Saint-Jacques et placée sous le vocable de Saint-Jacques le Majeur. Les Curiositez de Paris, parues en 1716 chez Saugrain l’aîné, ajoutent qu’à côté de l’église se trouvaient les écoles du Docteur angélique.
L’écusson, dit de saint Thomas d’Aquin, fut très exactement dessiné et peint en 1787, et d’après le vitrail même, par un hermétiste nommé Chaudet. C’est ce dessin qui nous permet de le décrire (pl. XXXI).
 |
ECUSSON SYMBOLIQUE
(XIIIème siècle)
Planche XXXI |
L’écu français, écartelé, tient par son chef à un segment arrondi qui le domine. Cette pièce supplémentaire montre un matras d’or renversé, entouré d’une couronne d’épines de sinople sur champ de sable. La croix d’or porte trois globes d’azur en pointe, bras dextre et senestre, avec un cœur de gueules au rameau de sinople au centre. Sur ce cœur, des larmes d’argent tombant du matras se rassemblent et se fixent. Au canton du chef dextre, biparti d’or aux trois astres de pourpre, et d’azur aux sept rayons d’or, est opposée en pointe senestre une terre de sable aux épis d’or sur champ tanné. Au canton du chef senestre, une nuée violette sur champ d’argent, et trois flèches de même, pennées d’or, dardent vers l’abîme. En pointe dextre, trois serpents d’argent sur champ de sinople.
Ce bel emblème a d’autant plus d’importance pour nous qu’il dévoile les secrets relatifs à l’extraction du mercure et à sa conjonction avec le soufre, points obscurs de la pratique sur lesquels tous les auteurs ont préféré garder un silence religieux.
La Sainte-Chapelle, chef-d’œuvre de Pierre de Montereau, merveilleuse châsse de pierre élevée, de 1245 à 1248, pour recevoir les reliques de la Passion, présentait aussi un ensemble alchimique fort remarquable. Aujourd’hui encore, si nous regrettons vivement la réfection du portail primitif, où les Parisiens de 1830 pouvaient avec Victor Hugo admirer « deux anges, dont l’un a sa main dans un vase, et l’autre dans une nuée », nous avons, malgré tout, la joie de posséder intactes les verrières sud du splendide édifice. Il semble difficile de rencontrer ailleurs une collection plus considérable, sur les formules de l’ésotérisme alchimique, que celle de la Sainte-Chapelle. Entreprendre, feuille à feuille, la description d’une telle forêt de verre, serait une besogne énorme, capable de fournir la substance de plusieurs volumes. Nous nous bornerons donc à en offrir un spécimen extrait de la cinquième baie, premier meneau, et qui a trait au Massacre des Innocents dont nous avons donné plus haut la signification (pl. XXXII). Nous ne saurions trop recommander aux amateurs de notre vieille science, ainsi qu’aux curieux de l’occulte, l’étude des vitraux symboliques de la chapelle haute ; ils y trouveront largement à glaner, de même qu’à ceux de la grande rose, incomparable création de couleur et d’harmonie.
 |
SAINTE-CHAPELLE DE PARIS
VERRIERE SUD
Le Massacre des Innocents
Planche XXXII |
A l’instar de Paris, Amiens nous offre un remarquable ensemble de bas-reliefs hermétiques. Le fait singulier, et qu’il convient de noter, c’est que le porche central de Notre-Dame d’Amiens, – porche du Sauveur, – est la reproduction à peu près fidèle, non seulement des motifs qui ornent le portail de Paris, mais encore de la succession qu’ils y affectent. Seuls, de légers détails les différencient ; à Paris, les personnages tiennent des disques, ici ce sont des écus ; l’emblème du mercure est présenté par une femme à Amiens, tandis qu’il l’est par un homme à Paris. Sur les deux édifices, mêmes symboles, mêmes attributs, mouvements et costumes semblables. Nul doute que l’œuvre hermétique de Guillaume le Parisien n’ait exercé une influence réelle sur la décoration du grand porche d’Amiens.
Au demeurant, le chef-d’œuvre picard, magnifique entre tous, reste l’un des plus purs documents que le moyen âge nous ait légués. Sa conservation, d’ailleurs, permit aux restaurateurs de respecter la majeure partie des sujets ; aussi, l’admirable temple dû au génie de Robert de Luzarches, de Thomas et Renault de Cormont, demeure-t-il aujourd’hui dans sa splendeur originelle.
Parmi les allégories propres au style d’Amiens, nous citerons en premier lieu l’ingénieuse traduction du feu de roue. Le philosophe, assis et accoudé sur le genou droit, paraît méditer ou veiller (pl. XXXIII).
 |
CATHEDRALE D'AMIENS
PORTAIL DU SAUVEUR
Le Feu de Roue
Planche XXXIII |
Ce quatre-feuilles, fort caractéristique à notre point de vue, a cependant reçu de quelques auteurs une interprétation toute différente. Jourdain et Duval, Ruskin (The Bible of Amiens), l’abbé Roze et, après eux, Georges Durand, en ont découvert le sens dans la prophétie d’Ézéchiel, lequel, dit G. Durand, « vit quatre animaux ailés, comme plus tard saint Jean, puis des roues l’une dans l’autre. C’est la vision des roues qui est ici figurée. Prenant naïvement le texte au pied de la lettre, l’artiste a réduit la vision à sa plus simple expression. Le prophète est assis sur un rocher et semble endormi sur son genou droit. Devant lui apparaissent deux roues de voiture et c’est tout ». [G. Durand, Monographie de l’Église cathédrale d’Amiens. Paris, A. Picard, 1901.]
Cette version renferme deux erreurs. La première témoigne d’une étude incomplète de la technique traditionnelle, des formules que respectaient les latomi dans l’exécution de leurs symboles. La seconde, plus lourde, relève d’une observation défectueuse.
En effet, nos imagiers avaient coutume d’isoler, ou tout au moins de souligner leurs attributs surnaturels à l’aide d’un cordon de nuées. Nous en trouvons une preuve évidente sur la face de trois contreforts du porche ; rien de semblable ici. D’autre part, notre personnage a les yeux ouverts ; il n’est donc point endormi, mais paraît veiller, tandis que s’exerce auprès de lui la lente action du feu de roue. Davantage, il est notoire que, dans toutes les scènes gothiques figurant des apparitions, l’illuminé est toujours représenté face au phénomène ; son attitude, son expression témoignent invariablement la surprise ou l’extase, l’anxiété ou la béatitude. Ce n’est pas le cas dans le sujet qui nous occupe. Les deux roues ne sont donc et ne peuvent être qu’une image, de signification obscure pour le profane, placée tout exprès dans le dessein de voiler une chose très connue, tant de l’initié que de notre personnage. Aussi ne le voyons-nous point absorbé par quelque préoccupation de ce genre. Il veille et surveille, patient mais un peu las. Les pénibles travaux d’Hercule achevés, son labeur se réduit au ludus puerorum des textes, c’est-à-dire à l’entretien du feu, ce qu’une femme filant quenouille peut facilement entreprendre et mener à bien.
Quant à la double image de l’hiéroglyphe, nous devons l’interpréter comme le signe de deux révolutions qui doivent agir successivement sur le composé pour lui assurer un premier degré de perfection. À moins qu’on ne préfère y voir l’indication des deux natures dans la conversion, laquelle s’accomplit aussi par une cuisson douce et régulière. Cette dernière thèse est adoptée par Pernety.
En fait, la coction linéaire et continue exige la double rotation d’une même roue, mouvement impossible à traduire sur la pierre et qui a justifié la nécessité des deux roues enchevêtrées de manière à n’en former qu’une. La première roue correspond à la phase humide de l’opération, – dénommée élixation, – où le composé demeure fondu, jusqu’à formation d’une pellicule légère, laquelle, augmentant peu à peu d’épaisseur, gagne en profondeur. La seconde période, caractérisée par la sécheresse, – ou assation, – commence alors, par un second tour de roue, se parfait et s’achève lorsque le contenu de l’œuf, calciné, apparaît granuleux ou pulvérulent, en forme de cristaux, de sablon ou de cendre.
Le commentateur anonyme d’un ouvrage classique dit à propos de cette opération, qui est véritablement le sceau du Grand-Œuvre, que le « philosophe fait cuire à une chaleur douce et solaire, et dans un seul vaisseau, une seule vapeur qui s’épaissit peu à peu ». [La Lumière sortant par soy-mesme des Ténèbres. Paris, d’Houry, 1687, c. III, p. 30.] Mais quelle peut être la température du feu extérieur convenable à cette coction ? Selon les auteurs modernes, la chaleur du début ne devrait pas excéder la température du corps humain. Albert Poisson donne la base de 50° avec augmentation progressive jusque vers 300° centigrades. Philalèthe, dans ses Règles, affirme que « le degré de chaleur qui pourra tenir du plomb (327°) ou de l’étain en fusion (232°), et même encore plus forte, c’est-à-dire telle que les vaisseaux la pourront souffrir sans se rompre, doit être estimée une chaleur tempérée. Par là, dit-il, vous commencerez votre degré de chaleur propre pour le règne où la nature vous a laissé ». Dans sa quinzième règle, Philalèthe revient encore sur cette question importante ; après avoir fait remarquer que l’artiste doit opérer sur des corps minéraux et non sur des substances organiques, il parle ainsi :
« Il faut que l’eau de notre lac bouille avec les cendres de l’arbre d’Hermès ; je vous exhorte de faire bouillir nuit et jour sans cesse, afin que dans les ouvrages de notre mer tempétueuse la nature céleste puisse monter et la terrestre descendre. Car je vous assure que si nous ne faisons bouillir, nous ne pouvons jamais nommer notre ouvrage une cuisson, mais une digestion. » [Règles du Philalèthe pour se conduire dans l’Œuvre Hermétique, dans Histoire de la Philosophie Hermétique, par Lenglet-Dufresnoy. Paris, Coustelier, 1742, t. II.]
À côté du feu de roue, nous signalerons un petit sujet, sculpté à droite du même porche et que G. Durand prétend être une réplique du septième médaillon de Paris. Voici ce qu’en dit l’auteur (t. I, p. 336) :
« MM. Jourdain et Duval avaient appelé Inconstance ce vice opposé à la Persévérance ; mais il nous semble que le mot Apostasie proposé par l’abbé Roze convient mieux au sujet représenté. C’est un personnage nu-tête, imberbe et tonsuré, clerc ou moine, vêtu d’une robe descendant à mi-jambe, munie d’un capuce, et qui ne diffère de celle que nous avons vue portée par le clerc du groupe de la Colère que par la ceinture dont elle est serrée. Jetant à côté de lui ses braies et ses chaussures, sortes de demi-bottes, il semble s’éloigner d’une jolie petite église aux fenêtres longues et étroites, au clocher cylindrique et en porte à faux, que l’on aperçoit dans le lointain » (pl. XXXIV).
 |
CATHEDRALE D'AMIENS
PORTAIL DU SAUVEUR
La Coction Philosophique
Planche XXXIV |
Dans un renvoi, Durand ajoute : « Au grand portail de Notre-Dame de Paris, c’est dans l’église même que l’Apostat laisse ses vêtements ; dans le vitrail de la même église, il est dehors et fait bien le geste d’un homme qui s’enfuit. À Chartres, il s’est dépouillé entièrement et n’est plus couvert que de sa chemise. Ruskin remarque que le fou infidèle est toujours, dans les miniatures du XIIe et XIIIe siècle, représenté nu-pieds. »
Quant à nous, nous ne trouvons aucune corrélation entre le motif de Paris et celui d’Amiens. Tandis que celui-là symbolise le début de l’Œuvre, celui-ci, au contraire, en traduit l’achèvement. L’église est plutôt un athanor, et son clocher élevé en dépit des règles les plus élémentaires de l’architecture, le four secret renfermant l’œuf philosophal. Ce four est muni d’ouvertures par lesquelles l’artisan observe les phases du travail. Un détail important et bien caractéristique a été oublié : nous voulons parler du cintre évidé dans le soubassement. Or, il est difficile d’admettre qu’une église puisse être bâtie sur voûtes apparentes et semble ainsi reposer sur quatre pieds. Il n’est pas moins hasardeux d’assimiler à un vêtement la masse souple que l’artiste montre du doigt. Ces raisons nous ont conduit à penser que le motif d’Amiens relevait du symbolisme hermétique et représentait la coction ainsi que l’appareil ad hoc. L’alchimiste désigne, de la main droite, le sac au charbon, et l’abandon de ses chaussures montre assez jusqu’où doivent être poussés la prudence et le souci du silence dans cette besogne cachée. Quant à la tenue légère que revêt l’artisan dans le motif de Chartres, elle se justifie par la chaleur dégagée du four. Au quatrième degré de feu, en opérant par la voie sèche, il devient nécessaire d’entretenir une température voisine de 1200°, indispensable aussi dans la projection. Nos ouvriers modernes, dans l’industrie métallurgique, sont vêtus à la manière sommaire du souffleur chartrain. Nous serions, certes, heureux de connaître la raison pour laquelle les apostats éprouveraient le besoin de quitter leurs habits en s’éloignant du temple. C’est cette raison, précisément, qu’il eût fallu nous donner, afin de soutenir et d’étayer la thèse proposée par les auteurs cités.
Nous avons vu qu’à Notre-Dame de Paris l’athanor affecte également la forme d’une tourelle élevée sur voûtes. Il va de soi qu’on ne pouvait, ésotériquement, le reproduire tel qu’il existait au laboratoire. On se bornera donc à lui donner une forme architectonique, sans toutefois en abolir les caractéristiques, susceptibles d’en révéler la véritable destination. On y retrouve les parties constituantes du fourneau alchimique : cendrier, tour et dôme. D’ailleurs, ceux qui ont consulté les estampes anciennes, – et en particulier les bois de la Pyrotechnie que Jean Liébaut inséra dans son traité, – ne s’y tromperont point. Les fours sont figurés comme des donjons avec leurs glacis, leurs créneaux, leurs meurtrières. Certaines combinaisons de ces appareils vont jusqu’à prendre l’aspect d’édifices ou de petites forteresses d’où s’échappent des becs d’alambics ou des cols de retortes. [Cf. Jean Liébaut, Quatre Livres des Secrets de Médecine et de la Philosophie Chimique. Paris, Jacques du Puys, p. 17a et 19a.]
Contre le pied-droit du grand porche, nous retrouvons, en un quatre-feuille engagé, l’allégorie du coq et du renard, chère à Basile Valentin. Le coq se tient perché sur une branche de chêne que le renard essaie d’atteindre (pl. XXXV).
 |
CATHEDRALE D'AMIENS
PORCHE CENTRAL
Le Coq et le Renard
Planche XXXV |
Les profanes y découvrent le sujet d’une fable populaire au moyen âge, laquelle, d’après Jourdain et Duval, serait le prototype du corbeau et du renard. « On ne voit pas, ajoute G. Durand, le ou les chiens qui sont le complément de la fable. » Ce détail typique ne paraît pas avoir éveillé l’attention des auteurs sur le sens occulte du symbole. Et pourtant, nos aïeux, traducteurs exacts et méticuleux, n’eussent pas négligé de figurer ces acteurs s’il se fût agi d’une scène connue de fabliau.
Peut-être conviendrait-il en ce lieu de développer le sens de l’image en faveur des fils de science, nos frères, un peu plus que nous avons cru devoir le faire à propos du même emblème sculpté sur le porche de Paris. Nous expliquerons sans doute plus tard l’étroite relation qui existe entre le coq et le chêne, et trouverait son analogie dans le lien familial ; car le fils est uni à son père comme le coq à son arbre. Pour l’instant, nous dirons seulement que le coq et le renard ne sont qu’un même hiéroglyphe recouvrant deux états physiques distincts d’une même matière. Ce qui apparaît tout d’abord, c’est le coq ou la portion volatile, conséquemment vivante, active, pleine de mouvement, extraite du sujet, lequel a pour emblème le chêne. C’est là notre source fameuse dont l’onde claire coule à la base de l’arbre sacré, si vénéré des Druides, et que les anciens philosophes ont nommée Mercure, quoiqu’elle n’ait aucune apparence du vif-argent vulgaire. Car l’eau dont nous avons besoin est sèche, ne mouille pas les mains et jaillit du rocher sous le choc de la verge d’Aaron. Telle est la signification alchimique du coq, emblème de Mercure chez les païens et de la résurrection chez les chrétiens. Ce coq, tout volatil qu’il soit, peut devenir le Phénix. Encore doit-il, auparavant, prendre l’état de fixité provisoire que caractérise le symbole du goupil, notre renard hermétique. Il est important, avant d’entreprendre la pratique, de savoir que le mercure contient en soi tout ce qui est nécessaire au travail. « Béni soit le Très-Haut, s’écrie Geber, qui a créé ce Mercure et lui a donné une nature à laquelle rien ne résiste ! Car sans lui, les alchimistes auraient beau faire, tout leur labeur deviendrait inutile. » C’est l’unique matière dont nous avons besoin. En effet, cette eau sèche, quoique entièrement volatile, peut, si l’on découvre le moyen de la retenir longtemps au feu, devenir assez fixe pour résister au degré de chaleur qui aurait suffi à l’évaporer en totalité. Elle change alors d’emblème, et son endurance au feu, sa qualité pondéreuse lui font attribuer le renard comme enseigne de sa nouvelle nature. L’eau est devenue terre et le mercure soufre. Cette terre, cependant, malgré la belle coloration qu’elle a prise au long contact du feu, ne servirait de rien sous sa forme sèche ; un vieil axiome nous apprend que toute teinture sèche est inutile en sa siccité ; il convient donc de redissoudre cette terre ou ce sel dans la même eau qui lui a donné naissance, ou, ce qui revient au même, dans son propre sang, afin qu’elle devienne une seconde fois volatile, et que le renard reprenne la complexion, les ailes et la queue du coq. Par une seconde opération semblable à la précédente, le composé se coagulera de nouveau, il luttera encore contre la tyrannie du feu, mais cette fois dans la fusion même et non plus à cause de sa qualité sèche. Ainsi naîtra la première pierre, non absolument fixe ni absolument volatile, toutefois assez permanente au feu, très pénétrante et très fusible, propriétés qu’il vous faudra augmenter à l’aide d’une troisième réitération de la même technique. Alors le coq, attribut de saint Pierre, pierre véritable et fluente sur laquelle repose l’édifice chrétien, le coq aura chanté trois fois. Car c’est lui, le premier Apôtre, qui détient les deux clefs entrecroisées de la solution et de la coagulation ; c’est lui, symbole éternel de la pierre volatile, que le feu rend fixe et dense en la précipitant. Saint Pierre, nul ne l’ignore, fut crucifié la tête en bas…
Dans les jolis motifs du portail nord, ou de Saint-Firmin, presque entièrement occupé par le zodiaque et les scènes champêtres ou domestiques qui y correspondent, nous signalerons deux intéressants bas-reliefs. Le premier représente une citadelle dont la porte, massive et verrouillée, est flanquée de tours crénelées entre lesquelles s’élèvent deux étages de constructions ; un soupirail grillé en orne le soubassement.
Est-ce là le symbole de l’ésotérisme philosophique, social, moral et religieux qui se révèle et se développe tout au long des cent quinze autres quatre-feuilles ? Ou bien devons-nous voir, en ce motif de l’an 1225, l’idée mère de la Forteresse alchimique, reprise et modifiée par Khunrath en 1609 ? Serait-ce plutôt le Palais, mystérieux et fermé, du roi de notre Art, dont parlent Basile Valentin et Philalèthe ? Quoiqu’il en soit, citadelle ou demeure royale, le bâtiment, d’aspect imposant et rébarbatif, produit un réelle impression de force et d’impénétrabilité. Bâti pour conserver quelque trésor ou recéler quelque important secret, il semble qu’on ne puisse y pénétrer qu’en possédant la clef des puissantes serrures qui le garantissent contre toute effraction. Cela tient de la prison et de la caverne, et l’huis dégage ce quelque chose de sinistre, de redoutable qui fait songer à l’entrée du Tartare :
Vous qui entrez ici laissez toute espérance.
Le second quatre-feuilles, placé immédiatement au-dessous de celui-ci, montre des arbres morts, tordant et entrelaçant leurs branches noueuses sous un firmament dégradé, mais où l’on peut encore discerner les images du soleil, de la lune et quelques étoiles (pl. XXXVI).
 |
CATHEDRALE D'AMIENS
PORTAIL SAINT-FIRMIN
Les Matières premières
Planche XXXVI |
Ce sujet se rapporte aux matières premières du grand Art, planètes métalliques dont le feu, nous disent les Philosophes, a causé la mort, et que la fusion a rendues inertes, sans pouvoir végétatif, comme les arbres le sont pendant l’hiver.
C’est pourquoi les Maîtres nous ont tant de fois recommandé de les réincruder en leur fournissant, avec la forme fluide, l’agent propre qu’elles ont perdu dans la réduction métallurgique. Mais où trouver cet agent ? C’est là le grand mystère que nous avons fréquemment touché au cours de cette étude, en le morcelant au hasard des emblèmes, afin que, seul, l’investigateur perspicace puisse en connaître les qualités et en identifier la substance. Nous n’avons pas voulu suivre la vieille méthode par laquelle on donnait une vérité, exprimée paraboliquement, accompagnée d’une ou de plusieurs allégations spécieuses ou frelatées, pour égarer le lecteur incapable de séparer le bon grain de l’ivraie. Certes, on peut discuter et critiquer ce travail, plus ingrat qu’on ne saurait le croire ; nous ne pensons pas qu’on nous reprochera jamais d’avoir écrit un seul mensonge. Toutes les vérités, assure-t-on, ne sont pas bonnes à dire ; nous estimons, en dépit du proverbe, qu’il est possible de les faire comprendre en employant quelque finesse de langage. « Notre Art, disait jadis Artephius, est entièrement cabalistique » ; la cabale, en effet, nous a toujours été d’une grande utilité. Elle nous a permis, sans truquer la vérité, sans dénaturer l’expression, sans falsifier la Science ni nous parjurer, de dire plusieurs choses qu’on chercherait vainement dans les livres de nos prédécesseurs. Parfois, en présence de l’impossibilité où nous nous trouvions d’aller plus loin sans violer notre serment, nous avons préféré le silence aux allusions décevantes, le mutisme à l’abus de confiance.
Que pouvons-nous donc dire ici même, en face du Secret des Secrets, devant ce Verbum demissum dont nous avons déjà fait mention, et que Jésus confia à ses Apôtres, comme le témoigne saint Paul :
« J’ai été fait ministre de l’Église par la volonté de Dieu, lequel m’a envoyé vers vous pour accomplir SA PAROLE. C’est-à-dire le SECRET qui a été caché de tout temps et de tout âge, mais qu’il manifeste maintenant à ceux qu’il en juge dignes. » [Saint Paul, Epître aux Colossiens, chap. I, v. 25 et 26.]
Que pouvons-nous dire, sinon alléguer le témoignage des grands maîtres qui ont, eux aussi, cherché à l’expliquer ?
« Le Chaos métallique produit des mains de la nature contient en soy tous les métaux et n’est point métail. Il contient l’or, l’argent et le mercure ; il n’est pourtant ni or, ni argent, ni mercure. » [Le Psautier d’Hermpohile, dans Traités de la Transmutation des Métaux. Mss. anon. du XVIIIe siècle, strophe XXV.] – Ce texte est clair ; préfère-t-on le langage symbolique ? Haymon nous en donne un exemple lorsqu’il dit :
« Pour obtenir le premier agent, il faut se rendre à la partie postérieure du monde, là où l’on entend gronder le tonnerre, souffler le vent, tomber la grêle et la pluie ; c’est là qu’on trouvera la chose si on la cherche. » [Haymon, Epistola de Lapidis Philosophicis. Traité 192, t. VI du Theatrum Chimicum. Argentorati, 1613.]
Toutes les descriptions que nous ont laissées les Philosophes de leur sujet, ou matière première qui contient l’agent indispensable, sont fort confuses et très mystérieuses. En voici quelques-unes, choisies parmi les meilleures.
L’auteur du commentaire sur la Lumière sortant des Ténèbres écrit, page 108 : « L’essence en laquelle habite l’esprit que nous cherchons est entée et gravée en lui, quoy qu’avec des traits et des linéaments imparfaits ; la même chose est dite par Ripleus Anglois au commencement de ses Douze Portes ; et Ægidius de Vadis, dans son Dialogue de la Nature, fait voir clairement et comme en lettres d’or qu’il est resté, dans ce monde, une portion de ce premier Chaos, connue, mais méprisée d’un chacun, et qui se vend publiquement. » Le même auteur dit encore, page 263, que « ce sujet se trouve en plusieurs lieux et dans chacun des trois règnes ; mais si nous regardons à la possibilité de la nature, il est certain que la seule nature métallique doit être aidée de la nature et par la nature ; c’est donc dans le règne minéral seulement, où réside la semence métallique, que nous devons chercher le sujet propre à notre art ».
« Il est une pierre de grande vertu, dit à son tour Nicolas Valois, et est dite pierre et n’est pas pierre, et est minérale, végétale et animale, qui est trouvée en tous lieux et tout temps, et chez toutes personnes. » [Œuvres de N. Grosparmy et Nicolas Valois, ms. cité supra, p. 140.]
Flamel écrit de même : « Il y a une pierre occulte, absconsée et ensevelie au plus profond d’une fontaine, laquelle est vile, abjecte et nullement prisée ; et si est couverte de fiens et excrémens ; à laquelle combien qu’elle ne soit qu’une, on luy baille tous noms. Parquoy, dict le sage Morien, ceste pierre non pierre est animée, ayant vertu de procréer et engendrer. Ceste pierre est molle, prenant son commencement, origine et race de Saturne ou de Mars, Soleil et Vénus ; et si elle est Mars, Soleil et Vénus… » [Nicolas Flamel, Original du Désir désiré, ou Thrésor de Philosophie. Paris, Hulpeau, 1629, p. 144.]
« Il y a, dit Le Breton, un minéral connu des vrais Sçavans qui le cachent dans leurs écrits sous divers noms, lequel contient abondamment le fixe et le volatil. » [Le Breton, Clefs de la Philosophie Spagyrique. Paris, Jombert, 1722, p. 240.]
« Les Philosophes ont eu raison, écrit un auteur anonyme, de cacher ce mystère aux yeux de ceux qui n’estiment les choses que par les usages qu’ils leur ont donnés ; car s’ils connoissoient, ou si on leur découvroit ouvertement la Matière, que Dieu a pris plaisir de cacher dans les choses qui leur paroissent utiles, il n’en auroient plus d’estime. » [La Clef du Cabinet hermétique, ms. cité supra, p. 10.] C’est là une pensée analogue à celle de l’Imitation, par laquelle nous achèverons ces citations abstruses : « Celui qui estime les choses ce qu’elles valent, et n’en jugent pas selon le mérite ou l’estime des hommes, possède la vraie Sagesse. » [Imitation de Jésus-Christ, liv. II, ch. 1, v. 6.]
Revenons à la façade d’Amiens.
Le maître anonyme qui sculpta les médaillons du porche de la Vierge-Mère a très curieusement interprété la condensation de l’esprit universel ; un Adepte contemple le flot de la rosée céleste tombant sur une masse que nombre d’auteurs ont prise pour une toison. Sans infirmer cette opinion, il est tout aussi vraisemblable d’y soupçonner un corps différent, tel que le minéral désigné sous le nom de Magnésie ou d’Aimant philosophique. On remarquera que cette eau ne tombe pas ailleurs que sur le sujet considéré, ce qui confirme l’expression d’une vertu attractive cachée dans ce corps, et qu’il ne serait pas sans importance de chercher à établir (pl. XXXVII).
 |
CATHEDRALE D'AMIENS
PORTAIL DE LA VIERGE-MERE
La Rosée des Philosophes
Planche XXXVII |
C’est ici, croyons-nous, le lieu de rectifier certaines erreurs commises à propos d’un végétal symbolique, lequel, pris à la lettre par d’ignorants souffleurs, contribua fortement à jeter le discrédit sur l’alchimie et le ridicule sur ses partisans. Nous voulons parler du Nostoc. Ce cryptogame, que connaissent tous les paysans, se rencontre partout à la campagne, tantôt sur l’herbe, tantôt sur le sol nu, dans les champs, au bord des chemins, à la lisière des bois. De bon matin, au printemps, on en trouve de volumineux, gonflés de rosée nocturne. Gélatineux et tremblotants, – d’où leur nom de trémelles, – ils sont le plus souvent verdâtres et se dessèchent si rapidement sous l’action des rayons solaires, qu’ils devient impossible d’en retrouver trace à l’endroit même où ils s’étalaient quelques heures auparavant. Tous ces caractères combinés, – apparition soudaine, absorption d’eau et gonflement, coloration verte, consistance molle et gluante, – ont permis aux Philosophes de prendre cette algue comme type hiéroglyphique de leur matière. Or, c’est très certainement un amas de ce genre, symbole de la Magnésie minérale des Sages, que l’on voit, dans le quatre-feuilles d’Amiens, absorber la rosée céleste. Nous passerons vite sur les noms multiples appliqués au nostoc et qui, dans l’esprit des Maîtres, ne désignaient que leur principe minéral : Archée céleste, Crachat de Lune, Beurre de terre, Graisse de rosée, Vitriol végétal, Flos Cœli, etc., selon qu’ils le regardaient comme réceptacle de l’Esprit universel, ou comme matière terrestre exhalée du centre à l’état de vapeur, puis coagulée par refroidissement au contact de l’air.
Ces termes étranges, qui ont cependant leur raison d’être, ont fait oublier la signification réelle et initiatique du Nostoc. Ce mot vient du grec νύξ, νυκτός correspondant au latin nox, noctis, nuit. C’est donc une chose qui naît la nuit, a besoin de la nuit pour se développer et ne se peut travailler que la nuit. Aussi, notre sujet est-il admirablement dérobé aux regards profanes, quoiqu’il puisse être facilement distingué et ouvré par ceux qui ont une exacte connaissance des lois naturelles. Mais combien peu, hélas ! prennent la peine de réfléchir et demeurent simples dans leur raisonnement !
Voyons, dites-nous, vous qui avez déjà tant labouré, que prétendez-vous faire auprès de vos fourneaux allumés, de vos ustensiles nombreux, variés, inutiles ? Espérez-vous accomplir de toutes pièces une véritable création ? – Non, certes, puisque la faculté de créer n’appartient qu’à Dieu, l’unique Créateur. C’est donc une génération que vous désirez provoquer au sein de vos matériaux. Mais il vous faut, dans ce cas, l’aide de la nature, et vous pouvez croire que cette aide vous sera refusée, si par malheur ou par ignorance, vous ne mettez pas la nature en état d’appliquer ses lois. Quelle est donc la condition primordiale, essentielle, pour qu’une génération quelconque puisse être manifestée ? Nous répondrons pour vous : l’absence totale de toute lumière solaire, même diffuse ou tamisée. Regardez autour de vous, interrogez votre propre nature. Ne voyez-vous pas que, chez l’homme et les animaux, la fécondation et la génération s’opèrent, grâce à certaine disposition des organes, dans une obscurité complète, maintenue jusqu’au jour de la naissance ? – Est-ce à la surface du sol, – en pleine lumière, – ou dans la terre même, – à l’obscurité, – que les graines végétales peuvent germer et se reproduire ? Est-ce le jour ou la nuit que tombe la rosée fécondante qui les alimente et les vitalise ? Voyez les champignons ; n’est-ce pas la nuit qu’ils naissent, croissent et se développent ? Et vous-même, n’est-ce point aussi la nuit, dans le sommeil nocturne, que votre organisme répare ses pertes, élimine ses déchets, reforme de nouvelles cellules, de nouveaux tissus aux lieu et place de ceux que la lumière du jour a brûlés, usés et détruits ? Il n’est pas jusqu’au travail de la digestion, de l’assimilation, de la transformation des aliments en sang et substance organique qui ne s’accomplisse dans l’obscurité. Voulez-vous tenter une expérience ? – Prenez des œufs fécondés, faites-les couver dans une pièce bien éclairée ; à la fin de l’incubation tous vos œufs contiendront des embryons morts, plus ou moins décomposés. Si quelque poussin vient à naître, il sera aveugle, chétif et ne vivra point. Telle est l’influence néfaste du soleil, non pas sur la vitalité des individus constitués, mais sur la génération. Et ne croyez pas qu’il faille limiter aux seuls règnes organiques les effets d’une loi fondamentale dans la nature créée. Les minéraux même, malgré leur réaction moins visible, y sont soumis comme les animaux et les végétaux. On sait assez que la production de l’image photographique est basée sur la propriété que possèdent les sels d’argent de se décomposer à la lumière. Ces sels reprennent donc leur état métallique inerte, tandis qu’ils avaient acquis, au laboratoire noir, une qualité active, vivante et sensible. Deux gaz mélangés, le chlore et l’hydrogène, conservent leur intégrité tant qu’ils sont tenus dans l’obscurité ; ils se combinent lentement à la lumière diffuse et avec explosion brutale si le soleil intervient. Un grand nombre de sels métalliques en solution se transforment ou se précipitent en plus ou moins de temps à la lumière du jour. Le sulfate ferreux se change ainsi rapidement en sulfate ferrique, etc.
Il importe donc de retenir que le soleil est le destructeur par excellence de toutes les substances trop jeunes, trop faibles pour résister à son pouvoir igné. Et cela est si réel qu’on a basé sur cette action spéciale une méthode thérapeutique pour la guérison d’affections externes, la cicatrisation rapide de plaies et blessures. C’est le pouvoir mortel de l’astre sur les cellules microbiennes d’abord, et les cellules organiques ensuite, qui a permis d’instituer le traitement photothérapique.
Et maintenant, travaillez de jour si bon vous semble ; mais ne nous accusez pas si vos efforts n’aboutissent jamais qu’à l’insuccès. Nous savons, quant à nous, que la déesse Isis est la mère de toutes choses, qu’elle les porte toutes dans son sein, et qu’elle seule est la dispensatrice de la Révélation et de l’Initiation. Profanes qui avez des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, à qui adresserez-vous donc vos prières ? Ignorez-vous qu’on ne parvient à Jésus que par l’intercession de sa Mère : sancta Maria ora pro nobis ? Et la Vierge est figurée, pour votre instruction, les pieds posés sur le croissant lunaire, toujours vêtue de bleu, couleur symbolique de l’astre des nuits. Nous pourrions dire beaucoup plus, mais nous estimons avoir assez parlé.
Finissons donc l’étude des types hermétiques originaux de la cathédrale d’Amiens, en relevant, à gauche du même porche de la Vierge-Mère, un petit motif d’angle offrant une scène d’initiation. Le maître désigne à trois disciples l’astre hermétique sur lequel nous nous sommes déjà longuement étendu, l’étoile traditionnelle qui sert de guide aux Philosophes et leur indique la naissance du fils du soleil (pl. XXXVIII).
 |
CATHEDRALE D'AMIENS
PORTAIL DE LA VIERGE-MERE
L'Astre aux Sept Rayons
Planche XXXVIII |
Rappelons ici, à propos de cet astre, la devise de Nicolas Rollin, chancelier de Philippe le Bon, qui fut peinte en 1477 sur le carrelage de l’hôpital de Beaune, dont il était le fondateur. Cette devise, présentée à la manière d’un rébus, – Seule ✮, – manifestait la science de son possesseur par le signe caractéristique de l’Œuvre, l’unique, la seule étoile.
Bourges, vieille cité berrichonne, silencieuse, recueillie, calme et grise comme un cloître monastique, déjà fière à juste titre d’une admirable cathédrale, offre encore aux amateurs du passé d’autres édifices également remarquables. Parmi ceux-ci, le palais Jacques-Cœur et l’hôtel Lallemant sont les plus purs joyaux de sa merveilleuse couronne.
Du premier, qui fut jadis un véritable musée d’emblèmes hermétiques, nous dirons peu de choses. Le vandalisme a passé sur lui. Ses affectations successives en ont ruiné la décoration intérieure, et, si la façade ne nous était conservée dans son état primitif, il nous serait impossible d’imaginer aujourd’hui, devant les parois nues, les salles délabrées, les hautes galeries voûtées en carène, la magnificence originelle de cette somptueuse demeure.
Jacques Cœur, grand argentier de Charles VII, qui la fit construire au XVe siècle, eut la réputation d’un Adepte éprouvé. David de Planis-Campy le cite, en effet, comme possédant « le don précieux de la pierre au blanc », en d’autres termes de la transmutation des métaux vils en argent. D’où, peut-être, son titre d’argentier. Quoiqu’il en soit, nous devons reconnaître que Jacques Cœur mit tout en œuvre pour accréditer, par une profusion de symboles choisis, sa qualité vraie ou supposée de philosophe par le feu.
Chacun connaît le blason et la devise de ce haut personnage : trois cœurs formant le centre de cette légende, présentée comme un rébus, A vaillans cuers riens impossible. Fière maxime, débordante d’énergie, qui prend, si nous l’étudions selon les règles cabalistiques, une signification assez singulière. En effet, lisons cuer avec l’orthographe de l’époque, et nous obtiendrons à la fois : 1° l’énoncé de l’Esprit universel (rayon de lumière) ; 2° le nom vulgaire de la matière basique ouvrée (le fer) ; 3° les trois réitérations indispensables à la perfection totale des deux Magistères (les trois cuers). Notre conviction est donc que Jacques Cœur a pratiqué lui-même l’alchimie, ou du moins qu’il a vu élaborer sous ses yeux la pierre au blanc par le fer « essencifié » et trois fois cuit.
Parmi les hiéroglyphes favoris de notre argentier, la coquille Saint-Jacques tient, avec le cœur, une place prépondérante. Les deux images en sont toujours accouplées ou disposées symétriquement, ainsi qu’on peut le voir sur les motifs centraux des cercles quadrilobés du fenestrage, des balustrades, des panneaux et du marteau de porte, etc. Sans doute y a-t-il, dans cette dualité de la coquille et du cœur, un rébus imposé sur le nom du propriétaire, ou sa signature stéganographique. Cependant, les coquilles du genre peigne (Pecten Jacobæus des naturalistes) ont toujours servi d’insigne aux pèlerins de Saint-Jacques. On les portait soit au chapeau (ainsi qu’on le remarque sur une statue de saint James à l’abbaye de Westminster), soit autour du col, soit enfin agrafées sur la poitrine, toujours de façon très apparente. La Mérelle de Compostelle (pl. XXXIX), sur laquelle nous aurions bien des choses à remarquer, sert, dans la symbolique secrète, à désigner le principe Mercure, appelé encore Voyageur ou Pèlerin. [Le Mercure est l’eau benoite des Philosophes. Les grandes coquilles servaient autrefois à contenir l’eau bénite ; on les rencontre encore fréquemment dans beaucoup d’églises rurales.] Elle est portée mystiquement par tous ceux qui entreprennent le travail et cherchent à obtenir l’étoile (compos stella).
 |
HOTEL JACQUES-COEUR A BOURGES
FACADE
La Mérelle de Compostelle
Planche XXXIX |
Rien de surprenant, dès lors, que Jacques Cœur ait fait reproduire, à l’entrée de son palais,
l’icon peregrini si populaire chez les souffleurs du moyen âge. Nicolas Flamel ne décrit-il pas de même, dans ses Figures Hiéroglyphiques, le voyage parabolique qu’il entreprit afin, dit-il, de demander à « Monsieur Jacques de Galice » aide, lumière et protection ? Tous les alchimistes à leur début en sont là. Il leur faut accomplir, avec le bourdon pour guide et la mérelle pour enseigne, ce long et dangereux périple dont une moitié est terrestre et l’autre maritime. Pèlerins d’abord, pilotes ensuite.
La chapelle, restaurée, entièrement peinte, est peu intéressante. Si nous exceptons le plafond, sur croisée d’ogives, où une vingtaine d’anges trop neufs portent au front le globe et déroulent des phylactères, et une Annonciation sculptée sur le tympan de la porte, il ne reste rien du symbolisme d’antan. Venons donc à la pièce la plus curieuse et la plus originale du Palais.
C’est un joli groupe, sculpté sur un cul-de-lampe, qui orne la chambre dite du Trésor. On assure qu’il représente la rencontre de Tristan et d’Yseult. Nous n’y contredirons pas, le sujet ne changeant rien, d’ailleurs, à l’expression symbolique qu’il dégage. Le beau poème médiéval fait partie du cycle des romans de la Table Ronde, légendes hermétiques traditionnelles renouvelées des fables grecques. Il se rapporte directement à la transmission des connaissances scientifiques anciennes, sous le voile d’ingénieuses fictions popularisées par le génie de nos trouvères picards (pl. XL).
 |
HOTEL JACQUES-COEUR A BOURGES
CHAMBRE DU TRESOR
Groupe de Tristan et Yseult
Planche XL |
Au centre du motif, un coffret creux et cubique fait saillie au pied d’un arbre touffu dont le feuillage dissimule la tête couronnée du roi Marc. De chaque côté apparaissent Tristan de Léonois et Yseult, celui-là coiffé du chaperon à bourrelet, celle-ci d’une couronne qu’elle assujettit de la main droite. Nos personnages sont figurés dans la forêt de Morois, sur un tapis de hautes herbes et de fleurs, et fixent tous deux leurs regards sur la mystérieuse pierre évidée qui les sépare.
Le mythe de Tristan de Léonois est une réplique de celui de Thésée. Tristan combat et tue le Morhout, Thésée le Minotaure. Nous retrouvons ici l’hiéroglyphe de fabrication du Lion vert, – d’où le nom de Léonois ou Léonnais porté par Tristan, – laquelle est enseignée par Basile Valentin sous la lutte des deux champions, l’aigle et le dragon. Ce combat singulier des corps chimiques dont la combinaison procure le dissolvant secret (et le vase du composé), a fourni le sujet de quantité de fables profanes et d’allégories sacrées. C’est Cadmos perçant le serpent contre un chêne ; Apollon tuant à coups de flèches le monstre Python et Jason le dragon de Colchide ; c’est Horus combattant le Typhon du mythe osirien ; Hercule coupant les têtes de l’Hydre et Persée celle de la Gorgone ; saint Michel, saint Georges, saint Marcel terrassant le Dragon, répliques chrétiennes de Persée, tuant le monstre gardien d’Andromède, monté sur son cheval Pégase ; c’est encore le combat du renard et du coq, dont nous avons parlé en décrivant les médaillons de Paris ; celui de l’alchimiste et du dragon (Cyliani), de la rémore et de la salamandre (Cyrano de Bergerac), du serpent rouge et du serpent vert, etc.
Ce dissolvant peu commun permet la réincrudation de l’or naturel, son amollissement et le retour à son premier état sous la forme saline, friable et très fusible. [Terme technique hermétique qui signifie rendre cru, c’est-à-dire remettre dans un état antérieur à celui qui caractérise la maturité, rétrograder.] C’est là le rajeunissement du roi, que signalent tous les auteurs, début d’une phase évolutive nouvelle, personnifiée, dans le motif qui nous occupe, par Tristan, neveu du roi Marc. En fait, l’oncle et le neveu ne sont, chimiquement parlant, qu’une même chose, de même genre et d’origine semblable. L’or perd sa couronne, – en perdant sa couleur, – durant un certain laps de temps, et s’en voit dépourvu jusqu’à ce qu’il soit parvenu au degré de supériorité où l’art et la nature peuvent le porter. Il en hérite alors d’une seconde, « infiniment plus noble que la première », ainsi que nous l’assure Limojon de Saint-Didier. Aussi, voyons-nous se détacher nettement les silhouettes de Tristan et de la reine Yseult, tandis que le vieux roi demeure caché dans les frondaisons de l’arbre central, lequel sort de la pierre comme l’arbre de Jessé sort de la poitrine du Patriarche. Remarquons encore que la reine est à la fois l’épouse du vieillard et du jeune héros, afin de maintenir la tradition hermétique qui fait du roi, de la reine et de l’amant la triade minérale du Grand-Œuvre. Enfin, signalons un détail de quelque valeur pour l’analyse du symbole. L’arbre situé derrière Tristan est chargé de fruits énormes, – poires ou figues géantes, – en telle abondance que le feuillage disparaît sous leur masse. Étrange forêt, en vérité, que celle de Mort-Roi, et combien nous serions porté à l’assimiler au fabuleux et mirifique Jardin des Hespérides !
Plus encore que le Palais Jacques-Cœur, l’Hôtel Lallemant retiendra notre attention. Demeure bourgeoise, de dimensions modestes et de style moins ancien, il offre le rare avantage de se présenter à nous dans un état de parfaite conservation. Aucune restauration, aucune mutilation ne lui ont ôté le beau caractère symbolique que dégage une décoration abondante aux thèmes délicats et minutieux.
Le corps de logis, bâti à flanc de talus, montre le pied de sa façade en contre-bas d’un étage environ par rapport au niveau de la cour. Cette disposition nécessite l’emploi d’un escalier construit sous voûte ascendante en plein cintre. Système ingénieux autant qu’original, qui permet l’accès de la cour intérieure, où s’ouvre l’entrée des appartements.
Sur le palier voûté, au seuil de l’escalier, le gardien, – dont nous devons louer l’exquise affabilité, – pousse à notre droite une petite porte. « C’est ici, nous dit-il, qu’est la cuisine. » – Pièce assez vaste, creusée en sous-sol, mais basse de plafond, qu’une seule fenêtre, ouverte en largeur et coupée d’un meneau de pierre, éclaire à peine. Cheminée minuscule et sans profondeur : telle est la « cuisine ». A l’appui de son affirmation, notre cicerone désigne un cul-de-lampe de retombée d’arcs, lequel figure un clerc qui étreint le manche d’un pilon. Est-ce vraiment là l’image d’un gâte-sauce du XVIe siècle ? Nous demeurons sceptique. Notre regard va de la petite cheminée, – où l’on pourrait à peine rôtir un dindon, mais qui suffirait à contenir la tour d’un athanor, – au marmouset promu cuisinier, puis se reporte à la cuisine elle-même, si triste, si sombre en ce lumineux jour d’été…
Plus nous réfléchissons et moins l’explication du guide nous semble vraisemblable. Cette salle basse, obscure, éloignée de la salle à manger par un escalier et une cour à ciel ouvert, sans autre appareil qu’une cheminée étroite, insuffisante, dépourvue de contre-cœur en fonte et d’attache de crémaillère, ne saurait logiquement convenir au moindre office culinaire. En revanche, elle nous paraît admirablement adaptée au travail alchimique, d’où la lumière solaire, ennemie de toute génération, doit être exclue. Quant au marmiton, nous connaissons assez la conscience, le soin, le scrupule d’exactitude qu’apportaient les imaigiers d’autrefois dans la traduction de leur pensée pour qualifier pilon l’instrument qu’il présente au visiteur. Nous ne pouvons croire que l’artiste eût négligé de figurer également le mortier, sa contre-partie indispensable. D’ailleurs, la forme de l’ustensile est caractéristique ; ce que tient le marmouset en question est en réalité un matras à long col, semblable à ceux qu’emploient nos chimistes, et qu’il nomment encore ballons, à cause de leur panse sphérique. Enfin, l’extrémité du manche de ce pilon supposé est évidée et taillée en sifflet, ce qui prouve bien que nous avons affaire à un ustensile creux, vase ou fiole (pl. XLI).
 |
HOTEL LALLEMANT A BOURGES
CUL-DE-LAMPE
Le Vaisseau du Grand Oeuvre
Planche XLI |
Ce vaisseau indispensable et fort secret a reçu des noms divers, choisis de manière à écarter les profanes, non seulement de sa véritable destination, mais encore de sa composition. Les Initiés nous comprendront et sauront de quel vaisseau nous entendons parler. Généralement, il est appelé œuf philosophique et Lion vert. Par le terme d’œuf, les Sages entendent leur composé, disposé dans son vase propre, et prêt à subir les transformations que l’action du feu y provoquera. C’est, dans ce sens, positivement un œuf, puisque son enveloppe, ou sa coque, renferme le rebis philosophal, formé de blanc et de rouge dans une proportion analogue à celle de l’œuf des oiseaux. Quant à la second épithète, son interprétation n’a jamais été indiquée dans les textes. Batsdorff, dans son Filet d’Ariadne, dit que les Philosophes ont appelé Lion vert le vaisseau servant à la coction, mais sans en fournir aucune raison. Le Cosmopolite, insistant davantage sur la qualité du vase et sa nécessité dans le travail, affirme qu’en l’Œuvre « il y a ce seul Lion verd qui ferme et ouvre les sept sceaux indissolubles des sept esprits métalliques, et qui tourmente les corps jusqu’à ce qu’il les ait entièrement perfectionnés, par le moyen d’une longue et ferme patience de l’artiste ». Le manuscrit de G. Aurach montre un matras de verre, rempli à moitié d’une liqueur verte, et ajoute que tout l’art repose sur l’acquisition de ce seul Lion verd et que son nom même indique sa couleur. [Le Très précieux Don de Dieu. Manuscrit de Georges Aurach, de Strasbourg, escript et peint de sa propre main, l’an du Salut de l’Humanité rachetée, 1415.] C’est le vitriol de Basile Valentin. La troisième figure de la Toison d’Or est presque identique à l’image de G. Aurach. On y voit un philosophe habillé de rouge, sous un manteau pourpre, et coiffé d’un bonnet vert, qui montre de la dextre un matras de verre contenant un liquide vert. Ripley s’approche plus de la vérité lorsqu’il dit : « Il n’entre qu’un seul corps immonde dans notre magistère ; les Philosophes l’appellent communément Lion vert. C’est le milieu ou moyen pour joindre les teintures entre le soleil et la lune. »
D’après ces renseignements, il appert que le vase est doublement envisagé, et dans sa matière et dans sa forme, d’une part à l’état de vase de nature, de l’autre comme vase de l’art. Les descriptions, – peu nombreuses et peu limpides, – que nous venons de traduire, se rapportent à la nature du vase; quantité de textes nous éclairent sur la forme de l’œuf. Celui-ci peut, à volonté, être sphérique ou ovoïde, pourvu qu’il soit en verre clair, transparent, sans soufflure. Ses parois exigent une certaine épaisseur, afin de résister aux pressions internes, et quelques auteurs recommandent de choisir à cet effet le verre de Lorraine. [Le vocable verre de Lorraine servait autrefois à distinguer le verre moulé du verre soufflé. Grâce au moulage, le verre de Lorraine pouvait avoir des parois très épaisses et régulières.] Enfin, le col en est long ou court, selon l’intention de l’artiste ou sa commodité ; l’essentiel est qu’on puisse facilement le souder à la lampe d’émailleur. Mais ces détails de pratiques sont suffisamment connus pour nous dispenser de plus amples explications.
Quant à nous, nous voulons surtout retenir que le laboratoire et le vase de l’Œuvre, le lieu où besogne l’Adepte et celui où la nature agit, sont les deux certitudes qui frappent l’initié au début de sa visite et font de l’Hôtel Lallemant l’une des plus séduisantes et des plus rares demeures philosophales.
Précédé du guide, nous voici maintenant sur le pavé de la cour. Quelques pas nous amènent à l’entrée d’une loggia largement éclairée par un portique formé de trois baies cintrées. C’est une grande salle, au plafond rayé d’épaisses solives. Des monolithes, stèles et autres débris antiques y trouvent place et lui donnent l’aspect d’un musée d’archéologie locale. Pour nous, l’intérêt n’est pas là, mais bien sur la muraille du fond, où se trouve enclavé un magnifique bas-relief de pierre peinte. Il représente saint Christophe déposant le petit Jésus sur la berge rocheuse du torrent légendaire qu’il vient de lui faire traverser. Au second plan, un ermite, la lanterne au point, – car la scène se passe la nuit, – sort de sa cabane et marche vers l’Enfant-Roi (pl. XLII).
 |
HOTEL LALLEMANT A BOURGES
La Légende de saint Christophe
Planche XLII |
Il nous a souvent été donné de rencontrer de belles représentations anciennes de saint Christophe; aucune, cependant, n’a serré d’aussi près la légende que celle-ci. Il semble donc hors de doute que le sujet de ce chef-d’œuvre et le texte de Jacques de Voragine contiennent le même sens hermétique, avec, en plus, certain détail qu’on ne saurait trouver ailleurs. Saint Christophe prend, de ce fait, une importance capitale sous le rapport de l’analogie existant entre ce géant, qui porte le Christ, et la matière qui porte l’or (Χρυσοφορος) en jouant le même rôle dans l’Œuvre. Comme notre intention est d’être utile à l’étudiant sincère et de bonne foi, nous en développerons bientôt l’ésotérisme, que nous avons réservé en parlant des statues de saint Christophe et du monolithe dressé sur le Parvis Notre-Dame, à Paris. Mais, désirant nous faire mieux comprendre, nous transcrirons d’abord le récit légendaire rapporté par Amédée de Ponthieu d’après Jacques de Voragine. Nous soulignons à dessein les passages et les noms qui se rapportent directement au travail, aux conditions et aux matériaux, afin qu’on puisse s’y arrêter, y réfléchir et en tirer profit.
« Avant d’être chrétien, Christophe se nommait Offerus ; c’était une espèce de géant, esprit très épais. Quand il eut l’âge de raison, il se mit à voyager en disant qu’il voulait servir le plus grand roi de la terre. On l’envoya à la cour d’un roi puissant qui fut bien réjoui d’avoir un serviteur aussi fort. Un jour, le roi, entendant un chanteur prononcer le nom du diable, fit le signe de la croix avec terreur. « Pourquoi cela ? demanda aussitôt Christophe. – Parce que je crains le diable, répondit le roi. – Si tu le crains, tu n’es donc pas si puissant que lui ? Alors je veux servir le diable. » Et là-dessus Offerus partit.
« Après une longue marche à la recherche de ce puissant monarque, il vit venir à lui une grande troupe de cavaliers vêtus de rouge ; leur chef était noir et lui dit : « Que cherches-tu ? – Je cherche le diable pour le servir. – Je suis le diable, suis-moi. » Et voila Offerus enrôlé parmi les domestiques de Satan. Un jour, dans une grande course, la troupe infernale rencontre une croix au bord du chemin ; le diable ordonne de faire volte-face. « Pourquoi cela ? dit Offerus, toujours curieux de s’instruire. – Parce que je crains l’image du Christ. – Si tu crains l’image du Christ, c’est que tu es moins puissant que lui ; alors je veux entrer au service du Christ. » Offerus passa seul devant la croix et continua sa route. Il rencontra un bon ermite et lui demanda où l’on pourrait voir le Christ. « Partout, répondit l’ermite. – Je ne comprends pas, dit Offerus ; mais si vous dites la vérité, quels services peut lui rendre un gaillard robuste et alerte comme moi ? – On le sert, répondit l’ermite, par la prière, les jeûnes et les veilles. » Offerus fit la grimace. « N’y a-t-il pas une autre manière de lui être agréable ? demanda-t-il. » Le solitaire comprit à qui il avait affaire, et, le prenant par la main, le conduisit au bord d’un torrent fougueux, qui descendait d’une haute montagne, et lui dit : « Les pauvres gens qui ont traversé cette eau se sont noyés ; reste ici, et porte à l’autre bord, sur tes fortes épaules, ceux qui te le demanderont. Si tu fais cela pour l’amour du Christ, il te reconnaîtra pour son serviteur. – Je le ferai bien pour l’amour du Christ, répondit Offerus. » Il se bâtit donc une cabane sur le rivage et transporta nuit et jour les voyageurs qui le demandaient.
« Une nuit, accablé par la fatigue, il dormait profondément ; des coups frappés à sa porte l’éveillèrent, et il entendit la voix d’un enfant qui l’appela trois fois par son nom ! Il se leva, prit l’enfant sur ses larges épaules et entra dans le torrent. Arrivé au milieu, il voit tout à coup le torrent devenir furieux, les vagues s’enfler et se précipiter sur ses jambes nerveuses pour le renverser. Il résiste de son mieux, mais l’enfant pesait comme un lourd fardeau ; c’est alors que, dans la crainte de laisser choir le petit voyageur, il déracina un arbre pour s’y appuyer ; mais les flots grossissaient toujours, et l’enfant devenait de plus en plus pesant. Offerus, craignant de le noyer, leva la tête vers lui et lui dit : « Enfant, pourquoi te fais-tu si lourd ? Il me semble que je porte le monde. » L’enfant répondit : « Non seulement tu portes le monde, mais celui qui a fait le monde. Je suis le Christ, ton Dieu et ton maître. En récompense de tes bons services, je te baptise au nom de mon Père, en mon nom propre et en celui du Saint-Esprit ; désormais, tu t’appelleras Christophe. » Depuis ce jour, Christophe parcourut la terre pour enseigner la parole du Christ. » [Amédée de Ponthieu, Légendes du Vieux Paris. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867, p. 106.]
Cette narration suffit à montrer avec quelle fidélité l’artiste a observé et rendu les moindres détails de la légende. Mais il a fait mieux encore. Sous l’inspiration du savant hermétiste qui lui avait commandé l’œuvre, il a placé le géant, les pieds dans l’eau, le vêtant d’une étoffe légère nouée sur l’épaule et serrée par une large ceinture au niveau de l’abdomen. C’est cette ceinture qui donne à saint Christophe son véritable caractère ésotérique. [D’après certains documents conservés dans les archives de l’Hôtel Lallemant, nous savons que Jean Lallemant appartenait à la Fraternité alchimique des Chevaliers de la Table ronde.] Ce que nous allons en dire ici ne s’enseigne pas. Mais, outre que, pour beaucoup, la science ainsi révélée n’en demeure pas moins ténébreuse, nous estimons d’autre part, qu’un livre qui n’apprend rien est inutile et vain. Pour cette raison, nous allons nous efforcer de dépouiller le symbole autant qu’il nous sera possible, afin de montrer aux investigateurs de l’occulte le fait scientifique caché sous son image.
La ceinture d’Offerus est piquée de lignes entre-croisées semblables à celles que présente la surface du dissolvant lorsqu’il a été canoniquement préparé. Tel est le Signe, que tous les Philosophes reconnaissent pour marquer, extérieurement, la vertu, la perfection, l’extrême pureté intrinsèque de leur substance mercurielle. Nous avons déjà dit plusieurs fois, et nous le répétons encore, que tout le travail de l’art consiste à évertuer ce mercure jusqu’à ce qu’il soit revêtu du signe indiqué. Et ce signe, les vieux auteurs l’ont appelé Sceau d’Hermes, Sel des Sages (Sel mis pour Scel), – ce qui jette la confusion dans l’esprit des chercheurs, – la marque et l’empreinte du Tout-Puissant, sa signature, puis encore Étoile des Mages, Étoile polaire, etc. Cette disposition géométrique subsiste et apparaît avec plus de netteté lorsqu’on a mis l’or à dissoudre dans le mercure pour le ramener à son premier état, celui d’or jeune ou rajeuni, en un mot d’or enfant. C’est la raison pour laquelle le mercure, – loyal serviteur et Scel de la terre, – est nommé Fontaine de Jouvence. Les Philosophes parlent donc clairement lorsqu’ils enseignent que le mercure, dès la dissolution effectuée, porte l’enfant, le Fils du Soleil, le Petit Roi (Roitelet), comme une mère véritable, puisque en effet l’or renaît dans son sein. « Le vent, – qui est le mercure ailé et volatil, – l’a porté dans son ventre », nous dit Hermès dans sa Table d’Émeraude. Or, nous retrouvons la version secrète de cette vérité positive dans le Gâteau des Rois, qu’il est d’usage de partager en famille le jour de l’Épiphanie, fête célèbre qui rappelle la manifestation de Jésus-Christ enfant aux Rois Mages et aux Gentils. La Tradition veut que les Mages aient été guidés jusqu’au berceau du Sauveur par une étoile, laquelle fut, pour eux, le signe annonciateur, la Bonne Nouvelle de sa naissance. Notre galette est signée comme la matière elle-même et contient dans sa pâte le petit enfant populairement dénommé baigneur. C’est l’Enfant-Jésus porté par Offerus, le serviteur ou le voyageur ; c’est l’or dans son bain, le baigneur ; c’est la fève, le sabot, le berceau ou la croix d’honneur, et c’est aussi le poisson « qui nage dans notre mer philosophique », selon l’expression même du Cosmopolite. [Cosmopolite ou Nouvelle Lumière Chymique. Traité du Sel, p. 76. Paris, J. d’Houry, 1669.] Notons que, dans les basiliques byzantines, le Christ était parfois représenté comme les Sirènes, avec une queue de poisson. On le voit ainsi figuré sur un chapiteau de l’église Saint-Brice, à Saint-Brisson-sur-Loire (Loiret). Le poisson est l’hiéroglyphe de la pierre des Philosophes dans son premier état, parce que la pierre, comme le poisson, naît dans l’eau et vit dans l’eau. Parmi les peintures du poêle alchimique exécuté en 1702 par P.-H. Pfau, on voit un pêcheur à la ligne sortant de l’eau et un beau poisson. [Conservé au musée de Winterthur (Suisse).] D’autres allégories recommandent de le saisir à l’aide d’un filet ou d’un rets délié, ce qui est une image exacte des mailles, formées de fils entre-croisés, schématisées sur nos galettes de l’Épiphanie. [L’expression populaire avoir de la galette équivaut à être fortuné. Celui qui est assez heureux pour trouver la fève au gâteau n’a plus besoin de rien ; jamais l’argent ne lui fera défaut. Il sera doublement roi, par la science et la fortune.] Signalons cependant une autre forme emblématique plus rare, mais non moins lumineuse. Dans une famille amie où nous fûmes invité à partager le gâteau, nous vîmes sur la croûte, non sans quelque surprise, un chêne développer ses branches, au lieu des marques en losange qui y figurent d’ordinaire. Au baigneur, on avait substitué un poisson en porcelaine, et ce poisson était une sole (lat. sol, solis, le soleil). Nous donnerons bientôt la signification hermétique du chêne en parlant de la Toison d’Or. Ajoutons encore que le fameux poisson du Cosmopolite, qu’il appelle Échinéis, est l’oursin (echinus), l’ourson, la petite ourse, constellation dans laquelle se trouve l’étoile polaire. Les tests d’oursins fossiles, que l’on rencontre en abondance dans tous les terrains, présentent une face rayonnée en forme d’étoile. C’est pourquoi Limojon de Saint-Didier recommande aux investigateurs de régler leur route « par la vue de l’étoile du nord ».
Ce poisson mystérieux est le poisson royal par excellence ; celui qui le découvre dans sa part de galette est paré du titre de roi et fêté comme tel. Or, on donnait autrefois le nom de poisson royal au dauphin, à l’esturgeon, au saumon et à la truite, parce que ces espèces étaient réservées, disait-on, pour la table royale. En fait, cette dénomination avait seulement un caractère symbolique, puisque le fils aîné des rois, celui qui devait ceindre la couronne, portait toujours le titre de Dauphin, nom d’un poisson, et, qui mieux est, d’un poisson royal. C’est, d’ailleurs, un dauphin que les pêcheurs en barque du Mutus Liber cherchent à capturer au filet et à l’hameçon. Ce sont également des dauphins que l’on remarque sur divers motifs décoratifs de l’Hôtel Lallemant : à la fenêtre médiane de la tourelle d’angle, au chapiteau d’un pilier, ainsi qu’au couronnement de la petite crédence, dans la chapelle. L’Ichtus grec des Catacombes romaines n’a pas d’autre origine. Martigny reproduit, en effet, une curieuse peinture des Catacombes qui représente un poisson, nageant dans les flots et portant sur son dos une corbeille dans laquelle sont des pains et un objet rouge, de forme allongée, qui est peut-être un vase plein de vin. [Martigny, Dictionnaire des Antiquités chrétiennes, art. Eucharistie, 2e éd., p. 291.] La corbeille que porte le poisson est le même hiéroglyphe que la galette ; sa texture procède également de brins entre-croisés. Pour ne pas étendre davantage ces rapprochements, contentons-nous d’attirer l’attention des curieux sur la corbeille de Bacchus, appelée Cista, que portaient les Cistophores aux processions des bacchanales et « dans laquelle, nous dit Fr. Noel, était renfermé ce qu’il y avait de plus mystérieux ». [Fr. Noel, Dictionnaire de la Fable. Paris, Le Normant, 1801.]
Il n’est pas jusqu’à la pâte de la galette qui n’obéisse aux lois de la symbolique traditionnelle. Cette pâte est feuilletée, et notre petit baigneur y est inclus à la façon d’un signet de livre. Il y a là une intéressante confirmation de la matière représentée par le gâteau des Rois. Sendivogius nous apprend que le mercure préparé offre l’aspect et la forme d’une masse pierreuse, friable et feuilletée. « Si vous l’observez bien, dit-il, vous remarquerez qu’elle est toute feuilletée. » Les lames cristallines qui en composent la substance se trouvent, en effet, superposées comme les feuillets d’un livre ; pour cette raison, elle a reçu l’épithète de terre feuillée, terre des feuilles, livre aux feuillets, etc. Aussi, voyons-nous la première matière de l’Œuvre exprimée symboliquement par un livre tantôt ouvert, tantôt fermé, selon qu’elle a été travaillée ou seulement extraite de la mine. Parfois, lorsque ce livre est figuré fermé, – ce qui indique la substance minérale brute, – il n’est pas rare de le voir scellé par sept bandes ; ce sont les marques des sept opérations successives qui permettent de l’ouvrir, chacune d’elles brisant un des sceaux de fermeture. Tel est le Grand Livre de la Nature, qui renferme en ses pages la révélation des sciences profanes et celle des mystères sacrés. Il est de style simple, de lecture aisée, à condition, toutefois, qu’on sache où le trouver, – ce qui est fort difficile, – et qu’on puisse surtout l’ouvrir, – ce qui est plus laborieux encore.
Visitons maintenant l’intérieur de l’Hôtel. Au fond de la cour s’ouvre la porte, en arc surbaissé, qui donne accès aux appartements. Il y a là de fort belles choses, et les dilettanti de notre Renaissance y trouveraient amplement de quoi satisfaire leur goût. Traversons la salle à manger, dont le plafond cloisonné et la haute cheminée, aux armes de Louis XII et d’Anne de Bretagne, sont des merveilles, et franchissons le seuil de la chapelle.
Véritable bijou, ciselé et guilloché avec amour par d’admirables artistes, cette pièce en longueur, si nous exceptons la fenêtre aux trois arcatures redentées conçues dans le style ogival, est à peine une chapelle. Toute l’ornementation est profane, tous les motifs qui la décorent sont empruntés à la science hermétique. Un superbe bas-relief peint, exécuté dans la manière du saint Christophe de la loggia, a pour sujet le mythe païen de la Toison d’or. Les caissons du plafond servent de cadre à de nombreuses figures hiéroglyphiques. Une jolie crédence du XVIe siècle propose une énigme alchimique. Pas une scène religieuse, pas un verset de psaume, pas une parabole évangélique, rien que le verbe mystérieux de l’Art sacerdotal… Se peut-il qu’on officiât dans ce cabinet de parure si peu orthodoxe, mais, par contre, si propice, en son intimité mystique, aux méditations, aux lectures, voire à la prière du Philosophe ? – Chapelle, studio ou oratoire ? Nous posons la question sans la résoudre.
Le bas-relief de la Toison d’or, que l’on remarque tout d’abord en entrant, est un très beau paysage sur pierre, rehaussé de couleur, mais faiblement éclairé, rempli de détails curieux que la patine du temps rend difficiles à étudier. Au centre d’un cirque de rochers moussus, aux parois verticales, une forêt, dont le chêne forme la principale essence, dresse ses troncs rugueux et développe ses frondaisons. Des clairières laissent apercevoir divers animaux d’identification malaisée, – dromadaire, bœuf ou vache, grenouille au sommet d’un rocher, etc., – qui viennent animer l’aspect sauvage et peu engageant du site. Sur le sol herbeux croissent des fleurs et des roseaux du genre phragmites. À droite, la dépouille du bélier est posée sur un quartier de roche en saillie, et gardée par un dragon dont on voit la silhouette menaçante se découper sur le ciel. Jason était lui-même figuré au pied d’un chêne, mais cette partie de la composition, sans doute peu adhérente, s’est détachée de l’ensemble (pl. XLIII).
 |
CHAPELLE DE L'HOTEL LALLEMANT A BOURGES
La Toison d'Or
Planche XLIII |
La fable de la Toison d’or est une énigme complète du travail hermétique qui doit aboutir à la pierre philosophale. [Conf. Alchimie, op. cit.] Dans le langage des Adeptes, on appelle Toison d’or la matière préparée pour l’Œuvre, ainsi que le résultat final. Ce qui est très exact, puisque ces substances ne se différencient qu’en pureté, fixité et maturité. Pierre des Philosophes et pierre philosophale sont donc deux choses semblables, en espèce et en origine, mais la première est crue, tandis que la seconde, qui en dérive, est parfaitement cuite et digérée. Les poètes grecs nous racontent que « Zeus fut si content du sacrifice fait en son honneur par Phryxos, qu’il voulut que ceux chez qui serait cette toison vécussent dans l’abondance tant qu’ils la conserveraient, et qu’il fût cependant permis à tout le monde d’essayer d’en faire la conquête ». On peut assurer, sans risque d’erreur, que ceux-là ne sont guère nombreux qui usent de l’autorisation. Ce n’est point que la tâche soit impossible ni même extrêmement périlleuse, – car quiconque connaît le dragon sait aussi comment le vaincre, – mais la grosse difficulté gît dans l’interprétation du symbolisme. Comment établir une concordance satisfaisante entre tant d’images diverses, de textes contradictoires ? C’est pourtant le seul moyen que nous ayons de reconnaître la bonne route parmi tous ces chemins sans issue, ces impasses infranchissables, qui nous sont proposés et tentent le néophyte impatient de cheminer. Aussi bien ne nous lasserons-nous jamais d’exhorter les disciples à diriger leurs efforts vers la solution de ce point obscur, quoique matériel et tangible, pivot autour duquel tournent toutes les combinaisons symboliques que nous étudions.
Ici, la vérité apparaît voilée sous deux images distinctes, celle du chêne et celle du bélier, lesquelles ne représentent, comme nous venons de le dire, qu’une même chose sous deux aspects différents. En effet, le chêne a toujours été pris, par les vieux auteurs, pour désigner le nom vulgaire du sujet initial, tel qu’on le rencontre dans la mine. Et c’est par un à peu près, dont l’équivalent répond au chêne, que les Philosophes nous renseignent sur cette matière. La phrase dont nous nous servons peut sembler équivoque ; nous le regrettons, mais on ne saurait parler mieux sans outrepasser certaines bornes. Seuls, les initiés au langage des dieux comprendront sans aucune peine, parce qu’ils possèdent les clefs qui ouvrent toutes les portes, que ce soient celles des sciences ou celles des religions. Mais, pour quelques prétendus cabalistes, juifs ou chrétiens, plus riches de prétention que de savoir, combien y a-t-il de Tirésias, de Thalès ou de Mélampus capables de comprendre ces choses ? Non, certes, ce n’est point pour ceux-là, dont les combinaisons illusoires ne conduisent à rien de solide, de positif ni de scientifique, que nous prenons la peine d’écrire. Laissons donc ces docteurs en kabbale dans leur ignorance et revenons à notre sujet, caractérisé hermétiquement par le chêne.
Personne n’ignore que le chêne porte souvent sur ses feuilles de petites excroissances rondes et rugueuses, parfois percées d’un trou, appelées noix de galle (lat. galla). Or, si nous rapprochons trois mots de la même famille latine : galla, Gallia, gallus, nous obtenons galle, Gaule, coq. Le coq est l’emblème de la Gaule et l’attribut de Mercure, ainsi que le dit expressément Jacob Tollius ; il couronne le clocher des églises françaises, et ce n’est pas sans raison que la France est dite la Fille aînée de l’Église. [Manuductio ad Cælum chemicum. Amstelodami, ap. J. Waesbergios, 1688.] Il n’y a plus qu’un pas à faire pour découvrir ce que les maîtres de l’art ont caché avec tant de soin. Poursuivons. Non seulement le chêne fournit la galle, mais il donne encore le Kermès, qui a, dans la Gaye Science, la même signification que Hermès, les consonnes initiales étant permutantes. Les deux termes ont un sens identique, celui de Mercure. Toutefois, tandis que la galle donne le nom de la matière mercurielle brute, le kermès (en arabe girmiz, qui teint en écarlate) caractérise la substance préparée. Il importe de ne pas confondre ces choses pour ne point s’égarer lorsqu’on passera aux essais. Rappelez-vous donc que le mercure des Philosophes, c’est-à-dire leur matière préparée, doit posséder la vertu de teindre, et qu’il n’acquiert cette vertu qu’à l’aide de préparations premières.
Quant au sujet grossier de l’Œuvre, les uns le nomment Magnesia lunarii ; d’autres, plus sincères, l’appellent Plomb des Sages, Saturnie végétable. Philalèthe, Basile Valentin, le Cosmopolite le disent Fils ou Enfant de Saturne. Dans ces dénominations diverses, ils envisagent tantôt sa propriété aimantine et attractive du soufre, tantôt sa qualité fusible, sa liquéfaction aisée. Pour tous, c’est la Terre sainte (Terra sancta) ; enfin, ce minéral a pour hiéroglyphe céleste le signe astronomique du Bélier (Aries). Gala, en grec, signifie lait, et le mercure est encore appelé Lait de Vierge (lac virginis). Si donc, frères, vous faites attention à ce que nous avons dit de la galette des Rois, et si vous savez pourquoi les Égyptiens avaient divinisé le chat, vous n’aurez plus lieu de douter du sujet qu’il vous faut choisir : son nom vulgaire vous sera nettement connu. Vous posséderez alors ce Chaos des Sages « dans lequel tous les secrets cachés se trouvent en puissance », ainsi que l’affirme Philalèthe, et que l’artiste habile ne tarde guère à rendre actifs. Ouvrez, c’est-à-dire décomposez cette matière, tâchez d’en isoler sa portion pure, ou son âme métallique, selon l’expression consacrée, et vous aurez le Kermès, l’Hermès, le mercure teingeant qui porte en soi l’or mystique, de même que saint Christophe porte Jésus et le bélier sa propre toison. Vous comprendrez pourquoi la Toison d’or est suspendue au chêne, à la manière de la galle et du kermès, et vous pourrez dire, sans offenser la vérité, que le vieux chêne hermétique sert de mère au mercure secret. En rapprochant légendes et symboles, la lumière se fera dans votre esprit et vous connaîtrez l’étroite affinité qui unit le chêne au bélier, saint Christophe à l’Enfant-Roi, le Bon Pasteur à la brebis, réplique chrétienne de l’Hermès criophore, etc.
Quittez le seuil de la chapelle et placez-vous en son milieu ; levez alors les yeux et vous pourrez admirer la plus merveilleuse collection d’emblèmes que l’on puisse rencontrer. Le plafond, composé de caissons disposés sur trois rangs longitudinaux, est soutenu, vers la moitié de sa portée, par deux piliers carrés accotés aux murs et creusés sur leur face de quatre cannelures.
Celui de droite, en regardant l’unique fenêtre qui éclaire cette petite pièce, porte entre ses volutes un crâne humain, placé sur une console de feuilles de chêne et accoté de deux ailes. Traduction expressive d’une génération nouvelle, issue de cette putréfaction, consécutive à la mort, qui survient aux mixtes lorsqu’ils ont perdu leur âme vitale et volatile. La mort du corps laisse apparaître une coloration bleu foncé ou noire, affectée au Corbeau, hiéroglyphe du caput mortuum de l’Œuvre. Tel est le signe et la première manifestation de la dissolution, de la séparation des éléments et de la génération future du soufre, principe colorant et fixe des métaux. Les deux ailes sont placées là pour enseigner que, par abandon de la partie volatile et aqueuse, la dislocation des parties s’opère, la cohésion se trouve rompue. Le corps, mortifié, tombe en cendre noire ayant l’aspect du poussier de charbon. Puis, sous l’action du feu intrinsèque développé par cette désagrégation, la cendre, calcinée, abandonne ses impuretés grossières et adustibles ; il naît alors un sel pur, que la cuisson colore peu à peu et revêt de la puissance occulte du feu (pl. XLIV).
 |
CHAPELLE DE L'HOTEL LALLEMANT A BOURGES
Chapiteau du pilier. Côté droit
Planche XLIV |
Le chapiteau de gauche montre un vase décoratif dont l’embouchure est flanquée de deux dauphins. Une fleur, qui semble sortir du vase, s’épanouit sous une forme rappelant celle des lis héraldiques. Tous ces symboles se rapportent au dissolvant, ou mercure commun des Philosophes, principe contraire au soufre, dont nous avons vu l’élaboration emblématique sur l’autre chapiteau.
À la base de ces deux supports, une large couronne de feuilles de chêne, traversée verticalement d’un faisceau décoré du même feuillage, reproduit le signe graphique correspondant, dans l’art spagyrique, au nom vulgaire du sujet. Couronne et chapiteau réalisent de la sorte le symbole complet de la matière première, ce globe que Dieu, Jésus et quelques grands monarques sont représentés tenir dans leur main.
Notre intention n’est point d’analyser par le menu toutes les images qui décorent les caissons de ce plafond unique en son genre. Le sujet, fort étendu, nécessiterait une étude spéciale et nous obligerait à de fréquentes redites. Nous nous bornerons donc à en donner une rapide description et à résumer ce qu’expriment les plus originaux. Parmi ceux-ci, nous signalerons tout d’abord le symbole du soufre et son extraction hors de la matière première, dont le graphique est fixé, ainsi que nous venons de l’apprendre, sur chacun des piliers engagés. C’est une sphère armillaire, posée sur un foyer ardent, et qui offre la plus grande ressemblance avec l’une des gravures du traité de l’Azoth. Ici, le brasier tient la place d’Atlas, et cette image de notre pratique, très instructive par elle-même, nous dispense de tout commentaire. Non loin de là, une ruche commune, en paille, est figurée entourée de ses abeilles, sujet fréquemment reproduit, particulièrement sur le poêle alchimique de Winterthur. Voici, – quel singulier motif pour une chapelle ! – un jeune enfant urinant à plein jet dans son sabot. Là, le même bambin, agenouillé près d’une pile de lingots plats, tient un livre ouvert, tandis qu’à ses pieds gît un serpent mort. – Devons-nous arrêter ou poursuivre ? – Nous hésitons. Un détail situé dans la pénombre des moulures, détermine le sens du petit bas-relief ; sur la plus haute pièce de l’amas figure le sceau étoilé du roi mage Salomon. En bas, le mercure ; en haut, l’Absolu. Procédé simple et complet qui ne comporte qu’une voie, n’exige qu’une matière, ne réclame qu’une opération. « Celui qui sait faire l’Œuvre par le seul mercure a trouvé tout ce qu’il y a de plus parfait. » Tel est du moins ce qu’affirment les plus célèbres auteurs. C’est l’union des deux triangles du feu et de l’eau, ou du soufre et du mercure assemblés en un seul corps, qui génère l’astre à six pointes, hiéroglyphe de l’Œuvre par excellence et de la pierre philosophale réalisée. À côté de cette image, une autre nous présente un avant-bras enflammé dont la main saisit de grosses châtaignes ou marrons ; plus loin le même hiéroglyphe, sortant du roc, tient une torche allumée ; ici, c’est la corne d’Amalthée, toute débordante de fleurs et de fruits, qui sert de perchoir à la géline ou perdrix, – l’oiseau en question étant peu caractérisé ; mais, que l’emblème soit la poule noire ou la perdrix rouge, cela ne change rien à la signification hermétique qu’il exprime. Voici maintenant un vase renversé, échappé, par rupture de lien, de la gueule d’un lion décoratif qui le tenait en équilibre : c’est une version originale du solve et coagula de Notre-Dame de Paris ; un second sujet, peu orthodoxe et assez irrévérencieux, suit de près : c’est un enfant essayant de briser un rosaire sur son genou ; plus loin, une large coquille, notre mérelle, montre une masse fixée sur elle et ligaturée au moyen de phylactères spiralés. Le fond du caisson qui porte cette image répète quinze fois le symbole graphique permettant l’identification exacte du contenu de la coquille. Le même signe, – substitué au nom de la matière, – apparaît dans le voisinage, en grand cette fois, et au centre d’une fournaise ardente. Dans une autre figure, nous retrouvons l’enfant, – qui nous paraît jouer le rôle de l’artiste, – les pieds posés dans la concavité de la fameuse mérelle, et jetant devant lui de minuscules coquilles issues, semble-t-il, de la grande. Nous remarquons aussi le livre ouvert, dévoré par le feu ; la colombe auréolée, radiante et flamboyante, emblème de l’Esprit ; le corbeau igné, juché sur le crâne qu’il becquète, figures assemblées de la mort et de la putréfaction ; l’ange « qui fait tourner le monde » à la façon d’une toupie, sujet repris et développé dans un petit livre intitulé :
Typus Mundi, œuvre de quelques Pères Jésuites [
Typus Mundi in quo ejus Calamitates et Pericula nec non Divini, humanique Amoris antipathia. Emblematice proponuntur a RR. C. S. I. A. Antuerpiæ. Apud Joan. Cnobbaert, 1627.] ; la calcination philosophique, symbolisée par une grenade soumise à l’action du feu dans un vase d’orfèvrerie ; au-dessus du corps calciné, on distingue le chiffre 3 suivi de la lettre R, qui indiquent à l’artiste la nécessité des trois réitérations du même procédé, sur laquelle nous avons déjà plusieurs fois insisté. Enfin, l’image suivante représente le
ludus puerorum commenté dans la
Toison d’or de Trismosin et figuré d’une manière identique : un enfant fait caracoler son cheval de bois, le fouet haut et la mine réjouie (pl. XLV).
 |
HOTEL LALLEMANT A BOURGES
PLAFOND DE LA CHAPELLE
(Fragment)
Planche XLV |
Nous en avons fini avec la nomenclature des principaux emblèmes hermétiques sculptés sur le plafond de la chapelle ; terminons cette étude par l’analyse d’une pièce très curieuse et singulièrement rare.
Creusée dans la muraille, auprès de la fenêtre, une petite crédence du XVIe siècle attire le regard autant par la joliesse de sa décoration que par le mystère d’une énigme considérée comme indéchiffrable. Jamais, au dire de notre
cicerone, aucun visiteur n’est parvenu à en fournir l’explication. Cette lacune provient sans doute de ce que personne n’a compris vers quel but était orienté le symbolisme de toute la décoration, ni quelle science se dissimulait sous ses multiples hiéroglyphes. Le beau bas-relief de la Toison d’or, qui aurait pu servir de guide, n’a pas été considéré dans son véritable sens ; il est demeuré, pour tous, une œuvre mythologique où l’imagination orientale se donne libre carrière. Notre crédence porte cependant elle-même l’empreinte alchimique dont nous n’avons fait, en cet ouvrage, que décrire les particularités (pl. XLVI).
 |
CHAPELLE DE L'HOTEL LALLEMANT
Enigme de la Crédence
Planche XLVI |
En effet, sur les piliers engagés qui supportent l’architrave de ce temple en miniature, nous découvrons directement au-dessous des chapiteaux les emblèmes consacrés au mercure philosophal ; la mérelle, coquille de saint Jacques ou bénitier, surmontée des ailes et du trident, attribut du dieu marin Neptune. C’est toujours la même indication du principe aqueux et volatil. Le fronton est constitué par une large coquille décorative servant d’assise à deux dauphins symétriques liés dans l’axe à leur extrémité. Trois grenades enflammées achèvent l’ornementation de cette crédence symbolique.
L’énigme par elle-même comporte deux termes : RERE, RER, qui semblent n’avoir aucun sens et sont, tous deux, répétés trois fois sur le fond concave de la niche.
Nous découvrons déjà, grâce à cette disposition simple, une indication précieuse, celle des trois répétitions d’une seule et même technique voilée sous la mystérieuse expression RERE, RER. Or, les trois grenades ignées du fronton confirment cette triple action d’un unique procédé, et, comme elles représentent le feu corporifié dans ce sel rouge qu’est le Soufre philosophal, nous comprendrons aisément qu’il faille réitérer trois fois la calcination de ce corps pour réaliser les trois œuvres philosophiques, selon la doctrine de Geber. La première opération conduit d’abord au Soufre, ou médecine du premier ordre ; la seconde opération, absolument semblable à la première, fournit l’Élixir, ou médecine du second ordre, lequel n’est différent du Soufre qu’en qualité et non pas en nature ; enfin, la troisième opération, exécutée comme les deux premières, donne la Pierre philosophale, médecine du troisième ordre, laquelle contient toutes les vertus, qualités et perfections du Soufre et de l’Élixir multipliées en puissance et en étendue. Si l’on demande, au surplus, en quoi consiste et comment s’exécute la triple opération dont nous exposons les résultats, nous renverrons l’investigateur au bas-relief du plafond où l’on voit rôtir une grenade dans un certain vase.
Mais comment déchiffrer l’énigme des mots vides de sens ? – D’une manière très simple. RE, ablatif latin des res, signifie la chose, envisagée dans sa matière ; puisque le mot RERE est l’assemblage de RE, une chose, et RE, une autre chose, nous traduirons deux choses en une, ou bien une double chose, et RERE équivaudra ainsi à RE BIS. Ouvrez un dictionnaire hermétique, feuilletez n’importe quel ouvrage d’alchimie et vous trouverez que le mot REBIS, fréquemment employé par les Philosophes, caractérise leur compost, ou composé prêt à subir les métamorphoses successives sous l’influence du feu. Résumons. RE, une matière sèche, or philosophique ; RE, une matière humide, mercure philosophique ; RERE ou REBIS, une matière double, à la fois humide et sèche, amalgame d’or et de mercure philosophiques, combinaison qui a reçu de la nature et de l’art une double propriété occulte exactement équilibrée.
Nous voudrions être aussi clair dans l’explication du second terme RER, mais il ne nous est pas permis de déchirer le voile de mystère qu’il recouvre. Néanmoins, afin de satisfaire dans la mesure du possible la légitime curiosité des enfants de l’art, nous dirons que ces trois lettres contiennent un secret d’une importance capitale qui se rapporte au vase de l’Œuvre. RER sert à cuire, à unir radicalement et indissolublement, à provoquer les transformations du compost RERE. Comment donner de suffisantes indications sans devenir parjure ? – Ne vous fiez pas à ce que dit Basile Valentin dans ses Douze Clefs, et gardez-vous de prendre ses paroles à la lettre lorsqu’il prétend que « celui qui a la matière trouvera bien un pot pour la cuire ». Nous affirmons, au contraire, – et l’on peut avoir foi en notre sincérité, – qu’il sera impossible d’obtenir le moindre succès dans l’Œuvre si l’on a pas une connaissance parfaite de ce qu’est le Vase des Philosophes ni avec quelle matière il faut le fabriquer. Pontanus avoue qu’avant de connaître ce vaisseau secret il avait recommencé, sans succès, plus de deux cent fois le même travail, quoiqu’il besognât sur les matières propres et convenables, et selon la méthode régulière. L’artiste doit faire lui-même son vaisseau ; c’est une maxime de l’art. N’entreprenez rien, en conséquence, tant que vous n’aurez pas reçu toute la lumière sur cette coquille de l’œuf qualifiée secretum secretorum chez les maîtres du moyen âge.
Qu’est-ce donc que RER ? – Nous avons vu que RE signifie une chose, une matière ; R, qui est la moitié de RE, signifiera une moitié de chose, de matière. RER équivaut donc à une matière augmentée de la moitié d’une autre ou de la sienne propre. Notez qu’il ne s’agit point ici de proportions, mais d’une combinaison chimique indépendante des quantités relatives. Pour nous faire mieux comprendre, prenons un exemple et supposons que la matière représentée par RE soit le réalgar ou sulfure naturel d’arsenic. R, moitié de RE, pourra donc être le soufre du réalgar ou son arsenic, lesquels sont semblables, ou différents, selon qu’on envisage le soufre et l’arsenic séparément ou combinés dans le réalgar. De telle sorte que RER sera obtenu par le réalgar augmenté du soufre, qui est considéré comme formant la moitié du réalgar, ou de l’arsenic, envisagé comme l’autre moitié dans le même sulfure rouge d’arsenic.
Quelques conseils encore ; cherchez tout d’abord RER, c’est-à-dire le vaisseau. RERE vous sera ensuite facilement connaissable. La Sibylle, interrogée sur ce qu’était un Philosophe, répondit : « C’est celui qui sait faire le verre. » Appliquez-vous à le fabriquer selon notre art, sans trop tenir compte des procédés de verrerie. L’industrie du potier vous serait plus instructive ; voyez les planches de Piccolpassi, vous en trouverez une qui représente une colombe dont les pattes sont attachées à une pierre. [Claudius Popelin, Les Trois Libvres de l’Art du Potier, du cavalier Cyprian Piccolpassi. Paris, Librairie Internationale, 1861.] Ne devez-vous pas, d’après l’excellent avis de Tollius, chercher et trouver le magistère dans une chose volatile ? Mais si vous ne possédez aucun vase pour la retenir, comment l’empêcherez-vous de s’évaporer, de se dissiper sans laisser le moindre résidu ? Faites donc un vase, puis votre composé ; scellez avec soin de manière qu’aucun esprit ne puisse s’exhaler ; chauffez le tout selon l’art jusqu’à complète calcination. Remettez la portion pure de la poudre obtenue dans votre composé, que vous scellerez dans le même vase. Réitérez pour la troisième fois, et ne nous remerciez point. C’est au Créateur seul que doivent aller vos actions de grâces. Pour nous, qui ne sommes qu’un jalon posé sur la grande voie de la Tradition ésotérique, nous ne réclamons rien, ni souvenir ni reconnaissance, sinon que vous preniez pour d’autres la même peine que nous avons prise pour vous.
Notre visite est achevée. Une fois encore, pensif, notre admiration muette interroge ces merveilleux et surprenants paradigmes, dont l’auteur est demeuré si longtemps inconnu des nôtres. Existe-t-il quelque part un livre écrit de sa main ? – Rien ne semble l’indiquer. Sans doute, à l’exemple des grands Adeptes du moyen âge, préféra-t-il confier à la pierre, plutôt qu’au vélin, le témoignage irrécusable d’une science immense dont il possédait tous les secrets. Il est donc juste, il est équitable que sa mémoire revive parmi nous, que son nom sorte enfin de l’obscurité et brille, comme un astre de première grandeur, au firmament hermétique.
Jean Lallemant, alchimiste et chevalier de la Table ronde, mérite de prendre place autour du saint Graal, d’y communier avec Geber (Magister magistrorum), avec Roger Bacon (Doctor admirabilis). Égal, pour l’étendue du savoir, au puissant Basile Valentin, au charitable Flamel, il leur est supérieur par l’expression de deux qualités, éminemment scientifiques et philosophiques, qu’il porta au plus haut degré de perfection : la modestie et la sincérité.
LA CROIX CYCLIQUE D’HENDAYE
Ce chapitre et ses planches ne figurent pas dans l’édition originale de 1926, chez
Jean Schemit. Ils seront introduits dans l’édition de 1957, à l’Omnium Littéraire, et maintenus dans
les éditions ultérieures. Le texte est de Fulcanelli et les planches de Julien
Champagne. Ces documents étaient en possession d’Eugène Canseliet, qui, dans sa
préface à l’édition de 1957, reste plus que discret sur cette insertion.
L.A.T.
Petite ville frontière du pays basque, Hendaye groupe ses maisonnettes au pied des premiers contreforts pyrénéens. L’océan vert, la Bidassoa large, brillante et rapide, les monts herbeux l’encadrent. L’impression première, au contact de ce sol âpre et rude, est assez pénible, presque hostile. A l’horizon marin, la pointe de Fontarabie, ocrée sous la lumière crue, enfonce dans les eaux glauques et miroitantes du golfe, rompt à peine l’austérité naturelle d’un site farouche. Sauf le caractère espagnol de ses maisons, le type et l’idiome de ses habitants, l’attraction toute spéciale d’une plage récente, hérissée d’orgueilleux palaces, Hendaye n’a rien qui puisse retenir l’attention du touriste, de l’archéologue ou de l’artiste.
En quittant la station, un chemin agreste longe la voie ferrée et conduit à l’église paroissiale, située au centre de la ville. Ses murs nus, flanqués d’une tour massive, quadrangulaire et tronquée, se dressent sur un parvis exhaussé de quelques marches et bordé d’arbres aux épaisses frondaisons. Edifice vulgaire, lourd, remanié, sans intérêt. Près du transept méridional, cependant, une humble croix de pierre, aussi simple que curieuse, se dissimule sous les masses vertes du parvis. Elle ornait autrefois le cimetière communal, et c’est seulement en 1842 qu’on la transporta près de l’église, à la place qu’elle occupe aujourd’hui. Telle est, du moins, l’assurance que nous en donna un vieillard basque, lequel avait rempli, durant de longues années, les fonctions de sacristain. Quant à l’origine de cette croix, elle est inconnue et il nous fut impossible d’obtenir le moindre renseignement sur l’époque de son érection. Toutefois, en prenant pour base de supputation la forme du soubassement et celle de la colonne, nous pensons qu’elle ne saurait être antérieure à la fin du XVIIe siècle ou au commencement du XVIIIe. Quoiqu’il en soit de son ancienneté, la croix d’Hendaye, par la décoration de son piédestal, se montre bien le plus singulier monument du millénarisme primitif, la plus rare traduction symbolique du chiliasme, que nous ayons jamais rencontrés. On sait que cette doctrine, acceptée tout d’abord puis combattue par Origène, saint Denys d’Alexandrie et saint Jérôme, bien que l’église ne l’eût point condamnée, faisait partie des traditions ésotériques de l’antique philosophie d’Hermès. La naïveté des bas-reliefs, leur exécution malhabile mènent à penser que ces emblèmes lapidaires ne sont pas l’œuvre d’un professionnel du ciseau et du burin ; mais, abstraction faite de l’esthétique, nous devons reconnaître que l’obscur artisan de ces images incarnait une science profonde et de réelles connaissances cosmographiques.
Sur le bras transversal de la croix, — une croix grecque, — on relève l’inscription commune, bizarrement taillée en saillie sur deux lignes parallèles, aux mots presque soudés, et dont nous respectons la disposition :
OCRUXAVES
PESUNICA
Certes, la phrase est aisée à rétablir et le sens bien connu :
O crux ave spes unica. Cependant, si nous traduisions comme un apprenti, on ne comprendrait guère ce qu’il faudrait désirer, du pied ou de la croix, et une telle invocation aurait lieu de surprendre. Nous devrions, en vérité, pousser la désinvolture et l’ignorance jusqu’au mépris des règles élémentaires de la grammaire ; pes, au nominatif masculin réclame l’adjectif unicus, qui est du même genre, et non le féminin unica. Il semblerait donc que la déformation du mot spes, espérance, en pes, pied, par ablation de la consonne initiale, soit le résultat involontaire d’un manque absolu de pratique chez notre lapicide. Mais l’inexpérience justifie-t-elle vraiment une étrangeté semblable ? Nous ne pouvons l’admettre. En effet, la comparaison des motifs exécutés par la même main et de la même manière, démontre l’évident souci d’une mise en place normale, le soin apporté dans leur disposition et leur équilibre. Pourquoi l’inscription aurait-elle été traitée avec moins de scrupule ? Un examen attentif de celle-ci permet d’établir que les caractères en sont nets, sinon élégants, et ne chevauchent pas (pl. XLVII).
 |
HENDAYE (Basses-Pyrénées)
Croix cyclique
Planche XLVII |
Notre artisan sans doute les traça avec la craie ou le charbon, et cette esquisse doit nécessairement écarter toute idée d’une erreur survenue pendant la taille. Or, puisqu’elle existe, il faut conséquemment, que cette erreur apparente ait été voulue en réalité. La seule raison que nous puissions invoquer est celle d’un signe mis exprès, voilé sous l’aspect d’une inexplicable malfaçon et destiné à piquer la curiosité de l’observateur. Nous dirons donc que, selon nous, c’est sciemment et volontairement que l’auteur disposa ainsi l’épigraphe de son œuvre troublante.
L’étude du piédestal nous avait déjà éclairé, et nous savions de quelle manière, à l’aide de quelle clef, il convenait de lire l’inscription chrétienne du monument ; mais nous désirions montrer aux investigateurs quels secours peuvent apporter, dans la résolution des choses cachées, le simple bon sens, la logique et le raisonnement.
La lettre S qui emprunte la forme sinueuse du serpent, correspond au khi (X) de la langue grecque et en prend la signification ésotérique. C’est la trace hélicoïdale du soleil parvenu au zénith de sa courbe à travers l’espace, lors de la catastrophe cyclique. C’est une image théorique de la bête de l’Apocalypse, du dragon qui vomit, aux jours du Jugement, le feu et le soufre sur la création macrocosmique. Grâce à la valeur symbolique de la lettre S, déplacé à dessein, nous comprenons que l’ins- (251) cription doit se traduire en langage secret, c'est-à-dire dans la langue des dieux ou celle des oiseaux, et qu’il faut en découvrir le sens à l’aide des règles de la Diplomatique. Quelques auteurs, et particulièrement Grasset d’Orcet, dans l’analyse du Songe de Polyphile, publiée par la Revue Britannique, les ont données assez clairement pour nous dispenser d’en parler après eux. Nous lirons donc, en français, langue des diplomates, le latin tel qu’il est écrit, puis employant les voyelles permutantes, nous obtiendrons l’assonance de mots nouveaux composant une autre phrase dont nous rétablirons l’orthographe et l’ordre des vocables, ainsi que le sens littéraire. Ainsi, nous recevons ce singulier avertissement :
Il est écrit que la vie se réfugie en un seul espace [Latin spatium, avec la signification de lieu, place, emplacement, que lui donne Tacite. Correspond au grec
Cirjon, racine
Cira, pays, contrée, territoire.], et nous apprenons qu’il existe une contrée où la mort n’atteindra point l’homme, à l’époque terrible du double cataclysme. Quant à la situation géographique de cette terre promise, d’où les élus assisteront au retour de l’âge d’or, c’est à nous de la rechercher. Car les élus, enfants d’Elie, seront sauvés selon la parole de l’Ecriture. Parce que leur foi profonde, leur inlassable persévérance dans l’effort leur auront mérité d’être élevés au rang des disciples du Christ-Lumière. Ils en porteront le signe et recevront de lui la mission de renouer à l’humanité régénérée la chaîne des traditions de l’humanité disparue.
La face antérieure de la croix, — celle qui reçut les trois clous horribles fixant au bois maudit le corps douloureux du Rédempteur, — est déterminée par l’inscription INRI, gravée sur son bras transversal. Elle correspond à l’image schématique du cycle que porte le soubassement (pl. XLVIII).
 |
CROIX CYCLIQUE D'HENDAYE
Les quatre faces du piédestal
Planche XLVIII |
Nous avons donc ici deux croix symboliques, instruments du même supplice : en haut, la croix divine, exemple du moyen choisi pour l’expiation ; en bas, la croix du globe, déterminant le pôle de l’hémisphère boréal, et situant dans le temps l’époque fatale de cette expiation. Dieu le père tient en sa main ce globe surmonté du signe igné et les quatre grands siècles, — figures historiques des quatre âges du monde, — ont leurs souverains représentés avec le même attribut : Alexandre, Auguste, Charlemagne, Louis XIV [Les trois premiers sont des empereurs ; le quatrième est seulement roi, le Roi-Soleil, marquant ainsi le déclin de l’astre et son ultime rayonnement. C’est le crépuscule avant-coureur de la longue nuit cyclique, pleine d’horreur et d’épouvante, « l’abomination de la désolation ».] C’est là ce qu’enseigne l’épigraphe INRI, que l’on traduit exotériquement par
Iesus Nazarenus Rex Iudæorum, mais qui emprunte à la croix sa signification secrète :
Igne Natura Renovatur Integra. Car c’est à l’aide du feu et dans le feu même que notre hémisphère sera bientôt éprouvé. Et de même qu’on sépare, à l’aide du feu, l’or des métaux impurs, de même dit l’Ecriture, les bons seront séparés des méchants au grand jour du Jugement.
Sur chacune des quatre faces du piédestal, on remarque un symbole différent. L’une porte l’image du soleil, l’autre celle de la lune ; la troisième montre une grande étoile et la dernière une figure géométrique qui, nous venons de le dire, n’est autre que le schéma adopté par les initiés pour caractériser le cycle solaire. C’est un simple cercle que deux diamètres, se coupant à angle droit, partagent en quatre secteurs. Ceux-ci sont chargés d’un A qui les désigne comme les quatre âges du monde, dans cet hiéroglyphe complet de l’univers, formé des signes conventionnels du ciel et de la terre, du spirituel et du temporel, du macrocosme et du microcosme, où l’on retrouve, associés, les emblèmes majeurs de la rédemption (croix) et du monde (cercle).
A l’époque médiévale, ces quatre phases de la grande période cyclique, dont l’antiquité exprimait la rotation continue à l’aide d’un cercle divisé par deux diamètres perpendiculaires, sont généralement représentées par les quatre évangélistes ou par la lettre symbolique qui était l’alpha grec, et, plus souvent encore, par les quatre animaux évangéliques entourant le Christ, figure humaine et vivante de la croix. C’est la formule traditionnelle que l’on rencontre fréquemment sur les tympans des porches romans. Jésus y est exposé assis, la main gauche appuyée sur un livre, la droite levée dans le geste de bénédiction, et séparé des quatre animaux qui lui font cortège par l’ellipse dite Amande mystique. Ces groupes, généralement isolés des autres scènes par une guirlande de nuées, ont leurs figures toujours placées dans le même ordre, ainsi qu’on peut le remarquer aux cathédrales de Chartres (portail royal) et du Mans (porche occidental), à l’église des Templiers de Luz (Hautes-Pyrénées), à celle de Civray (Vienne), au porche de Saint Trophine d’Arles, etc. (pl. XLIX).
 |
ARLES - EGLISE SAINT-TROPHIME
Tympan du porche (XIIème siècle)
Planche XLIX |
« Il y avait aussi devant le trône, écrit saint Jean, une mer de verre semblable à du cristal ; et au milieu du trône et autour du trône, il y avait quatre animaux pleins d’yeux devant et derrière. Le premier animal ressemblait à un lion ; le second ressemblait veau ; le troisième avait le visage comme celui d’un homme, et le quatrième ressemblait à un aigle qui vole. » [
Apocalypse. Ch. IV, v. 6 et 7.] Relation conforme à celle d’Ezéchiel : « Je vis donc… une grosse nuée et un feu qui l’environnait, et une splendeur tout autour, au milieu de laquelle on voyait comme un métal qui sort du feu ; et au milieu de ce feu on voyait une ressemblance de quatre animaux… Et la ressemblance de leurs faces était une face d’homme ; et tous quatre avaient une face de lion à la droite ; et tous quatre avaient une face de bœuf à la gauche ; et tous quatre avaient une face d’aigle au-dessus. » [
Apocalypse, Ch. I, v. 4, 5, 10 et 11].
Dans la mythologie hindoue, les quatre secteurs égaux du cercle que partage la croix servaient de base à une conception mystique assez singulière. Le cycle entier de l’évolution humaine s’y incarne sous la forme d’une vache symbolisant la Vertu, dont les quatre pieds reposent chacun sur un des secteurs figurant les quatre âges du monde. Au premier âge, qui répond à l’âge d’or des Grecs et que l’on nomme Crédayougam ou âge d’innocence, la Vertu se tient ferme sur la terre : la vache pose en plein sur ses quatre pieds. Dans le Trédayougam ou second âge, lequel correspond à l’âge d’argent, elle s’affaiblit et ne se tient plus que sur trois pieds. Pendant la durée du Touvabarayougam, ou troisième âge, qui est celui d’airain, elle est réduite à deux pieds. Enfin, dans l’âge de fer, qui est le nôtre, la vache cyclique ou Vertu humaine touche au suprême degré de faiblesse et de sénilité : elle se soutient avec peine, en équilibre sur un seul pied. C’est le quatrième et dernier âge, le Calyougam, âge de misère, d’infortune et de décrépitude.
L’âge de fer n’a point d’autre sceau que celui de la Mort. Son hiéroglyphe est le squelette pourvu des attributs de Saturne : le sablier vide, figure du temps révolu, et la faux, reproduite dans le chiffre sept, qui est le nombre de la transformation, de la destruction, de l’anéantissement. L’Evangile de cette époque néfaste est celui qui fut écrit sous l’inspiration de saint Matthieu.
Matthæus, en grec Matqajow, vient de Maqhma, Maqhmatow, qui signifie science. Ce mot a donné Maqhsjw, maqhseiw, étude, connaissance, de manqanejn, apprendre, s’instruire. C’est l’Evangile selon la Science, le dernier de tous, mais le premier pour nous, parce qu’il nous enseigne que, sauf un petit nombre d’élus, nous devons collectivement périr. Aussi l’ange fut-il attribué à saint Matthieu, parce que la science, seule capable de pénétrer le mystère des choses, celui des êtres et de leur destinée, peut donner à l’homme des ailes pour qu’il s’élève jusqu’à la connaissance des plus hautes vérités et qu’il parvienne jusqu’à Dieu.
CONCLUSION
Scire. Potere. Audere. Tacere.
La Nature n’ouvre pas à tous, indistinctement, la porte du sanctuaire.
Dans ces pages, le profane découvrira peut-être quelque preuve d’une science véritable et positive. Nous ne saurions nous flatter cependant de le convertir, car nous n’ignorons pas combien les préjugés sont tenaces, combien est grande la force des préventions. Le disciple en tirera plus de profit, à condition, toutefois, qu’il ne méprise point les œuvres des vieux Philosophes, qu’il étudie avec soin et pénétration les textes classiques, jusqu’à ce qu’il ait acquis assez de clairvoyance pour discerner les points obscurs du manuel opératoire.
Nul ne peut prétendre à la possession du grand Secret, s’il n’accorde son existence au diapason des recherches entreprises.
Ce n’est pas assez qu’être studieux, actif et persévérant, si l’on manque de principe solide, de base concrète, si l’enthousiasme immodéré aveugle la raison, si l’orgueil tyrannise le jugement, si l’avidité s’épanouit aux lueurs fauves d’un astre d’or.
La Science mystérieuse réclame beaucoup de justesse, d’exactitude, de perspicacité dans l’observation des faits, un esprit sain, logique et pondéré, une imagination vive sans exaltation, un cœur ardent et pur. Elle exige, en outre, la plus grande simplicité et l’indifférence absolue vis-à-vis des théories, des systèmes, des hypothèses que, sur la foi des livres ou la réputation de leurs auteurs, on admet généralement sans contrôle. Elle veut que ses aspirants apprennent à penser davantage avec leur cerveau, moins avec celui des autres. Elle tient, enfin, à ce qu’ils demandent la vérité de ses principes, la connaissance de sa doctrine et la pratique de ses travaux à la Nature, notre mère commune.
Par l’exercice constant des facultés d’observation et de raisonnement, par la méditation, le néophyte gravira les degrés qui mènent au
L’imitation naïve des procédés naturels, l’habileté jointe à l’ingéniosité, les lumières d’une longue expérience lui assureront le
Réalisateur, il aura encore besoin de patience, de constance, d’inébranlable volonté. Audacieux et résolu, la certitude et la confiance nées d’une foi robuste lui permettront de tout
Enfin, quand le succès aura consacré tant d’années laborieuses, quand ses désirs seront accomplis, le Sage, méprisant les vanités du monde, se rapprochera des humbles, des déshérités, de tout ce qui travaille, souffre, lutte, désespère et pleure ici-bas. Disciple anonyme et muet de la Nature éternelle, apôtre de l’éternelle Charité, il restera fidèle à son vœu de silence.
Dans la Science, dans le Bien, l’Adepte doit à jamais
TABLE DES MATIERES
LE MYSTÈRE DES CATHÉDRALES
I - II - III -IV - V - VI - VII - VIII - IX
PARIS
I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII
AMIENS
BOURGES
I - II
LA CROIX CYCLIQUE D'HENDAYE
CONCLUSION